Frédéric Roux
L’IRONIE DU SPORT
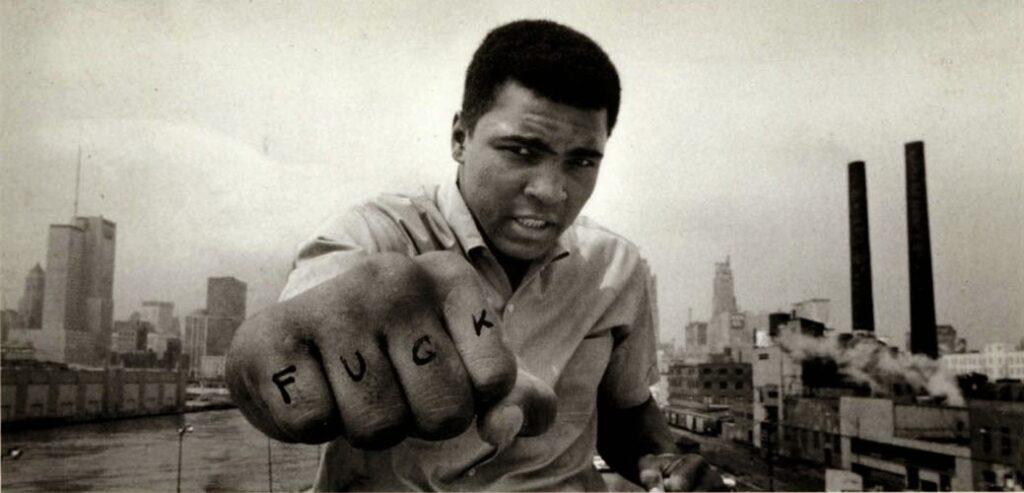
GENERALITÉS

NO WOMAN EVER CALLED ME A QUEER
Bordeaux le 17.4.1987
Le Monde
Messieurs,
Il m’arrive de parcourir le Monde des Livres malgré l’effet désastreux exercé sur mes connexions cérébrales par les multiples coups qu’ont porté sur ma boîte crânienne un nombre considérable d’ouvriers pour la plupart maghrébins. C’est donc avec plaisir que j’ai vu le supplément du 27 mars célébrer le come-back de la vraie pensée et de la vraie culture, celle de Bartok et de Cremonini (on peut préférer Berg et Boltanski…) ; à croire que la vérité, comme le marché, a de réguliers mouvements de balancier.
J’ai particulièrement apprécié l’article de Danielle Sallenave : “Un cheval de course peut-il être génial ?” C’est une des deux questions en ce monde à laquelle on peut répondre : “non”, sans coup férir ; la deuxième étant : “La lauréate d’un prix littéraire peut-elle gagner le Grand Prix de l’Arc de Triomphe ?” Il faut dire que l’introduction ne pouvait que me ravir : “Tout (quoi ?) a commencé, disait Musil, lorsque l’on a qualifié un boxeur, puis un cheval de génial”. Je me suis souvenu à ce propos que j’avais à une époque assez éloignée de gloire médiatique fait l’étonnement (feint) de notre chroniqueur littéraire national ; le héros de mon roman, boxeur de son état, ne feuilletait-il pas l’Homme sans qualités dans les vestiaires…
Ainsi donc si l’on fait un peu de poétique à propos de cette phrase, à laquelle on ne peut, par ailleurs, qu’adhérer (des civilisations entières ne se sont-elles pas effondrées lorsque leurs dirigeants ont porté au cheval l’intérêt exagéré que portaient leurs sujets aux artistes) on se rend compte qu’elle ne dit qu’une chose : assez bas sur l’échelle animale on trouve le cheval, juste au dessus, le boxeur ; pour ce qui suit on hésite entre concierge et chanteur de variétés. C’est une phrase que je pourrais réécrire de la façon suivante : “Tout (mais quoi ?) a commencé lorsque l’on a qualifié Nathalie Sarraute, puis Claude de géniale.”
Je me sens lorsque je parcours le texte de Danielle Sallenave (pas Musil) dans la peau d’un juif sentant confusément le texte anti-sémite sans pouvoir le prouver. Et ce d’autant plus que quelques lignes plus bas il est question de la thèse de Pierre Bourdieu “à peine caricaturée”, selon laquelle : “écouter Bartok plutôt que Linda de Souza ne signifie pas la reconnaissance d’une valeur esthétique mais seulement l’appartenance de classe”. Il me semble qu’après avoir accessoirement souligné des similitudes réjouissantes entre certaines phrases itératives de Robert Chapatte : “Vous êtes contents d’avoir gagné ?” et de Bernard Pivot : “Votre roman est-il autobiographique ?” Pierre Bourdieu a surtout mis à jour les mécanismes d’exclusion qu’opère une culture pour en dominer une autre. Lorsque l’on voit Danielle Sallenave exclure du cercle du juste les chevaux et les boxeurs, Linda de Souza et Poulbot, on est contraint de se demander si la pensée de Pierre Bourdieu est si caricaturale que cela et surtout si Danielle Sallenave n’ignore pas qu’il y a des Linda de Souza à l’université.
Plus bas Danielle Sallenave pose une question : “Que dit le nihilisme culturel ?” La phrase suivante elle a trouvé la réponse — elle est rapide comme l’éclair : “Tout se vaut.” Et si cette phrase était une coquille, si nous avions lu dans Le Monde du lendemain : “Dans notre édition du 27 mars 1987 il fallait lire : ‘Tout se vend’ et non ‘Tout se vaut’. Nos lecteurs auront rectifié d’eux-mêmes”. Si cela était, cela nous dispenserait, par la même occasion, du refrain de l’universitaire, probablement ex-membre du PCF, sur le marxisme, où celui-ci se voit qualifié de critique de la notion de valeur. Peut-être — mais il ne s’agit que d’une supposition — que le marxisme définit surtout différentes catégories de valeurs, ce qui n’est pas les nier toutes. “Nous n’avons pas les mêmes valeurs monsieur l’huissier !” dit fièrement l’héroïne d’une publicité pour les rillettes. Je ne saurais mieux dire.
S’il est certain que “l’air du vide” que nous chante la classe moyenne est haïssable (en quoi est-il la logique ou le manque de logique du Capital, c’est Baudrillard qui nous le dira…), la renaissance pseudo-aristocratique que professe Danielle Sallenave ne l’est pas moins.
Sport de l’angoisse
Avant la télévision le sport n’existait pas. Peut-être, à l’état embryonnaire, ou alors dans des conditions exceptionnelles. On le pratiquait dans des coins reculés : Bazeilles et Tardets, en dehors des limites de la cité, derrière les boulevards périphériques, sur les prés communaux, les jachères. L’ouvrier soufflait dans ses doigts et rajustait son passe-montagne… Sedan reçoit le Red Star, à la mi-temps, en coupant les citrons, il pourra parler de grève générale avec l’inter gauche audonien. Le paysan vissait son béret sur un occiput rougi par les moissons, son voisin d’Alos-Sibas-Abense le Haut, en mêlée ouverte, il allait entendre parler d’Alos-Sibas-Abense le Bas… l’aristo vérifiait la tension des boyaux de sa raquette… le nord-africain s’enfilait un verre de rouge pour ne plus penser à son prochain combat. Tout cela ne ressemblait pas à grand chose : à chat-perché, aux défis stupides après-boire quand l’homme a tombé la veste et cherche des noises à son voisin. Une pratique marginale hantée par des fins de race, des scouts attardés ou des attardés mentaux, heureux comme des mouflets de se courir après, de jouer à la balle, de se taper dessus. Pour les récompenser, on leur remettait une médaille en bronze d’aluminium avec leur nom gravé dessus, on les faisait monter sur une caisse à oranges renversée, l’adjoint au maire leur secouait la louche aux accents de la Marche du 17° RI jouée par l’orphéon municipal et la messe était dite.
On est bien obligé de constater que, depuis la médiatisation généralisée du monde, le sport a fait d’immenses progrès, son succès est désormais tel qu’il est devenu obligatoire. Tout cadre conséquent se flingue consciencieusement l’oreillette en tirant le matin des développements insensés sur son vélo en fibre de carbone, l’après-midi, il va faire bouziller les ménisques de ses rejetons par un professeur de tennis, sa femme est actuellement traitée au laser pour une pubalgie consécutive à la pratique intensive du cardio-training. L’avenir leur appartient et le caméscope avec.
Les raisons de ce succès viennent, sans doute, du fait que le sport est indiscutable : le plus fort, c’est le plus fort, le plus rapide, le plus rapide, un point, c’est marre ! Indiscutable parce que quantifiable, il suffit d’ouvrir un numéro de l’Equipe pour être submergé de chiffres qui, pris séparément, ne veulent rien dire : le club de basket de Vrignes-Ardennes (3771 habitants) souffre d’un déficit d’un million de francs, Sampras compte 4884 points à l’ATP, Califano pèse 108 kilos, en NBA la ligne du tir à trois points passerait de 6,75 à 7,23 mètres, mais qui signifient juste que rien aujourd’hui ne doit échapper à la mesure, pas même la démesure.
Pendant que sur une chaîne concurrente une dizaine de millionnaires se disputeront le droit de gagner davantage, la Marche du Siècle, en direct du SPORTEL à Monaco, s’interrogera sur les coulisses de l’exploit. Qui sont les champions aujourd’hui ? Le spectacle l’emporte-t-il sur l’épreuve ? Est-ce l’argent, la médiatisation ou l’exploit qui les gouverne ? Les réponses sont à la portée de tous ceux qui seraient munis d’un tant soit peu de jugeotte, elles seront esquivées par : Ben Johnson, Mary Pierce, Thierry Rey et les invités psy-psy de service. Deux reportages seront également diffusés : l’un sur le dopage en ex-RDA, l’autre sur l’entraînement de deux gymnastes françaises. Tout cela sera fort démocratique et n’empêchera pas, c’est à craindre, les spectateurs de zapper sur TF 1 pour connaître les résultats ou apercevoir de l’intelligence visible.
On condamnera le dopage, mais après tout, si Ben Johnson est ce soir sur un plateau de télévision et non pas à garder un stade non loin de Saskatoon dans le Saskatchewan, c’est grâce à quoi ? Pourquoi cette fausse pudeur envers les adjuvants chimiques dont on ne peut plus se passer ? Pourquoi les sportifs n’auraient-ils pas les mêmes droits que les drogués de Zurich, dans la mesure où, bien sûr, comme les drogués de Zurich, ils se drogueraient librement. Cela permettrait à la médecine de progresser, un peu à la façon dont la Formule 1 profite à tout un chacun (toit ouvrant, autoradio, fermeture centralisée des portes).
Les deux jeunes gymnastes sont heureuses, c’est elles qui le disent, comment ne pas les croire ? Douze heures par jour à travailler cloîtrées dans un internat aux murs roses et mauves. Que veut le peuple ? Le bonheur… douze heures de boulot, un psychologue et une diététicienne !
Soyons sérieux, lorsque de telles sommes (des milliards de milliards de dollars) et de tels intérêts (la cohésion sociale) sont en jeu, tous les moyens sont bons : présélectionner, comme au haras, les petites, les grands, les asthmatiques (ils ont le droit d’utiliser la Ventoline), aller chercher sur les hauts-plateaux ou dans la savane la marchandise qui manque sur place. Si c’est l’intérêt du CIO, de Coca-Cola, de Don King et du libéralisme réunis, pourquoi hésiter ?
En des temps intermédiaires des gauchistes avaient dénoncé le sport comme étant le nouvel opium du peuple, il faudrait plutôt parler de Turbo-Prozac GTI. Tout cela est dépassé, le sport réalise le rêve le plus secret du sujet : être un objet, de préférence télévisé.
On oublie toujours une chose à propos des esclaves : ils avaient le droit d’être riches, pas celui d’être libres.
Le doping est l’avenir du sport
A la mémoire de
Mohammed Benazizza,
culturiste et martyr
Que veut l’homme ? L’homme veut un spectacle de qualité, et vivre dans un monde meilleur. Que veut la morale ? Empêcher l’homme d’assister à un spectacle de qualité et le meilleur des mondes d’advenir. De quel droit ? La morale, en l’occurrence, n’a qu’un seul but : entraver notre plaisir. Et quel plaisir plus absolu que celui de courir plus vite, sauter plus haut, lancer plus loin que son voisin de palier, de lui être supérieur et d’être admiré pour cela par la planète entière convoquée pour l’occasion ? Dans ces conditions, on ne voit pas vraiment ce qui pourrait interdire à n’importe quel sportif d’absorber librement n’importe quelle substance qui l’aiderait à améliorer ses performances, sinon une morale désuète qui n’a plus cours dans la réalité spectaculaire et marchande où se déploie le sport en sa totalité.
Quelques voix plus au fait de la réalité contemporaine et de son obligatoire modernité se font jour pour demander la suppression du contrôle antidopage. On concédera sans peine à ses partisans qu’interdire des produits indétectables améliorant, sans doute possible, les performances dans le cadre d’une activité qui ne reconnaît que la performance est stupide en soi et ne peut être que sans effet. Monsieur André Alphen, chef des informations au quotidien l’Equipe, s’est fait le porte-parole de cette position dans les colonnes du Monde du 19 juillet dernier. Si l’on admire pour l’occasion sa lucidité, on lui reprochera une certaine timidité (que l’on espère feinte) dans le propos. Pourquoi donc ne pas, purement et simplement, autoriser le dopage puisqu’il est autorisé de fait ? Légiférer sans tenir compte de la réalité est absurde. Pourquoi même ne pas l’institutionnaliser, pourquoi surtout ne pas en recommander l’usage ?
A partir du moment où le sport est l’idéologie dominante rêvée de notre monde, donc de son avenir (il a été nécessaire d’avoir recours à la photo-finish pour départager les finalistes, la publicité semblait nettement en tête jusqu’à la sortie du dernier virage, mais elle ne s’occupait — fatale faiblesse — que de tenter de rendre les marchandises humaines alors que le sport présente l’avantage de réussir à faire de l’humain une marchandise), on ne voit pas quelle instance pourrait simplement vouloir s’y opposer sans courir à sa perte.
Il semblerait, aux dernières nouvelles, que le sport soit le moyen le plus efficace de cohésion sociale du moment, chacun peut le vérifier par lui-même sur les stades et sur les écrans. Dans ces conditions, essayer de s’opposer pour des raisons soi-disant morales au progrès que la pharmacopée et bientôt la génétique mettent à sa disposition est tout bonnement réactionnaire, sinon immoral. Ne dit-on pas que le doping améliore les performances ? Qui se déclarerait aujourd’hui contre une amélioration, quelle qu’elle soit ?
Rien ne peut s’opposer à la liberté de chacun ni au progrès. Charles Bietry, le Monsieur Sport de Canal +, la chaîne emblématique de notre devenir, l’a bien compris qui, au spectacle de deux jeunes filles tentant par tous les moyens en leur pouvoir de se défigurer (ce que, d’ailleurs, elles réussissaient parfaitement), s’exclamait : “Il est interdit d’interdire !”. Les 10 commandements sont de peu de poids face à la seule injonction du “pay per view”… “Ta cotisation régleras ponctuellement”.
Il n’est rien, de nos jours, qui puisse être mis en balance avec la liberté dont nous jouissons si ce n’est la fraternité (qui, bien que concurrentielle, est la norme qui régit les rapports des sportifs entre eux… ne nous le répètent-ils pas tous sans avoir besoin de l’avoir appris ?) et l’égalité ; l’autorisation du dopage serait, sur ce plan aussi, un progrès non-négligeable puisqu’elle mettrait fin à l’injuste inégalité entre utilisateurs d’un dopage indécelable mais cher et ceux d’un dopage bon-marché aisément décelable.
Accessoirement la science a tout à y gagner, de la même façon que le sport automobile contribue un peu plus chaque jour à l’amélioration de nos véhicules (air-bag, toit-ouvrant, condamnation centralisée des portes), la recherche médicale de pointe ne pourrait tirer de l’expérimentation sur des cobayes de si haut niveau que des enseignements sans commune mesure avec ceux dont elle peut se vanter aujourd’hui. Ne vient-on pas de découvrir que l’injection de Testostérone massivement utilisée par les sprinters améliorait l’état des grabataires et des malades du Sida avec, il est vrai, les quelques dangers que l’on peut déplorer dans l’état actuel de nos connaissances (cancer prostatique, insuffisance cardiaque, rénale ou hépatique sévère) ? Un autre des effets secondaires de ces traitements est le rajeunissement de ceux qui l’expérimentent ou du moins, pour l’instant, le rallongement de leurs carrières, le meilleur exemple étant celui de Linford Christie qui finira par remplacer Dorian Gray dans nos mythologies personnelles. Et l’on voudrait nous empêcher d’accéder à la jeunesse éternelle !
S’il semblerait que de si judicieuses ordonnances puissent suspendre le temps il est, en revanche, hors de question que l’histoire revienne en arrière et que l’on applaudisse des sportifs qui ne seraient ni meilleurs ni plus beaux que ceux des années 30. Que l’on propose à l’homme de la rue les photographies de Frankie Fredericks avant et après traitement et l’on verra si le commun n’a pas une vision juste parce que définitive de l’avenir et du progrès. Il est aisé de critiquer l’évolution des morphologies sportives en la comparant, par exemple, à celle des culturistes féminines, mais il suffit de confronter ces dernières à des canons anciens pour se rendre compte que la beauté est définitivement du côté de Cory Everson et consorts.
Moins anecdotiquement, assimiler le doping aux drogues est un argument qui s’effondre de lui-même si on l’examine avec un tant soit peu de sérieux. Les drogues illégales (pour celles qui ne le sont pas, l’appellation : drogue ne se justifie pas) désocialisent, c’est là leur fonction sociale, alors que le doping est le meilleur allié de la conformité sociale, de l’adhésion aux modèles mis en place par l’économie qui nous régit avec bienveillance et sagesse. Qui, là encore, voudrait revivre un monde où les affrontements guerriers sèment la mort et la destruction alors que ceux-ci se règlent désormais sur des modes ludiques et électroniques consentis par tous ?
Que l’on cesse donc de nous casser la tête avec la soi-disant “pureté” du sport qui n’est qu’illusion et l’idée d’une “nature” qui n’a jamais existé depuis que l’homme lui a imposé sa loi. Que l’on autorise enfin les sportifs à assumer librement leur destin qui est de nous distraire et de nous servir d’idoles. Si la mort ou la maladie peuvent les surprendre dans l’exercice de leur sacerdoce, ayons toujours présent à l’esprit qu’elles sont, aussi, notre horizon et que nous les affronterons, pour notre part, sans gloire.
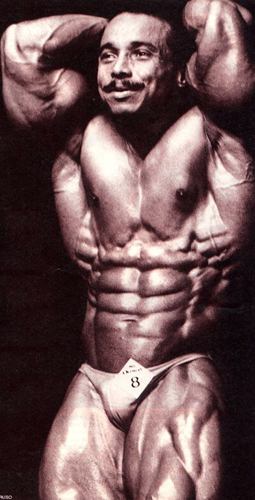
Ça va sport !
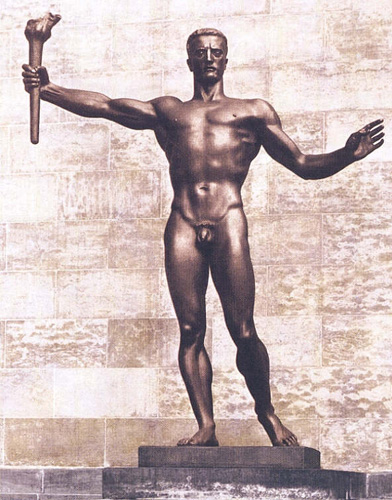
Ces temps derniers, le capitalisme a fait d’énormes progrès.
À tel point que tout ce qui est bon pour le capitalisme est bon pour l’humanité et synonyme de progrès. L’humanité, bien évidemment, étant l’ensemble des consommateurs solvables et le progrès la multiplication à l’envi des mêmes marchandises, jusqu’à ce que rien dans le monde n’échappe au règne du quantitatif. Tous ceux qui y sont opposés ou qui se réclament du qualitatif se voyant immédiatement disqualifiés ou traités de : passéistes nauséeux, réactionnaires fieffés ou pire encore de… chasseurs. Le hard-libéralisme semblerait donc l’horizon indépassable de nos sociétés développées qui y sont soumises et des autres qui ne désirent que l’être. Tout cela viendrait de ce que les idéologies sont mortes et le mur de Berlin détruit, de ce que le socialisme (sous une forme moins gestionnaire que celle que nous avons l’habitude, par paresse, d’appeler ainsi) a échoué dans son ensemble et que, selon Jean-Pierre Elkabbach, qui en connaît un rayon, la télévision crée la réalité.
Fort bien !
Le sport a accompagné sans scrupules, lorsqu’il ne les a pas précédés, tous les totalitarismes du siècle et tous les vieux gauchistes ont eu beau jeu de dénoncer ce qui dans le sport le meilleur agent de massification possible militaire ou ludique. Cette critique est, aujourd’hui, à peu près aussi performante qu’un boulier comparé à un ordinateur portable en vente au BHV ( 64 MO SDRAM, 433 Mhz, 4,8 GO, DVD ) puisque la situation du sport que ce soit dans l’industrie ou dans l’imaginaire de marginale est devenue centrale. La situation est, d’ores et déjà, pire qu’on ne peut l’imaginer. C’est pour cela, sans doute, qu’il faut s’en occuper en dehors des revues confidentielles à la lumière de Berlin, Munich, Moscou, Atlanta et du Heysel avec un brin de dialectique négative.
De la même manière que la culture est devenue la marchandise rêvée (on s’occupe dans le secret des commissions à éliminer les derniers obstacles – l’auteur par exemple et ses droits – qui s’opposent encore à sa soumission complète), le sport est le spectacle idéal dont nos modernes tyrans rêvent de nous rendre définitivement aveugles.
Le meilleur des mondes est à venir, c’est là son intérêt.
Un des leurres les plus usités par le pouvoir est de présenter comme un problème qu’il s’applique à résoudre ce qui doit devenir la norme. De la même façon que l’on s’occupe, ces derniers temps, plus que de raison de l’analphabétisme qui menace(rait) alors, qu’en réalité, on a décrété, depuis belle lurette, que 50% d’analphabètes était le taux raisonnable pour pouvoir gouverner sans risque, les questions les plus couramment soulevées, lorsqu’il est question de sport, sont celles de son entière soumission à la sphère de l’économie et du danger que lui fait courir le dopage ; ce qui veut dire que dopage et dollars seront, désormais, les deux piliers du sport à venir.
C’est comme cela et pas autrement.
Toutes les tentatives des gouvernements et des fédérations déclarant vouloir lutter contre le dopage sont de peu de poids lorsque l’avenir des gouvernements est d’être dissous par les multinationales et celui des fédérations d’être remplacé par le conseil d’administration de Nike et d’Adidas. La toute puissance de la technique passant, entre autres, par une toxicomanie admise et un dopage généralisé, le politique ne peut s’y opposer tant que ses intérêts donc son existence y seront liés.
Lorsque, et cela ne saurait tarder le dopage ne sera plus chimique mais génétique se profilera l’avènement d’une nouvelle race à l’image de la race des vainqueurs que le national-socialisme n’avait pas les moyens techniques de réaliser. D’ores et déjà la technique sportive a réalisé la figure du héros des fresques staliniennes (Ralph Lauren) et de la statuaire d’Arno Brecker (Hugo Boss) et nous sommes conviés à l’admirer – béats – sans trêve ni repos sur les chaînes à péage. L’époque n’est pas si éloignée où les femmes et les hommes concourront ensemble puisqu’il n’existera plus de genre ni de sexe.
Pour ce qui est du reste, l’obscénité des derniers chiffres dont on fait semblant de s’indigner (alors que l’on en jouit) suffit : Nike paie Michael Jordan plus que ses 30 000 ouvriers indonésiens. Il y a à cela deux raisons : il leur rapporte davantage, il est donc, à leurs yeux, trente mille fois plus humain.
On aura compris de tout ce qui précède que je me compte comme l’adversaire du monde (et du sport) que l’on nous prépare et que l’on nous imposera si nous n’avons ni le courage de le regarder en face ni celui de lutter pour le détruire.
Le paradoxe étant que je pourrai renoncer à tout cela si l’on me proposait d’être Muhammad Ali, ne serait-ce que l’espace d’un combat !

Le dopé est l’avenir de l’humanité
Que les choses soient claires : pour ceux qui savent, et qui cachent donc soigneusement ce qu’ils savent (c’est ce secret qui assoit leur pouvoir et assure leurs dividendes), le sport et le dopage sont désormais inséparables au point que la pratique de l’un rend obligatoire l’usage de l’autre.
Tous les efforts consentis, à bon escient, par les ennemis déclarés du dopage seront vains tant qu’ils n’auront pas admis que le sport moderne est inséparable du dopage ; ils n’ont, en réalité, qu’un seul effet : rendre les techniques du dopage chaque jour plus efficaces et son contrôle impossible. Un peu à la manière dont l’émergence politique de l’écologie indique au capitaliste astucieux, qu’il lui faut investir dans la dépollution plutôt que dans la pollution, s’il veut voir ses bénéfices croître.
Quiconque se déclare, aujourd’hui, adversaire du dopage ne peut être qu’un partisan de la fin du sport. Je ne parle évidemment pas du sport pratiqué « autrefois », qui avait encore à voir avec le plaisir et le jeu, mais du sport professionnel moderne qui n’a rien à voir avec ces notions désuètes.
Les effets les plus comiques de cette réalité nouvelle proviennent, bien sûr, de la discipline où la toxicomanie est, depuis toujours, la culture dominante : le cyclisme. La dernière des blagues belges en date : lors du dernier Tour de France, et le jour même de la présence de Marie-George Buffet sur son parcours, des cyclistes positifs aux corticoïdes ont été déclarés négatifs sous prétexte qu’ils avaient un certificat médical attestant que leur état en nécessitait l’usage.
Dans d’autres disciplines moins hexagonales (c’est-à-dire sous la domination complète de l’Empire qui domine le monde), l’usage des drogues est intégré au fonctionnement même de celles-ci, à tel point que les contrôles effectués aux USA portent seulement sur la détection des drogues dont l’usage est censé détruire le lien social et non sur celles qui le renforcent.
Ayant pris conscience de cet état de fait, les esprits pragmatiques avancent l’idée d’une légalisation d’un dopage « raisonnable » ; d’autres, plus lucides, font remarquer que les sportifs de haut niveau et les toxicomanes partagent le même système de valeurs, que le plaisir de la victoire et celui du « flash » sont de même nature et que la raison en est donc retranchée.
Plus que tout cela, une chose peut inquiéter : la naissance d’une nouvelle race (les sportifs de compétition sont de façon de plus en plus voyante les spécimens d’une post-humanité, où même la différence des sexes n’a plus cours, aussi éloignée du commun des mortels que nous le sommes des singes Bonobos) que des idéologues funestes n’avaient fait qu’appeler de leurs vœux. Les nouvelles avancées de la technique (manipulations génétiques et autres) ne feront que creuser ce fossé jusqu’à le rendre infranchissable à ceux qui, à force de talent et de sacrifices, souhaiteraient le combler.
Un détail encore : le public s’en fout. Il se défonce, pour sa part, en ingurgitant des kilomètres de pastis.
Berlin, encore

Quoi que l’on fasse, on se heurte toujours, lorsqu’il est question de sport, au moment où il s’est révélé dans sa cruelle vérité : Berlin 1936 !
La culture de masse est née dans les stades et la « société du spectacle » qui va avec, peut-être aussi ; les premières salles de télévision collectives (fersestuben) gérées par les Postes allemandes ont diffusé… les Jeux Olympiques de Berlin.
Ensuite ? Ça risque de virer rengaine !
S’il n’est pas inutile de se souvenir, avec les gauchistes de base et les fins analystes du Monde diplomatique, que le national-socialisme a été le premier régime politique à instrumentaliser le sport en beauté, il est plus difficile de comprendre pourquoi le sport, après avoir servi tous les totalitarismes, est aujourd’hui le meilleur allié de l’hyperdémocratie, et plus pénible de constater que soixante-dix ans après celles de l’athlétisme et du nazisme, et sur le même territoire, il va falloir assister aux noces du football et de l’ultralibéralisme dans le même enthousiasme crétin qui préside à ce genre de resucées.
Tout être raisonnable sait, si ça l’intéresse, que Sepp Blatter, patron de la Fifa, est aussi habile en détournements de fonds que l’avant-centre carioca en petits ponts ; que, tout comme si elle était envahie par une armée en campagne, on installe sur toute l’étendue de la Germanie des bordels amovibles (on importe de Croatie, à cette occasion, la main d’œuvre idoine) à seule fin de soulager les supporters frustrés par la défaite de leur équipe favorite ; que l’humanité va communier un mois dans une religion (sans Dieu évidemment) un tantinet grotesque avec la bénédiction d’Olivier Besancenot, et s’empoigner aux comptoirs dans des querelles byzantines : le latéral guatémaltèque était-il ou non hors-jeu ? En gros, qu’il va falloir quelque temps faire l’impasse sur l’intelligence. Mais comment, sans risque d’être lynché, ramener l’arrêt de la carrière de Zinedine Zidane à des proportions décentes et non pas à une « perte pour l’humanité tout entière » (Florentino Perez, ancien président du Real de Madrid) ? Comment interdire le rêve aux foules ? Surtout lorsque leurs châteaux en Espagne consistent à vouloir porter les mêmes chaînes (en or) que David Beckham, piloter un 4X4 aux vitres fumées (jantes alu), arroser à intervalles réguliers un ficus blond (90-60-90) dans une chambre décorée par Versace, alors que le seul luxe qu’elles peuvent se permettre d’ordinaire est de passer un week-end au Formule 1 de Laval.
L’esprit critique manque de supporters pour peu que l’on compare son kop à celui de n’importe quelle équipe de division minuscule ; il ne peut rien contre les intérêts en jeu en la circonstance, qui sont pharamineux puisqu’il s’agit de millions de millions d’euro-dollars et de rien moins que de cohésion sociale.
Que demande le peuple ? Du pain et des jeux !
Refrain connu…
Peu importe en définitive, on verra, peut-être, un ou deux bons matchs et à quoi bon se lamenter sur le sport devenu la pire idéologie du siècle, le moindre coup franc de génie nous fera tout oublier et renverser notre plateau repas comme n’importe quel abruti de base.
La question n’est pas là.
En réalité, il y a plus préoccupant que distinguer ce qui dans le sport est pure aliénation ou mesurer en quoi le pouvoir utilise cet orviétan pour anesthésier le peuple. Ce qui est plus préoccupant saute aux yeux : l’hyperdémocratie réussit là où les dictatures ont échoué, elle accouche du surhomme qui arbore le corps dont rêvaient Arno Brecker et Leni Riefensthal (en prime elle fait disparaître l’histoire et la géographie, mais c’est une autre histoire), un corps qui est celui du sportif d’aujourd’hui. Aboli dans sa perfection même.
Ce que la fiction et les totalitarismes avaient imaginé : une nouvelle « race » humaine, la science et la technique le rendent désormais possible. Le corps est la scène où cette nature inédite fait son apparition, le sport est son laboratoire et les sportifs ses cobayes.
Comme le doping décuple les performances des athlètes (à tel point que le dopage est devenu constitutif du sport), les drogues (dé)règlent nos comportements ; les kidsyankees font passer les tonnes de burgers qu’ils engloutissent avec des hectolitres de Ritaline, nous avalons des stères de tranquillisants pour supporter le monde de rêve que nous nous sommes créé. Bientôt les thérapies géniques prendront le relais et mettront fin, en ce qui concerne le sport, au ridicule d’une lutte anti-dopage toujours en retard d’une bataille. L’eugénisme dont il n’était, jusqu’il y a peu, question que pour le condamner est plus ou moins pratiqué, plus ou moins admis. Il s’en faut de peu pour qu’on le plébiscite.
Après tout, pourquoi pas ? Tout ce qui est possible se doit d’être réalisé.
Le problème étant que devant tant de merveilles, il manque de se poser la question d’une nouvelle morale qui pourrait mettre de l’ordre et du sens dans le monde d’Hyperman, celui où les chimères seront ordinaires, l’humanité sans mémoire, les sexes confondus, l’hérédité produite par l’opinion, l’individu réduit à ses gènes, l’esprit défait, mais le corps parfait. Je n’en vois pour ma part qu’une seule, une morale génétiquement modifiée.
Qu’on leur foute la paix !
Le Kabyle sort de ses gonds, le mennonite se shoote, qu’en pensez-vous ? Voilà donc les deux sujets proposés à notre réflexion cet été, cela nous change du sudoku et nous plonge dans la même perplexité. Ce sont des sujets d’importance, on se doit donc d’y déployer des trésors d’intelligence et, lorsque celle-ci manque, appeler à la rescousse une alliée de bon aloi, amphibie et submersible à la fois : la morale. Et en morale, tout le monde en connaît un rayon, c’est connu ; personne n’en ignore les règles et chacun les applique avec soin, donc nous pouvons tous y jouer, ce qui est rare. Il existe, néanmoins, des spécialistes reconnus : les médiatiques qui sont spécialistes de tout, de canicule ou de cyclisme suivant les fluctuations de la pression atmosphérique et du calendrier sportif, mais surtout des moralistes d’envergure, croyants et pratiquants à la fois.
Sur cette scène ou Kant et Spinoza brillèrent naguère, amateurs et professionnels se succèdent pour déclamer la même rengaine : perdre son sang-froid sur une pelouse est intolérable, se droguer en altitude est dégueulasse. D’accord ! Mettons, mais pourquoi ? Je suppose parce que les sportifs doivent être des saints, et que donc en tant que tels ils sont contraints à la sainteté, ou des héros, donc forcément héroïques. Aux USA, on parle à leur sujet de « role-model » (Mike Tyson, O.J. Simpson)… d’exemple quoi ! pour la jeunesse bien sûr puisque la vieillesse a juste besoin de se vaporiser d’eau fraîche à intervalles réguliers et de stationner appuyée sur son déambulateur deux heures par jour dans un centre commercial climatisé. Il faudrait donc que, pour des salaires démesurés (c’est le marché) et une espérance de vie écourtée (c’est la vie), les sportifs supportent que l’on traite leur mère de sale pute à moins qu’ils n’escaladent à la vitesse d’une mobylette au galop avec une hanche nécrosée cinq cols sur le grand plateau dans la même journée avant de répondre en souriant aux questions de Gérard Holtz et ce sans le secours de la pharmacopée adéquate. Ce qui, vous l’avouerez, fait trop pour un héros et beaucoup pour un saint.
Cette belle unanimité donne la nausée. En amont, elle patauge dans l’ignorance, en aval elle démontre le mépris qu’il est habituel de porter aux esclaves et aux services qu’ils nous rendent. Comment, en effet, lorsque l’on a un peu de bon sens, imaginer une seule seconde que les sportifs actuels (et pas seulement les cyclistes) peuvent exercer leur métier dans ses conditions actuelles sans avoir recours aux drogues ? La plus grande partie de l’humanité y a recours pour seulement pouvoir supporter ses conditions d’existence ; dans cette mesure, pourquoi se droguer serait-il mal ? C’est même remboursé par la sécurité sociale ! Et à juste titre. Pourquoi les sportifs n’auraient-ils pas les droits des malades puisqu’il faut être malade pour faire ce qu’ils font, puisqu’ils sont malades ?
Que l’on s’interroge sur le sport, sur la place démesurée qui est la sienne, sur le fait qu’il est le meilleur allié du libéralisme après avoir loyalement servi tous les totalitarismes, qu’il soit devenu la pire idéologie du siècle, pourquoi pas, mais que l’on cesse de jouer les vierges effarouchées sous prétexte que le Kabyle disjoncte ou que le mennonite se charge. Comment pourraient-ils faire autrement ? Et pourquoi voudrait-on empêcher les sous-prolétaires de réaliser leurs rêves : une 4 X 4 chromée, un jacuzzi en marbre des Pyrénées et la blonde en silicon(n)e qui va avec ?
Si j’étais sportif professionnel, j’assimilerais cette campagne d’indignation feinte à une entrave à la liberté du travail ; elle repose, comme toutes les manifestations moralistes de ce genre, sur une hypocrisie effroyable : tout le monde sait (que l’on ne fait pas le Tour de France à l’eau claire par exemple), mais lorsqu’il est impossible de faire semblant de ne plus savoir, tout le monde s’indigne ; tout le monde exige des sportifs des performances qui nécessitent l’emploi d’adjuvants chimiques, mais tout le monde les condamne lorsqu’ils obéissent.
Ces allers-retours entre adoration et indignation doublent les bénéfices de ceux qui en font leur métier : la veille de la finale, Zinedine Zidane est le type le plus « cool » de la planète, le lendemain, la banlieue ne l’a pas quitté (ce qui n’est pas contradictoire, c’est en banlieue que l’on trouve les types les plus « cools » de la planète qui ne s’indignent pas de « raisonnements » semblables) ; les performances et les contre-performances (à moins que ce ne soit le contraire) successives de Landis sont le signe que le Tour est redevenu propre avant d’être celui qu’il est toujours sale.
On se prosterne et puis on lynche.
Tous les idolâtres qui exigent que Zidane soit Allah et Landis Dieu le père sont, par ailleurs, les adeptes de la catharsis sous-péridurale, les partisans de l’orgasme garanti sur facture et du coup de foudre à heures fixes. Des ignorants, des négligents et des crédules, c’est-à-dire ceux qui font le Mal dans le monde. Ce sont les dévots d’une religion sans Dieu, le sport, les adorateurs du spectacle. Nous (presque) tous qui voulons le beurre, l’argent du beurre et sodomiser la crémière sous les applaudissements du crémier, de préférence sur une chaîne hertzienne à une heure de grande écoute.
Et pendant ce temps-là un rapport souhaite légaliser ce que l’on appelait jusqu’ici « clonage thérapeutique » (passible de sept ans de prison depuis 2004), que l’on appellera désormais « transfert nucléaire somatique », ce qui est beaucoup plus rassurant ; peut-être que les découvertes légales de la génétique mettront enfin un terme à toutes ces vaines polémiques sur le dopage puisqu’elles le rendront indétectable.
On le souhaite. Pour le sport et pour les sportifs. Pour les équipementiers et les laboratoires. Pour l’humanité dans son ensemble.
BOXE
La boxe, oui ; la violence, non !

Kirk est bien d’accord !
Régulièrement, un boxeur meurt. Les plus cabotins d’entre eux choisissent de le faire sur le ring ; les plus discrets à l’hôpital, après quelques jours de coma. Et l’on voit refleurir aussitôt l’éternelle polémique : “Doit on tolérer cela ?” S’affronter en un sempiternel débat les éternels partisans d’une morale et de son envers. Chacun drapé dans les plis d’un humanisme de bon aloi, à coups d’arguments auxquels son adversaire se montrera délibérément sourd.
Ceux à qui la boxe répugne (ils préfèrent le golf, la voile et le tennis) ont beau jeu de dénoncer, à propos de ces combats mortels, la barbarie du spectacle qu’offrent deux individus animés volontairement des plus sinistres intentions l’un vis-à-vis de l’autre, sous les encouragements d’un public hystérique. Ils sont en général, aussi, opposés à la chasse, à la corrida, à toutes les activités où le sang est trop visible, qui rappellent, avec trop d’évidence, que l’homme peut être un redoutable salopard. Comment ne pas — dans le fond — être d’accord avec eux, malgré le peu de compréhension qu’ils ont de la catharsis et de ses nécessaires effets ?
Les partisans du “noble art” (qui sont souvent juge et partie) leur rétorquent que tout ça c’est bien joli, mais que ça ne date pas d’hier, que leur idéalisme bêlant est cousu de fil blanc et puis, qu’après tout, la boxe n’est pas plus dangereuse que : le parapente, le ski nautique ou le rugby. Vient alors le moment si redoutable où l’on s’affronte à coups de statistiques comme si l’exposé de colonnes de chiffres allait faire ressusciter un seul disparu. En face de ceux qui peuvent vite, aux yeux du standard de SVP convoqué pour la circonstance, apparaître comme des intégristes proches de la SPA et de la Fédération végétarienne, les partisans du “noble art” plaideront pour une raisonnable humanisation de la boxe à base, essentiellement, d’une médicalisation et d’une surveillance accrues. C’est bien tout ce que leur matérialisme libéral concédera à l’idéalisme dirigiste des adversaires de la boxe.
Il faut renvoyer ces adversaires-là dans leur coin. Après tout, si l’on veut supprimer la boxe, il suffit de supprimer les conditions qui permettent son existence et qui rendent sa pratique si séduisante aux désespérés de la terre. Personne ne s’émeut des peintres qui tombent de leurs échafaudages pour pas beaucoup plus que le SMIC D’un autre côté, on aura beau faire, il n’y a pas à tortiller, un coup de poing de poids lourd c’est cinq tonnes qui dégringolent et le cerveau du type d’en face qui fait amortisseur.
Match nul ! Ils ne nous proposent, tout compte fait, que de choisir entre une version scandinave et une version computérisée du symbolique. Ils sont les représentants médiatiques d’une vision historiciste de la boxe où chaque clan figurerait un stade plus ou moins avancé du Progrès où les notions de sacrifice et d’héroïsme s’effaceraient, d’où la violence serait soit exclue, soit rendue supportable. Car la boxe est, bien sûr, indéfendable, c’est pour cela qu’il faut la défendre. Sa contemplation est ignoble, c’est pour cela qu’il faut regarder les combats qu’elle nous propose les yeux grands ouverts. Elle a à voir avec le sacré ou du moins avec des recoins sombres de l’âme, le Bien et le Mal, des sentiments enfouis, la souffrance, la folie, des émotions étranges, le sublime et le grotesque ; le temps et le Destin, donc la mort.
Les boxeurs sont l’équivalent viril des prostituées : des sacrifiés qui fascinent et repoussent à la fois. C’est leur rôle. Ils purgent.
La mort fait partie intégrante de la boxe, elle est l’élément central de la tragédie qui se joue sur le ring et que tout boxeur qui est jamais “monté” a défié en toute conscience ou pas. C’est ce qui fait de lui, quel qu’il soit, un héros. Alors, qu’un boxeur meure, c’est la garantie que le spectacle est tout sauf virtuel, comme il faut qu’un Senna, de temps à autre, perde la vie afin que le cadre rassasié n’ait pas l’impression d’assister, sur son écran, à une partie de Scalextric.
Une devinette pour terminer : “Slimane fait de la boxe et Rachid du ‘rodéo’, qui aura des ennuis le premier ?” Réponse : Rachid. Le 7 avril 1993 à Wattrelos un policier lui a logé une balle dans la tête. Quatre jours plus tôt, Slimane Ardjouni, son frère, devenait champion de France amateur poids léger. Souhaitons-lui bonne chance ! Le malheur ne prend pas toujours qu’un enfant sur deux aux familles prolétaires. En avril 1994 Bradley Stone mourra des suites de son combat pour le titre britannique des super-coq, son frère était mort quelques mois plus tôt… d’overdose.
“C’est la vie !” comme disent les Pharisiens devant les tombes que l’on referme. Une vie semée d’embûches que les humanistes ne supposent pas.
La boxe est une tragédie plus évidente que le football
La boxe et le football sont ordinairement présentés comme les archétypes du sport populaire, du moins en France. Pourtant ces deux disciplines possèdent des univers et des mythologies très différentes, qui renvoient à des modes de production du spectacle sportif apparemment très éloignées. Frédéric Roux est sûrement l’un des auteurs français à avoir su le mieux immerger ses lecteurs dans ce monde de rencontres arrangées et de légendes par KO, notamment avec son magistral Alias Ali (Fayard) consacré à Cassius Clay. Son dernier ouvrage traite d’un combat historique entre Marvin Marvelous Hagler et Ray « Sugar » Leonard en 1987, dont le dénouement fait encore aujourd’hui couler autant d’encre que le but anglais en 1966. Il nous raconte tout ce qui sépare le ring du stade, et surtout l’art du sport…
Comment expliquez-vous que la boxe ait inspiré ou inspire encore davantage les écrivains que le football ? Sans parler du cinéma ?
Il doit exister quantité de raisons à ce que vous avancez, dont beaucoup que j’ignore. La première qui me vient à l’esprit est très pragmatique : le football n’est pas un sport très populaire outre-Atlantique, alors que l’essentiel de la littérature sportive est anglo-saxonne, bien qu’il semble que, depuis quelque temps, ça s’améliore par chez nous, que la littérature sportive en France ne veuille plus forcément dire biographies ineptes de sportifs fades et resucées décaféinées d’Antoine Blondin. Au cinéma, en revanche, elles ne peuvent pas s’améliorer puisque, de nos jours, le cinéma est presque exclusivement produit à Hollywood.
D’une manière plus « technique », le foot étant un sport collectif, son intérêt pour un lecteur ou un spectateur se disperse plus vite, les caractères sont moins marqués, les oppositions moins claires… On regarde quoi ? On suit qui ? La boxe a le net avantage d’être un sport individuel, il est plus facile pour un lecteur ou un spectateur de se concentrer sur un ou, à la rigueur, deux personnages, nécessairement les héros (Rocky, Jake LaMotta), plutôt que sur vingt-deux gus, sans compter les dirigeants, les arbitres et les coupeurs de citron. Mais la raison essentielle, je crois, tient sans doute à ce que la boxe n’est pas vraiment un sport… La mort n’y est pas perpétuellement jouée à grands coups de pied dans un ballon, elle est l’enjeu central de l’affaire jusqu’à devenir, parfois, hélas ! bien réelle. Ce qui fait, vous me l’avouerez, une sacrée différence ! C’est une tragédie plus évidente, plus immédiate.
Cela sans compter qu’il n’y a pas besoin d’être un spécialiste très futé pour en comprendre les règles, elles sont d’une redoutable simplicité : deux types enfermés, un arbitre pour rappeler la loi, le dernier qui reste debout a gagné… C’est tout ! Le foot, en revanche, c’est aussi compliqué à comprendre pour les Yankees que le cricket pour un Napolitain, le base-ball pour un Uruguayen ou le rugby à XIII pour un Ousbek.
Boxe et foot sont considérés comme deux grands arts populaires, mais leurs « mythologies » semblent diamétralement opposées, peut-on parler d’une juste répartition des rôles dans l’imaginaire collectif ?
Il faut raison garder, ni la boxe ni le foot ne sont des « arts », seraient-ils qualifiés de « populaires ». Ali n’est pas John Coltrane, Johan Cruyff n’est pas Rembrandt et il s’en faut de beaucoup ! À mes yeux, le discours qui veut faire du sport un « art », c’est de la bouillie pour les chats, du genre qui rajoute, volontairement ou pas, de la confusion là où l’intelligence manque.
Le sport, c’est, à la rigueur, de la « culture » ou, plus précisément, de la « sub-culture », au même titre que la cuisine ou la couture. Il ne faut pas confondre la purée Robuchon et un sonnet de Shakespeare, Lagerfeld, c’est pas Velasquez, un petit pont réussi n’est pas l’équivalent d’un aphorisme de Lichtenberg. Comprenez-moi bien, je suis tout à fait d’accord avec Bertold Brecht lorsqu’il réclamait du « bon football » plutôt que du « mauvais théâtre », mais je ne confonds pas pour autant Kopa et Racine, Bernard Tapie et Laurent de Médicis, et je ne recommande à personne de le faire !
La distinction qui me semble la plus compréhensible par tout un chacun, c’est la différence entre le statut des sportifs et celui des artistes : les artistes sont plus ou moins libres, il faut qu’ils le soient, même à l’intérieur de règles quelquefois très contraignantes, les sportifs, jamais. Ce sont des esclaves. A priori, cela peut sembler surprenant aujourd’hui où les adolescents rêvent d’être Thierry Henry plutôt que Che Guevara, mais il y a une chose que l’on oublie, c’est que dans la Rome antique, les esclaves pouvaient être riches, la seule chose qui leur était interdite, c’était d’être libres. Et il n’y a pas moins libres que les sportifs, ils ne peuvent même pas choisir la marque de leurs godasses ni dire le contraire de ce que leurs propriétaires leur demandent de déclarer !
En ce qui concerne « l’imaginaire collectif », je ne me prononcerai pas, je ne sais même pas si l’imaginaire collectif existe ! Je crois, surtout, qu’il y en a plusieurs ou, plutôt, que l’on ne peut pas fixer aussi aisément que vous semblez le faire des limites à l’imaginaire. En tous les cas, j’ignore si les « mythologies » doivent y être bien rangées, le peu que je constate, c’est qu’elles le sont bien mal. Je ne vois pas non plus en quoi les « mythologies » – avec des douzaines de guillemets – véhiculées par le foot et la boxe sont opposées, elles se confondent avec l’idéologie sportive qui est, vous en conviendrez, assez pratique pour maintenir un ordre… quel qu’il soit d’ailleurs.
C’est une religion sans Dieu, le leurre le plus couramment usité aujourd’hui pour que rien ne change et que le peuple rêve à un paradis peuplé de 4X4, de blondes en plastique, d’écrans plasma d’un hectare et de piscines à débordement en marbre de contrebande. On se prend quelquefois à regretter Abel et Caïn.
Question « raciale », corruption, paris truqués, mégalomanie, médias… Le foot constitue-t-il en quelque sort aujourd’hui ce que fut la boxe dans les années 70-80 ?
Si je ne pense pas que l’on puisse comparer le foot et la boxe ou, plutôt, que l’on puisse décalquer exactement leur sens et leurs valeurs, les questions ou les problèmes que vous évoquez (les « races », l’argent, la médiatisation des unes et de l’autre) étant universels, tout au moins mondialisés, et comme ils sont de tous les temps, j’en déduirais, pour ma part, qu’ils n’appartiennent pas davantage au foot qu’à la boxe et pas plus au polo-vélo qu’à la politique.
Dans votre roman, vous racontez le combat entre Marvin Marvelous Hagler et Ray « Sugar » Leonard, et surtout la décision controversée du jury en faveur de Sugar. Est-ce que, dans la boxe comme dans le foot (on songe à Séville 82), ce genre de tragédie laisse finalement une trace plus importante que les grands KO incontestés ?
Que je sache, la France a perdu à Séville et la décision n’est pas contestable. On peut regretter le résultat, refaire le match au comptoir : « Et si… Et si… Et si Battiston ne sort pas, on met Paris en bouteille ! » Mais la réalité, c’est la victoire de l’Allemagne. Pour laisser une trace, que ce soit dans son temps ou dans l’imaginaire, un événement sportif n’a pas à être juste ou injuste, la décision n’a pas à être méritée ou pas, il faut qu’il raconte une histoire que l’on a envie d’écouter parce qu’elle nous fait rire ou bien pleurer, il faut qu’il résonne avec la grande histoire.
Les plus grands combats ne sont pas, sportivement parlant, les plus beaux et des matchs minables peuvent porter un enjeu grandiose. J’ajouterai que les K.-O. incontestés (la deuxième rencontre Ali/Liston en est le parfait exemple) sont parfois plus contestables que des combats clairement et nettement jugés aux points, beaucoup plus, en tous les cas, que la victoire de l’Allemagne à Séville qui, pour sa part, ne souffre aucune contestation.
L’atmosphère des matchs de boxe que vous décrivez à Las Vegas, et on peut aussi songer plus près de nous en France au match Accariès-Ferrara, semble presque plus intense et électrique qu’un Clásico Real-Barcelone, faut-il en déduire que la vraie violence dans la boxe ne se manifeste pas forcément entre les cordes ?
Si « vraie » violence il y a, elle n’advient ni sur un ring ni dans un stade, elle est dans le vrai monde. Le Rwanda, alors que l’on peut chiffrer le résultat de la rencontre, n’était pas pour autant un match Hutus/Tutsis mal arbitré par l’armée française, ce n’était pas du sport, et le sport, malgré l’abus de métaphores guerrières utilisées par les journalistes sportifs, n’est pas la guerre. Alors, bien sûr, le lendemain du jour où Jack Johnson est devenu champion du monde poids-lourd, on a relevé quelques cadavres aux quatre coins des États-Unis, mais souvenons-nous du Heysel où l’on en ramassé davantage. C’était télévisé, le match a eu lieu et tout le monde l’a regardé pour connaître le résultat, alors que le résultat c’était : Inhumanité, 3 – Humanité, 0 ! La vraie violence, c’est celle-là et ses manifestations « invisibles » : la complaisance, l’attraction morbide à son égard doublées de l’aveuglement à ne pas la placer là où il faut le faire.
En lisant Night train de Nick Toshes, on a vraiment le sentiment que davantage tordu est le destin, plus belle sera la légende. Qui parmi les footeux pourrait prétendre à s’élever dans ce cas parmi les anges déchus du ring ? Maradona ?
Maradona, bien sûr, parce qu’il raconte son temps comme Tyson ou DeLaHoya peuvent le faire… Mais sans être un spécialiste, j’ai l’impression que, côté spectaculaire pur, Georges Best ou Garrincha n’ont rien à envier à n’importe quel boxeur sans intérêt. Je n’ai aucunement l’intention d’écrire sur un joueur ou sur un match de foot, ce qui ne veut pas dire que je ne pourrais pas le faire, juste que je n’en ai pas envie ou que l’on ne me l’a pas proposé. De toutes les manières, l’art n’a rien à voir avec le « sujet », le sujet de l’art, c’est l’art, on peut faire de l’art avec tout et n’importe quoi, il suffit de le faire artistiquement, c’est plus dur à réussir qu’une aile de pigeon.
À lire : Frédéric Roux – La classe et les vertus (Fayard)
Propos recueillis par Nicolas Kssis Martov
Vendredi 2 Mai 2014
Entretien paru sur le site de So Foot
On peut le consulter pour comprendre ce que l’on comprend de ce que je dis
Mendy contre Saint Jean Baptiste
Il est des femmes trop belles qui n’enflamment pas le désir et des boxeurs trop parfaits qui n’enthousiasment pas les foules. Mendy fait partie de cette catégorie, comme autrefois Loucif Hamani (pulvérisé physiquement par Marvin Hagler comme Marvin Hagler sera mentalement pulvérisé par Ray Sugar Leonard). Dans la vie, jamais un mot plus haut que l’autre. Sur le ring, un ensemble de qualités exceptionnel. S’il perd, on peut compter sur lui pour analyser parfaitement les raisons de sa défaite, s’il gagne, il se contentera de faire l’éloge de son adversaire. A l’arrivée, on pourrait presque le confondre avec un joueur de tennis du genre de Forget.
On l’a dit fragile, il s’est endurci, on a critiqué son physique un peu juste, il a forci, jusqu’à se forger un corps si beau qu’on le dirait dessiné. Techniquement il est à Bénichou ce que Vialatte est à Sulitzer, mais Bénichou est fou, tatoué, percé de partout, il a été champion du monde ou challenger au titre une douzaine de fois. Jean-Ba n’est jamais décoiffé et son short est toujours repassé, à force d’application, il a réussi à faire oublier qu’il était plus que doué. Après tant de combats pro il lui arrive parfois de retrouver la pureté des gestes d’un amateur.
A cause de tout cela, Mendy se retrouve pratiquer, seul, sans haine et sans violence, un tout autre sport que la boxe. Ce qui l’intéresse c’est le « noble art », alors que tout cela est fini depuis belle lurette et que l’art c’est aussi la démesure.
Ce qui ferait plaisir aux gens qui ont de la morale c’est que la vertu gagne ce soir dans un espace où le vice est si souvent récompensé. Pourquoi pas, après tout ? Ce ne serait pas si mal. Mais peut-être faut-il souhaiter pour cela à Mendy d’être plus fou et méchant que d’ordinaire. Pour être champion du monde il faut être plus sale nègre que bon black. L’adversaire pour Mendy ce soir n’est pas tant Gonzales, le champion en titre, c’est Saint Jean Baptiste.
C’est beau un Noir la nuit
La conférence de presse du combat Mendy/Lorcy, le 2 avril au siège de Canal +, ressemblait à la pesée des championnats d’Aquitaine amateurs à Villeneuve-sur-Lot. L’ambiance et la distribution, à peu de choses près, étaient les mêmes : les hommes, lorsqu’ils n’ont plus l’âge de pouvoir se mettre en short et d’enjamber les cordes, ont forcé sur la teinture à moins que ce ne soit sur la moumoute ; peu de femmes, mais souvent blondes ; les deux sexes ayant un goût marqué pour les bijoux en or : la chaîne avec un gant de boxe suspendu, les bagues mahousses, la gourmette avec le prénom gravé. Ils parlent fort ou tournent en rond en chuchotant à leur portable : « J’suis en conférence de presse… Oui ! OK ! J’te rappelle ! » On s’embrasse beaucoup, ce qui ne veut pas dire que l’on s’aime… loin de là !
Ceux qui devraient être les héros, ceux, en tous les cas, qui vont prendre les coups, ferment leur gueule, ils traînent leur force aujourd’hui inutile au bout de leurs bras ballants, malheureux, peut-être, de ne pas savoir (pouvoir ?) parler. Pour se donner l’air utile ils sourient vaguement en serrant les mains de tous les inconnus qu’ils croisent. C’est dans ces moments-là que l’on se rend compte, plus que d’habitude, que le véritable pouvoir et donc la véritable violence, c’est la parole qui la dispense.
Mendy et Lorcy ne sont pas assez charismatiques, à moins qu’ils ne soient trop modestes, pour se mêler de faire mousser ce qui se passera entre eux sur le ring le 10 avril ; ils ont laissé ce rôle à leurs entraîneurs. Ouamri a fait la grande gueule (il est doué pour ça), Acquaviva (qui ressemble de plus en plus à Tony Curtis) a joué le contre ; leurs boxeurs ont compté les points. Lifa et Wartelle ont joué les seconds rôles, Thiam a balbutié quelques mots, Akim Tafer avait sommeil, les Slaves fraîchement importés ont carrément fermé leur gueule. Qu’ils jouent les agneaux du sacrifice ou qu’ils soient destinés à remettre les pendules à l’heure, peu importe, ils ne sont pas encore habitués à ce cinéma… le capitalisme est un long apprentissage.
Pour tout dire, l’ambiance n’était pas très électrique alors que l’affiche promet un championnat du monde (Mendy/Lorcy), deux championnats d’Europe (Girard/Shkalikov et Thiam/Szabo), un championnat de France (Lifa/Wartelle) et le retour d’Akim Tafer contre un Ukrainien classé n°6 par la WBA. Même Canal + a décidé de doper sa retransmission en diffusant, en fin de soirée, le championnat du monde WBO des poids plume entre Prince Naseem Hamed et Paul Ingle. Il est vrai que « Nazz » ne recule devant rien pour faire le spectacle, il monte sur le ring dans des accoutrements invraisemblables, accompagné par une troupe de figurants relookée par Jean Paul Gaultier, le tout noyé dans les fumigènes, l’éclat des lasers et une ligne de basse à faire exploser le tympan d’un raver chevronné. Mendy attifé de la sorte mourrait de honte.
Depuis plus de quinze ans Jean-Ba monte sur le ring coiffé à la perfection, le short repassé, et s’applique à en redescendre dans le même état, le lundi, il travaille à Cora comme magasinier. Pas un gramme de graisse n’encombre le jeu de ses muscles, il ressemble à un écorché pour planche d’anatomie à moins que ce ne soit à un mannequin anorexique. Il parle de « match » et non de « combat », analyse du même ton tranquille victoire ou défaite, proclame partout que ce qui lui importe c’est la « belle boxe », le « noble art » alors que tous ces beaux discours lui ont fait perdre plus de combats qu’il n’aurait dû. Pour tout dire, il a une nette tendance à descendre du ring pour se regarder boxer. La seule chance de Lorcy sera de bousculer ce type un peu trop propre sur lui en lui imposant une boxe « sale », celle où la manière importe peu, où gagner veut dire détruire. Encore faudrait-il qu’il en ait les moyens, certes Mendy même contre un adversaire dénué de punch comme Sicurella frôle la rupture à un moment ou à un autre du combat, mais Lorcy qui a bénéficié d’une carrière soigneusement aménagée est désavantagé en poids, en taille, en allonge et en expérience. Il semblait même, au cours de la conférence de presse, avoir intégré sa défaite ce qui n’est jamais très bon signe. Pire, alors qu’il a dix ans de moins que Mendy, la suite de sa carrière plus que celle du champion en titre dépend de l’issue de ce combat : on ignore toujours s’il a physiquement digéré les deux combats difficiles qu’il a livrés contre Castillo et sa défaite contre Alexandrov. Si ce n’est pas le cas, on pourra nourrir à son égard les regrets qu’il est d’usage d’avoir pour ceux qui n’ont jamais été que des espoirs. En l’occurrence, dans quelques années, si rien ne s’est passé de positif dans sa carrière, on pourra dire de lui : « Il aurait pu rencontrer De La Hoya en finale des Jeux Olympiques ! T’imagines ? » J’imagine, mais la boxe qui est si propice aux rêves est aussi le sport où la réalité gagne toujours et la réalité, c’est qu’Oscar est champion du monde depuis perpète, pas « Bobo ».
La réalité, c’est les choses sérieuses et les choses sérieuses, c’est Michel Acariès qui en a le mieux parlé pendant cette conférence de presse un peu molle : « Ils feront ce que je leur dirai… » (sauf Wartelle qui fait ce que lui dit Don King), a-t-il déclaré à propos des boxeurs présents.
Imagine-t-on Mendy, un jour, dire des Acariès : « Ils feront ce que je leur dirai…» ?
On peut toujours rêver !
Scène de genre
La scène se passe dans le hall de Canal + avant la conférence de presse du combat Lorcy/Cano. Les acteurs sont deux boxeurs russes affûtés comme des lames, mais avec la peau de ceux qui mangent trop de charcuterie de mauvaise qualité et celui qui est, peut-être, leur « agent » qui fait une tête de plus qu’eux, porte des Ray-Ban et un blouson Bomber.
Bomber : You have shorts ?
Premier Russe : …
Bomber : Shorts… jackets… you have ?
Premier Russe : …
Bomber : You have shorts ?
Deuxième Russe : …
Bomber : Shorts… what color you want ?
Deuxième Russe : Blue…
Bomber : All blue or…
Deuxième Russe : Black ! Blue or black… blue.
Premier Russe : …
L’un des Russes s’appelle Alexandrov, la dernière fois qu’il est monté sur un ring, il en est redescendu sur une civière. Michel Acariès l’embrasse comme du bon pain ; comme Alexandrov est peu couvert (le Russe n’est pas frileux), il craint qu’il n’attrape froid. Les frères Acariès adorent les boxeurs, ils se préoccupent de leur santé comme s’ils étaient leurs propres enfants… S’ils ont bon appétit ? S’ils ne sont pas enrhumés ? S’ils sont allergiques aux acariens ? Il faut bien reconnaître que les boxeurs ne leur sont pas toujours reconnaissants, mais les Acariès sont ainsi faits qu’ils ne leur en veulent même pas, c’est plus fort qu’eux : ils adorent les boxeurs et pour le leur prouver, ils les embrassent.
Lorsqu’un journaliste demande à Alexandrov si tout va bien, il lui répond : « Good ! Everything good ! Very good ! »
Je ne sais pas pourquoi ça me rappelle cet air de rap :
Good shorts ! Good jacket ! Good scanner !
All is good ! Very good !
Everything all right !
Blue, black, blue, I’got the blue
Ave Cæsar (Palace) !
Morituri (en sursis) te salutant !
Sauveur ? Non… René !
Lorsque l’on veut réussir dans la boxe, mieux vaut avoir, enfouie dans un recoin de son âme, la plus grosse frustration possible, quelque chose à prouver, une revanche à prendre. Les adultes ne se rendent pas compte qu’avec une réflexion de traviole ils peuvent sceller le destin d’un enfant, décider d’une vie, changer l’histoire pour peu que le môme s’appelle Napoléon (sale rital !), Albert Cohen (sale juif !) ou Cassius Clay (sale nègre !).
La vie d’Acquaviva s’est décidée comme ça : « T’as vu comment t’es foutu ? » lui a fait, un jour, un prof de gym maladroit. Il y a des gosses sur qui la réflexion va glisser comme la pluie sur les plumes du canard et d’autres que cela va poursuivre toute leur vie… À tel point que l’on se demande si, aujourd’hui encore, Acquaviva ne serait pas capable de faire une connerie s’il se retrouvait dans la même situation et devant le même défi. Pour tout arranger, la famille Acquaviva vient de Tunisie, autant dire qu’à Saint-Dizier on trouve que le petit a un drôle d’accent, que lorsqu’il récite La Fontaine et Victor Hugo, ça prend aussitôt un tour comique… « C’est plus fort que moi m’sieur ! C’est marrant comme il parle ! »
Le môme rachtok’ va donc faire de la boxe. Une assez jolie carrière même : bataillon de Joinville, champion de France 1974, dix sélections internationales. Manque de pot, il est poids coq et la catégorie, ces années-là, est dominée par un autre rital plus doué que lui, Aldo Cosentino. Ils se rencontreront tellement souvent qu’ils deviendront, pour un temps, les meilleurs amis du monde.
Au bout de cent combats, Acquaviva en aura marre de se demander ce qu’il fout sur un ring et décide que d’autres à sa place répondront, désormais, à cette question destinée à rester sans réponse. À partir de 75, il encadre les équipes de France junior et senior ; conseiller technique régional détaché au bataillon de Joinville puis entraîneur national, il gravit tous les échelons de la hiérarchie jusqu’à ce qu’on lui confie la responsabilité de la préparation olympique. Il part à Barcelone avec Wartelle, Lifa, Benajem, Lorcy et Aouissi et même s’il en revient sans médailles, les résultats sont suffisamment encourageants pour qu’en septembre 92 Acquaviva passe avec armes et bagages au sein de la section boxe du PSG Charles Bietry en est le président, Canal + est derrière ; gros moyens donc et ambitions affichées : mettre sur pied une écurie de boxeurs professionnels intégrée à la chaîne qui se veut incontournable dans tous les domaines où il y a de l’image et de l’argent à faire. Les résultats obtenus, malgré une opposition immédiate entre Bouttier et Acquaviva, seront suffisants (Acquaviva sera le premier entraîneur français à compter quatre champions de France la même année) pour que Canal prolonge cinq ans une expérience qui devait en durer deux. La chaîne préférera, en définitive, se séparer de la structure qu’elle avait mise en place pour choisir d’axer sa politique sur les combats de prestige avec Tyson comme locomotive et Don King sur le tender.
La période dorée est finie, s’il reste manager (il était celui de Julien « Bobo » Lorcy lorsqu’il a été sacré champion du monde aux dépens de Jean-Ba’ « Bohringer » Mendy), consultant pour Pathé, Acquaviva revient à la base : prof’ au collège Jean-Moulin d’Aubervilliers. Lorsqu’il en parle, on le sent frustré de ne pas pouvoir en faire davantage, c’est à dire : mettre tous les collégiens de banlieue et d’ailleurs sur le ring, qu’ils puissent se rendre compte de la réalité et des vertus nécessaires entre 12 cordes. Il voudrait du temps, des hommes à son service, des subventions à la pelle, du matériel en pagaille et tout gérer, bien sûr, comme un PDG son empire. Sa générosité l’aveugle quelquefois, sa naïveté touchante mêlée à son ambition et à son goût pour la Gloire, aussi. Ce qu’il voudrait, plus que tout, c’est la reconnaissance (les palmes académiques, c’est pour bientôt).
Tous les boxeurs sont des rêveurs et Acquaviva a été boxeur avant d’être apparatchik. De s’imaginer pouvoir imposer les idées qu’il croit être les siennes et qui sont marquées des inévitables contradictions du système dans son ensemble, il en vient à oublier la réalité, surtout celle des rapports de force qui lui échappent. C’est là son moindre défaut : il pense sincèrement pouvoir changer le monde tel qu’il est par les moyens désuets des inventeurs pour concours Lépine, des bénévoles et des laissés pour compte. Ce sont ceux, griffonnés sur des dossiers de presse merdiques, qui restent à une Utopie touchante : la leur… Mais, au détour d’une phrase indignée, la langue de bois, tout d’un coup, laisse la place au silence, aux aveux et aux larmes qu’il faut faire semblant de ne pas voir. Si René veut tant « faire le bien » autour de lui, c’est qu’il n’a pas tellement réussi à le faire « près » de lui et que toutes ces réussites accumulées complaisamment récitées, alignées comme des trophées dans la vitrine d’un living de banlieue, ne pèsent pas grand-chose en regard de cet échec.
Peut-être que pour cela il n’aurait pas dû laisser tomber son vrai prénom (dont il trouve qu’il faisait trop mafioso) : Sauveur.
Les cérémonies d’Oscar
Le monde de la boxe aime bien les contes de fées : le voyou repenti, le sale type qui rencontre Dieu au détour d’un vestiaire, l’enfant du ghetto qui finit milliardaire ; les scénarii à la Spielberg filmés par Walt Disney au travers d’un objectif baigné de vaseline. La vie d’Oscar de la Hoya pourrait fournir matière à deux ou trois histoires de ce genre. Il est né à East Los Angeles, un ghetto où les Bloods et les Crips s’étripent comme des chiens enragés dans l’arrière-cour de chez Pal pour un bandana de travers. Son père a fait de la boxe, Oscar sera boxeur ; il adore sa mère et sa mère l’adore ; elle mourra du cancer juste avant qu’il remporte la seule médaille d’or des USA aux JO de Barcelone contre l’allemand de l’est qui lui a infligé une des cinq défaites de son palmarès amateur qui compte plus de deux-cent victoires.
Il passe professionnel dans la foulée avec un contrat sans précédent dans la poche, il est champion du monde de super-plumes pour son douzième combat ; pour le quatorzième, il prend le titre des légers puis celui des super-légers ; il est aujourd’hui champion du monde des welters. Son rêve avoué est d’être champion du monde dans six catégories différentes (manquent les super-welters et les moyens) avant de reprendre des études d’architecture à l’Université. Rien ne dit qu’il n’y arrivera pas : il est considéré comme le meilleur boxeur en activité à ce jour, toutes catégories confondues.
Financièrement, il n’a pas à se plaindre non plus, ses bourses se chiffrent en millions de dollars, pour arrondir ses fins de mois il tourne des publicités pour Mennen et pour Levi’s. Il est propriétaire d’une villa à Bel Air avec une cave de 3 000 cigares (c’est, actuellement, plus qu’une écurie de voitures allemandes ou un jacuzzi au Perrier goût citron, le comble du chic) et une salle de projection privée ; d’une maison à Big Bear Lake où il s’adonne au golf sur son practice et s’entraîne dans le gymnase qu’il a fait construire et d’une autre résidence à San Lucas (Mexique).
Les fées se sont penchées sur son berceau, Oscar a tout : la Gloire, l’argent et les femmes, il pourrait être le Prince charmant de la boxe, le nouveau Robinson, le nouveau Leonard : gueule d’ange, les jambes d’Ali et les poings de Duran ; au lieu de cela, le milieu de la boxe tord le nez et fait la fine bouche… On le traite avec un soupçon de mépris de : « golden boy ».
Qu’est-ce qui cloche et que lui reproche-t-on ? Sa jolie gueule ? De n’être jamais dépeigné ? Son insolente facilité ? Ses trois préparateurs physiques ? Sa morgue ? Son indépendance (il a pris comme managers, au début de sa carrière, avant de s’en séparer, un avocat et un promoteur de rock and roll, il est associé fifty-fifty avec son promoteur Bob Arum avec lequel il négocie ses contrats au coup par coup) ? Ses shorts à la coupe délibérément classique ou au contraire l’orchestre de mariachis qui l’accompagne ? Les hordes de jeunes filles qui hurlent à chacune de ses apparitions comme à celle de n’importe quel boy’s band ? De manquer de panache ? De ne rencontrer que des adversaires faciles ? Tout cela, bien sûr et bien d’autres choses encore, même si ces reproches ne sont pas toujours justifiés. On l’a vu saigner, on l’a vu marqué, on l’a vu sur le cul ; il a rencontré ce qui se faisait de mieux dans les catégories qu’il a traversé : Genaro Hernandez, Rafael Ruelas, Jesse James Leija, Julio Cesar Chavez, Miguel Angel Gonzalez (alors invaincu), Pernell Whitaker, « Bazooka » Quartey. Certes, pour beaucoup, il n’avait pas vraiment gagné contre les deux derniers et il a rencontré des boxeurs qui n’avaient rien à faire là, mais un champion peut se permettre de souffler un peu… Rien ne l’oblige à prendre toujours tous les risques.
La raison de cette défiance est à chercher ailleurs. En réalité, de la Hoya est trop « chicano » pour les américains et trop américain pour les « chicanos ». La communauté mexicaine, la plus grosse minorité de Californie (à tel point qu’elle est majoritaire) aime les guerriers, les boxeurs durs qui sentent la bière, la poudre et la poussière, les Duran, les Chavez. La boxe pour les anciens aztèques a quelque chose à voir avec les sacrifices humains, les charges de Pancho Villa et celles d’Emiliano Zapata. Lorsqu’il a rencontré Chavez (Julio Cesar comme l’Empereur, Cesar Chavez comme le leader syndical) elle était derrière le vieux champion porteur des valeurs machistes qui sont les siennes (« Je frappe, j’encaisse et j’ai quelque chose en plus : les cojones, avait déclaré Chavez avant leur premier combat ; en clair, ce de la Hoya n’est qu’une petite tapette et je m’en vais lui coller les tripes à l’air !). Il n’empêche, les deux fois Chavez perdra avant la limite et, pire, la dernière, il restera dans son coin rappelant aux spectateurs le No màs ! de sinistre mémoire prononcé par Duran devant Leonard. Les pèones ne lui pardonneront jamais d’avoir humilié leur idole à son propre jeu (une tapette avec des couilles, on n’a jamais vu ça !). La classe moyenne américaine, de son côté, le voit comme une menace qui se précise : celle de l’émergence d’une communauté. De la Hoya, à ses yeux, représentera toujours le danger que font courir aux petits blancs les métèques trop doués. Pour les yuppies auquel on l’assimile avec mépris, n’en parlons pas : il restera toujours, même s’il adopte leur style de vie et se plie à leurs valeurs, un rastaquouère et un parvenu.
Avant de finir (ce sera le premier combat du siècle du siècle qui vient) par rencontrer Felix Trinidad (qui vient d’infliger sa première «vraie» défaite à Whitaker) et de gagner dans la souffrance et, peut-être, dans la défaite l’admiration et l’estime de tous, Oscar rencontre le 22 mai à Las Vegas, Oba Carr, un bon boxeur qui vient de battre aux points le vieux Randall (le premier «vrai» vainqueur de Chavez). Oba Carr ne frappe pas (28 victoires avant la limite sur 51 combats), mais la rencontre devrait être intéressante, même si Oscar part archi-favori. Si tout se passe comme prévu, personne ne l’aimera davantage à la fin du combat (« C’était prévu ! Quartey l’avait battu ! Randall ? C’est plus personne ! »), si le combat contre « Bazooka » a laissé des traces et que Carr en profite, la côte du « golden boy » peut remonter… La Bourse a ses mystères ! L’amour d’un peuple aussi…
De là à se laisser battre, il y a de la marge !
P.-S. Walter Cowans Jr voulait rentrer dans le Guiness Book comme le boxeur ayant disputé le plus de combats de l’histoire de la boxe. Sur les 129 combats qu’il avait disputés sous son vrai nom (auxquels il faudrait ajouter quelques dizaines sous des noms d’emprunt), il en avait perdu 102. Il avait coutume de dire : « Plus je perds de combats, plus j’en fais ! » et il rajoutait : « Je descends pour que les autres montent ! » Il faisait partie de ce que l’on appelle les « tomato can », ces boxeurs qui sont chargés d’enrichir le palmarès de ceux dont on a décidé qu’ils deviendraient des champions et qui parfois y arrivent, on peut appeler ça, aussi : « lumpen-prolétaire » ; c’est une question de vocabulaire. Le 12 mai, Walter Cowans Jr s’est suicidé chez lui à Milwaukee dans le Wisconsin.
Ça faisait trop longtemps qu’il voulait regarder la mort en face. C’est fait.
So long pal !
Le nègre émissaire
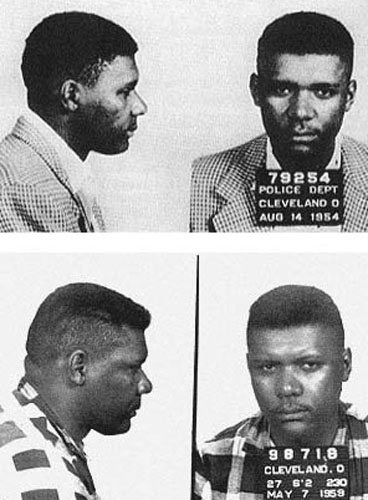
Il y a deux sortes de gens qui traînent autour des rings : ceux qui aiment les boxeurs et ceux qui aiment les vainqueurs. Don King fait indéniablement partie de la dernière catégorie. Il a commencé sa carrière de promoteur, et il s’en vante, en conduisant la limousine de Joe Frazier, quelques heures plus tard il tenait le volant de celle de son vainqueur : George Foreman. On peut en déduire que Don King est un type dont il faut se méfier si l’on laisse tomber sa savonnette dans les douches.
C’est en souvenir, sans doute, de ce temps-là qu’un contrat qui lie un boxeur à Don King lie aussi, plus ou moins, son adversaire… on ne sait jamais ce qui peut arriver ! Un post-scriptum spécifie que, si son champion est battu, Don King est intéressé à la première défense du nouveau champion. C’est cette finesse juridique qui a récemment coûté 200 000 dollars à Franck Tiozzo, organisateur du dernier combat de son frère Fabrice qui avait, quelques mois plus tôt, conquis le titre des mi-lourds aux dépens de Mike McCallum (par ailleurs déclaré positif au contrôle antidopage, mais absous par la WBC, la fédération aux ordres de Don King). Cela peut sembler surprenant, d’habitude on ne part jamais avec le beurre et l’argent du beurre après avoir violé la crémière, mais les contrats que l’on signe avec Don King, mieux vaut en lire toutes les lignes, y compris celles écrites en tout petit au bas de la dernière page, un peu comme il est recommandé de le faire soi-même lorsque l’on épluche son contrat d’assurance.
C’est justement en jouant au plus fin avec la Lloyd’s que King a failli trébucher il y a quelques mois. Pour une obscure affaire de prime d’assurance empochée vite-fait (350 000 dollars tout de même… il n’y a pas de petit profit), Don King risquait 45 ans de prison, un peu à la manière dont Al Capone était tombé pour une banale affaire de fraude fiscale. La justice américaine a des subtilités qui peuvent vous rattraper au tournant. Il faut croire que ce King-là n’est pas le roi des Kongs, puisque l’affaire s’est terminée par son acquittement et que les avocats de la City qui n’ont, pourtant, pas la réputation d’être manchots sont retournés à leurs chères études. Détail amusant, le rôle d’Eliott Ness était tenu dans cette affaire par l’un de ses anciens collaborateurs : Joseph Maffia. Ça ne s’invente pas…
Ce n’était pas, bien sûr, la première fois que Don King avait affaire à la justice. En 1954, meurtre, “légitime défense”. Acquitté. Douze ans plus tard, rebelote, “homicide involontaire”. Total : deux morts, quatre ans de prison. En garçon intelligent, Don King eut vite fait de comprendre que les jeux clandestins comportaient trop d’aléas et la boxe lui apparut comme un terrain plus propice à l’éclosion de ses multiples talents. Ce qui ne manquera pas de se produire, il devient en peu de temps le promoteur des rois (Ali, Frazier, Foreman) et le roi des promoteurs.
En 85, on ne plaisante plus : fraude fiscale. Acquitté. Sa secrétaire écopera de quatre mois d’emprisonnement pour négligence. Bien fait ! Toujours est-il que depuis sa première inculpation l’ancien garçon de course de la Maffia de Cleveland a pris du poids : 130 kilos, quelques dizaines de millions de dollars en banque et surtout la plus belle écurie de boxeurs de la planète : Hill, Hearns, Carbajal, Leija, Liles les frères Norris, mais surtout Chavez et Tyson. L’un à qui il suffit d’apparaître pour voir s’affoler le CAC 40 et les vendeurs de chez Versace, l’autre à qui il fait signer des contrats en blanc puisqu’il ne comprend pas l’anglais ; moyennant quoi, bien que battu plusieurs fois sur le ring, le chicano est toujours champion du monde.
Du billard !
Tout cela ne va pas, bien sûr, sans quelques querelles de famille et de gros sous, Felix Trinidad est en procès avec lui pour dénoncer son contrat ; il est vrai que les bourses fantastiques annoncées aux foules ébahies fondent comme neige au soleil lorsque Don King a effectué les quelques retenues qui s’imposent. Le record à battre restant celui établi par Tim Witherspoon qui touchera 90 000 dollars sur le million promis. La sœur de Gerard McClellan, grièvement blessé en combat il y a un peu plus d’un an, l’accuse de ne pas avoir reversé le montant de la police d’assurances (encore !).
Bagatelles !
Don King est riche, il est noir et il a une grande gueule, trois bonnes raisons de voir se multiplier les critiques, il ne manque pas, d’ailleurs, de hurler au racisme chaque fois qu’il est l’objet de l’attention du FBI, et de distribuer quelques quintaux de dinde (deux dollars le kilo) aux enfants des ghettos pour assurer sa popularité lorsque celle-ci connaît un passage à vide. C’est de bonne guerre. Don King est, peut-être, comme beaucoup le chuchotent dans son dos un négrier cynique et un gangster, il est, plus sûrement, une espèce de Monsieur Ramirez branché sur Internet qui ne manque aucune occasion de vanter les vertus du libéralisme, un capitaliste astucieux qui a compris avant les autres l’avantage du “lobbying” et de la diversification (trois ou quatre champions par catégorie cela fait trois ou quatre fois plus de cash qui circule) et l’importance des médias qui ont tôt fait d’oublier la déontologie dont ils se réclament, lorsqu’il leur faut faire de l’audience. Si l’on veut avoir les mains propres, rien n’empêche, après tout, de ne pas traiter avec lui, mais il faudrait, pour cela, renoncer aux bénéfices que l’on en tire. Que faire ? Le peuple veut du sang et des images… Tous les pharisiens sont, en réalité, enchantés de le voir prendre sur lui tous les péchés du monde puisque l’on peut, ainsi, croire qu’ils ont, eux, les mains propres. Mieux encore, si certains (trust, mafia, réseau, multinationale) tirent les ficelles de ce pantin, ils peuvent se réjouir de posséder un leurre si voyant qu’il éblouit tous les médiatiques.
Lorsque King exhibera sur nos écrans sa tignasse (en pétard) et ses bijoux (voyants), bien peu auront une pensée pour McClellan aveugle et gaga qui se débat dans la nuit avec une seule idée dans ce qui lui reste de cerveau : remonter sur le ring. C’est dommage ! Frank Bruno risque la même chose ce soir.
C’est pour cela que beaucoup regarderont alors qu’ils n’y sont pas obligés.
Prions pour que leur attente soit déçue…
POIDS LOURDS
Attention, un scandale peut en cacher un autre !
Des décisions scandaleuses, j’en ai entendu proclamer des tas… Ça met de l’ambiance, il y a toujours quelques canettes qui volent, la soirée finit gaiement.
J’ai le souvenir de Labat, un type de Pau qui a continué à dominer outrageusement, sous la douche, celui qui l’avait, soi-disant, battu dix minutes plus tôt sur le ring. Persuadé, depuis ce soir-là, que les arbitres lui en voulaient, il n’a pas pu se retenir d’en étendre un aussitôt qu’il en a eu l’occasion. Le Béarnais est rancunier…
Je me souviens d’un Bonnetaz/Griffith à Périgueux : avant d’être déclaré perdant, le vieillard avait donné la leçon d’un bras (il avait des rhumatismes à l’autre) au brave Joël qui, le lendemain, a mangé le morceau en déclarant : « Griffith a peut-être gagné, mais sur ma licence y’a marqué : Bonnetaz vainqueur et c’est ça qui compte ! » Le Parisien ne pense à rien…
Personne ne se soucie plus que les deux championnats du monde d’Ali contre Liston soient les deux combats les plus visiblement truqués de l’histoire de la boxe ; Spinks avait perdu contre Holmes qui avait peut être gagné devant Holyfield (déjà !) et ainsi de suite… L’histoire de la boxe est parsemée de scandales petits ou grands, ça permet de tenir des conversations d’ivrognes jusqu’à pas d’heure.
Le scandale serait donc, cette fois, le match nul entre Holyfield et Lewis…
J’ai assez bu et j’ai plus tellement l’âge de veiller tard !
Ce serait, en tous les cas, un défaut de raisonnement que de penser qu’il s’agit d’un scandale sportif, c’est, surtout, à mon sens, une réussite financière.
Il faut, pour ne pas être dupe, aller au-delà de l’indignation naïve qui arrange tout le monde pour se poser la question : « à qui profite le crime ? » Et, en réalité, le crime profite à tout le monde : à King bien sûr, aux fédérations, aux intermédiaires, aux chaînes câblées qui retransmettront la revanche, au casino qui remportera les enchères, mais aussi aux deux boxeurs qui gagneront davantage pour la revanche qu’ils n’auraient gagné autrement : Holyfield est au bout du rouleau, Lewis endort le spectateur américain et celui qui doit les battre n’est pas encore prêt.
Dans ces conditions, je ne vois pas très bien où est le scandale. Avec Tyson en taule, l’Industrie fait ce qu’elle peut avec ce qu’elle a. C’est pas sa faute s’il n’y a pas grand monde en magasin… Le scandale serait, plutôt, de se priver de tant de bénéfices à si peu de frais.
L’opinion publique a tendance à désirer que le sport soit retranché du bourbier où elle patauge, mais aujourd’hui où il tend à remplir l’espace que la politique lui a abandonné, il est de plus en plus évident que le sport est l’objet de toutes les manœuvres et le théâtre de toutes les malversations. Par quel miracle, étant données les sommes qui s’y brassent, voudrait-on que la boxe soit le sanctuaire que le Tour de France où les Jeux olympiques ne sont plus ?
Post-scriptum : le scandale le plus voyant de ce combat n’est-il pas Holyfield lui-même qui ressemble de plus en plus au croisement de Ben Johnson et de (feue) Flo-Jo ?
Michaël Carnera ou Primo Grant ?
Si l’on veut savoir ce que vaut un boxeur, plutôt que d’observer son jeu de jambes, il vaut mieux se renseigner sur : qui est son manager ? Le manager de Michaël Grant s’appelle Bill Cayton, il est l’un de ceux qui a créé, de toutes pièces, Mike Tyson. Lorsqu’il s’est rendu compte que ce dernier était totalement ingérable (en réalité, Iron Mike l’a foutu à la porte, ce qui n’est, entre parenthèses, peut-être pas la meilleure chose qu’il ait faite), il a préféré placer ses billes (qui sont nombreuses) dans une start-up d’avenir : Michaël Grant. La boxe c’est, encore aujourd’hui, du business et les boxeurs, encore et toujours, une marchandise dont on dispose. Même si le système d’exploitation n’est plus le même que dans les années 50 (Mafia et Cie) il demeure inchangé dans le fond, comme le capitalisme, dont il est l’une des émanations, qui a du s’adapter aux réalités nouvelles pour maintenir sa domination sur le monde.
Avec Michaël Grant, on ne risque pas d’être déçu du voyage… Y’a du matos ! L’enfant mesure deux mètres, pèse environ cent vingt kilos, est doté d’une envergure phénoménale de plus de deux mètres vingt ; rien qu’à le voir ses adversaires sont pris d’une irrépressible envie de retourner à l’ANPE où on les a dénichés. Si jamais il remportait son combat contre Lennox Lewis (qui n’est pas nain non plus) il deviendrait le plus grand champion du monde de l’histoire des poids lourds, juste devant Primo Carnera de sinistre mémoire. Et c’est bien là où le bât blesse, les détracteurs de Grant ne manquent pas d’arguments pour ne voir en Michaël qu’un phénomène de foire fabriqué pour la circonstance par un entourage pas très regardant sur le résultat.
Athlète naturel, doué pour tout : football américain, basket-ball, base-ball, le jeune homme n’est monté pour la première fois sur un ring qu’à l’âge de vingt ans. Sa carrière amateur est inexistante, elle se limiterait à onze combats pour les partisans du verre vide et à une vingtaine pour ceux du verre plein. Ses insuffisances techniques sont criantes : il tombe sur sa droite, il est ouvert sur sa gauche, il manque de vitesse, de punch et de jus. Son palmarès est fabriqué de toutes pièces et il n’a aligné de victoires probantes que face à quelques cloches fondues pour l’occasion (Ross Puritty, Ray Anis, Louis Monaco), les quelques boxeurs un peu connus qu’il a rencontré (Al Cole, David Izon, Lou Savarese) étaient plus difficiles à rater qu’à toucher. En résumé, c’est un Diesel qui aurait tendance à s’endormir avant d’endormir le public (et ses adversaires accessoirement).
À l’inverse, les partisans du colosse de Chicago font remarquer, à juste titre, qu’en amateur Michaël Grant a gagné les Golden Gloves ; qu’il est toujours invaincu chez les professionnels ; qu’il est entraîné par ce qui se fait le mieux dans le genre : Don Turner et Tommy Brooks qui le polissent comme un diamant depuis plusieurs années et que, s’il n’est pas un puncheur pur, ses adversaires n’atteignent pas pour autant la limite ; que, paradoxalement, il boxe très bien « à l’intérieur » ; qu’il a montré lors de combats difficiles qu’il pouvait prendre un coup sans sourciller ; qu’il ne perdait jamais son sang-froid et que son gabarit avait toujours posé des problèmes insolubles à ses adversaires.
Pour faire le tour de la question, il n’est pas inutile de rajouter au panorama que Michaël Grant est le prototype du bon garçon : ses parents étaient ouvriers à Chicago (il a perdu son père en 1986) ; il s’est sagement tenu à l’écart pendant sa jeunesse des gangs de son quartier (les Vice Lords et les Disciples) ; il est chrétien ; il chante et il joue du piano et, surtout, il est américain et, même si l’on considère dans le milieu que Lennox Lewis est le premier poids lourd britannique « vertical », toutes les parties concernées verraient d’un très bon œil la victoire du jeune prodige yankee.
Rien ne dit que Lennox Lewis souscrive à ce genre d’analyses, le jamaïcain d’origine est, lui aussi, un très bel athlète qui possède les mêmes armes que Grant dont un direct du gauche comme un épieu, mais, en prime, il frappe davantage que tous ceux que Michaël a rencontré jusqu’à présent.
Sur le papier ou même sportivement le résultat est incertain, mais il y a tant d’inconnues (que l’on soupçonne vaguement) dans ce combat qui n’appartiennent pas au domaine du sport mais plutôt à celui de l’industrie (Grant est sous contrat avec HBO, une chaîne à péage qui a fait sauter le compteur dans les années Tyson et Lennox Lewis fait régulièrement chuter les indices d’écoute par le seul fait d’apparaître) que l’on ne pourra, réellement, déterminer, en cas de victoire du jeune prodige, quel aura été le vrai vainqueur : Michaël Grant lui même ou Bill Cayton. Les boxeurs sont seuls dans la lumière, mais ce sont les hommes de l’ombre qui décident de leur sort.
La soirée achevée, il ne restera plus à Bill Cayton qu’à rentrer chez lui bercer sa fille aveugle et débile. Elle ne peut s’endormir sans lui, elle a peur du noir et des monstres qui s’y baladent. Elle n’a pas tort.
Chèvre émissaire

Ne réveillez pas le chat qui dort
Tous les secrétaires de rédaction vous le diront, plus c’est gros, plus ça passe ! Leur cauchemar étant de voir étriper un participe sur cinq colonnes à la une. Il faut donc faire tout le temps gaffe, sur le ring comme au marbre, particulièrement lorsque l’attention se relâche ; c’est là que l’on peut se faire méchamment contrer et partir au tapis pour plus que le compte.
C’est un peu ce qui arrive aux éditions Taschen avec leur bouquin sur Muhammad Ali. L’ouvrage, destiné à estourbir l’entendement du quidam : 800 pages, 3000 photos, 29 kilos, 3 000 euros, s’intitule GOAT (Greatest Of All Time).
Le problème étant que Goat veut dire chèvre en anglais et que lorsque l’on traite un boxeur de « chèvre » ce n’est pas particulièrement flatteur. Dans le cas d’Ali, ce n’est ni juste ni justifié, c’est une insulte. Ni Liston (qu’il avait traité de « gros ours »), ni Foreman (qu’il avait traité de « momie ») ni même Frazier dont il a pourri la vie en l’insultant n’auraient osé traiter Ali de « chèvre ».
C’est chose faite, avec son assentiment et par ceux qui veulent l’embaumer.
Le cimetière des éléphants

Les poids lourds sont à l’humanité ce que les éléphants sont au règne animal. Personne ne peut rien contre eux si ce n’est les armes de fort calibre. Cette royauté, il faut qu’ils la paient. Et ils la paient. Cash.
L’emblème en est, évidemment, Ali dont le corps glorieux n’est plus qu’un souvenir, comme sa beauté et sa vitesse. C’est l’âge ! Mais bien qu’une partie du corps médical garantisse que ce dont il souffre n’est en rien lié aux coups qu’il a encaissés, le bon sens se refuse à croire que les quelques combats de trop qu’il a livrés n’y soient pas pour quelque chose.
Certains de ses anciens adversaires ne sont pas en meilleur état : Archie Moore et Sonny Liston sont morts, Buster Mathis a été découpé en morceaux par le diabète, Jerry Quarry souffre de démence précoce, Floyd Patterson, Chuck Wepner, George Chuvalo ont l’élocution difficile et les synapses en vrac. Earnie Shavers et Joe Bugner continuent à un âge canonique de monnayer leur gloire évanouie dans des réunions miteuses. Mention spéciale à Trevor Berbick, prédicateur loufoque et criminel multirécidiviste et surtout à « Neon » Léon Spinks, épave pitoyable qui exhibe ses gencives pour quelques dollars dans les bars qui lui servent d’asile et dont l’un des fils a été tué dans un règlement de compte.
Si tout le monde est plus ou moins au courant des frasques de Tyson (pour mémoire : trois ans de prison pour viol et un épisode cannibale), nous ne sommes que quelques-uns à avoir vu Oliver McCall éclater en sanglots en plein milieu d’un combat et beaucoup ignorent ce qu’il est advenu de types qui ont, à un moment ou à un autre, été champions du monde.
John Tate est mort à 43 ans dans un accident de voiture consécutif à une hémorragie cérébrale, il pesait, à l’époque, plus de cent cinquante kilos et avait sniffé l’équivalent de son poids en cocaïne.
James Douglas, après quelques comas diabétiques, a disparu de la circulation.
Tony Tucker attend que Dieu lui dise d’arrêter de boxer. « Pour l’instant, le Seigneur ne m’a rien dit ! » déclare-t-il à qui veut l’écouter. Dieu doit se désintéresser de son cas, qui ne lui a pas dit que les poudres blanches sont nuisibles à la santé ni qu’il était interdit de détourner les avions lorsqu’on est en colère. Tucker est un peu dur de la feuille, à moins que le ciel ne soit vide.
Tim Witherspoon, ruiné, continue à perdre tous les combats qu’on lui propose.
Greg Page aussi.
Riddick Bowe souffre de graves troubles mentaux.
Michaël Dokes lorsqu’il était en plein boum pouvait dépenser 60 000 dollars de cocaïne par semaine. Le flic qui l’a arrêté après que l’ex-champion eut violé sa fiancée dira : « J’ai jamais vu un mec que Dokes ait rencontré en aussi mauvais état ! »
Pinklon Thomas qui était héroïnomane à 12 ans deviendra accro au crack et SDF après avoir perdu son titre. Comme rien n’est jamais joué dans la vie, Pinklon a trouvé une place d’éducateur en Floride. On peut supposer qu’il sait à peu près de quoi il parle aux délinquants dont il s’occupe.
Don King va bien.
Ali au musée !

Il reste encore à Louisville quelques souvenirs de l’époque où Muhammad Ali y est né, le 17 janvier 1942, et y a grandi, 3302, Grand Avenue : des maisons datant du temps d’Autant en emporte le vent, de la limonade servie sur la pelouse sous le saule pleureur par des domestiques noirs du temps où tous les Noirs étaient domestiques et où personne de sensé n’aurait seulement pu imaginer qu’un métis serait élu président ; du temps où le Derby du Kentucky était la seule chose (sans compter la distillation du bourbon) qui comptait et venait distraire la douceur un peu morne des jours. Lorsque l’on se promène dans l’Allée des Millionnaires devenue « attraction touristique », il y a encore, flottant dans l’air, quelque chose de ce genre : un parfum d’insouciance distinguée.
Certaines de ces demeures de style composite ont été transformées en « Bed and Breakfast » où des couples étranges (souvent gays) essayent de perpétuer ce qui leur apparaît comme l’ultime raffinement de la vieille Europe (livres décoratifs, double-rideaux, soufflé au petit-déjeuner) qui consiste, parfois, aussi, à encadrer des images pour couvercles de boîtes à chocolat comme s’il s’agissait d’un Boucher authentique. Les lampes du nôtre étaient vaguement Tiffany, allumées nuit et jour, les couvre-lits en dentelle, l’escalier en bois grinçait, mais notre hôte nous a rassurés de suite comme nous lui en faisions la remarque : « Des chambres, on n’entend rien ». Rien effectivement sinon comme dans tous les coins même les plus tranquilles, même au fin fond du désert, le bourdonnement perpétuel de l’Amérique.
Le centre-ville de Louisville, en revanche, est un centre-ville ordinaire, un centre-ville américain authentique : il n’a rien à voir avec un centre et n’a rien d’une ville. Le musée Muhammad Ali est situé en plein centre-ville, pas très loin des rives de l’Ohio et de l’Interstate 64, 144 North Sixth Street entre River Road et Main Street, au cas où vous ne vous déplaceriez pas à pied ou en bus, un garage est prévu entre la 6e et la 7e rue.
On peut supposer que le musée a coûté quelques millions de dollars (et même davantage) ; la plaque remerciant les généreux donateurs est aussi grande que celle d’un monument aux morts d’une ville européenne (mettons française) de moyenne importance et d’une matière approchante, du granit noir. Les donateurs sont classés d’une manière inhabituelle (en tous les cas aussi irréfutable que l’ordre alphabétique), selon la somme qu’ils ont versée : Gold, 1 000 000 de $ (« Pillars ») ou 500 000 $ (« Humanitarians ») ; Silver, 250 000 $ (« Champions ») ou 100 000 $ (« Benefactors ») ; Bronze, 50 000 $ (« Underwriters ») ou 10 000 $ (« Sustainers »). Parmi les « Pillars », on peut relever, en dessous de Leïla et Muhammad Ali, Microsoft ; dans les « Champions » : Coca Cola et Lennox Lewis ; dans les « Benefactors » : Delta Airlines et Angelina Jolie ; dans les « Underwriters » : Kodak et la Chase Foundation ; dans les « Sustainers » : la Princesse Haya Bint Al Hussein, General Electric et… Adidas ! que l’on ne peut s’empêcher de trouver un peu radin.
Le bâtiment d’un modernisme modéré (de bon aloi) est sans grand intérêt, pas davantage en tous les cas que ceux qui l’entourent, clair, pratique et susceptible d’être détruit sans que personne ne s’en aperçoive ou ne proteste. L’entrée est aussi grande qu’un hall d’aéroport en prévision des foules susceptibles de s’y presser (nous étions, ce jour-là, à l’ouverture, seuls avec ma femme). Le guichet d’entrée jouxte la boutique où, comme dans n’importe quel musée désormais, on vend les redoutables « produits dérivés » (sylos, casquettes de base-ball, porte-clés, mugs, sweat-shirts) susceptibles de vous transformer en homme-sandwich à des prix défiant toute concurrence. Tout ici est marqué soit Muhammad Ali soit G.O.A.T (Geatest of All Times), ce qui apparaît fort légitime.
Le tarif d’entrée est de 9 dollars (avec des réductions prévues pour les plus de 65 ans, les militaires (sic), les étudiants et les enfants de moins de 12 ans), mais on peut, à peu près partout, se procurer des coupons de réduction.
C’est un musée d’un genre assez ordinaire à une époque où les musées sont consacrés non plus uniquement à l’art, mais à tout ce qui est susceptible de se définir comme « culturel » ; le terme est assez vague pour recouvrir des activités surranées comme l’élaboration du fromage de chèvre en haute montagne, des objets aujourd’hui sans emploi (on les accroche au-dessus de la cheminée) : le fer à friser par exemple, des événements historiques tombés dans l’oubli (la prise de la smalah d’Abd-el-Kader), mais aussi des personnages hors du commun, et Muhammad Ali en fait partie. Comme tous les musées de ce genre, à de rares exceptions près, les solutions plastiques sont absentes, l’éclairage, l’accrochage (mais peut-on parler d’un accrochage alors que l’on privilégie d’ordinaire un récit, au mieux, une dramaturgie ou une mise en scène souvent peu convaincante ?) empruntent les formes classiques de la scénographie socio-culturelle en vogue au moment de la conception du musée, formes susceptibles de se démoder rapidement et qui pourraient, souvent, être avantageusement remplacées par un bon catalogue. Il est vrai que la vulgate en cours serait que le « public » ne sait pas lire, c’est pour cela, sans doute, qu’on lui rend l’écrit illisible en superposant les caractères et les polices de caractères sur des murs du format des affiches publicitaires, que l’on remplace à son usage la page écrite par une multitude d’écrans et un appareillage électronique censé être plus en phase avec la perception contemporaine, que l’on réduit la complexité du discours à quelques slogans, que l’on écrase la réalité sous la littéralité des objets-témoins (exemple : la bicyclette volée du jeune Cassius a été retrouvée pour l’occasion, elle trône plus neuve que neuve sous deux écrans pour illustrer les années 42/57).
Une fois sa place payée, on est pris en charge par le personnel et il n’y a guère moyen d’échapper au parcours (et à son sens) obligatoire(s). En guise de première station, une employée du musée vous fait prendre la pose devant un fond prévu à cet effet, si vous restez interloqué, elle vous indique même la pose que vous devez prendre, celle des vieux boxeurs qui ne boxent plus, une garde menaçante jouée à l’excès de manière à ne pas être prise trop au sérieux. Le temps de développer le cliché, vous verrez votre photographie réapparaître à un étage différent et l’on vous proposera de l’acheter en différents formats. Cela rappelle les procédés utilisés par Walt Disney et, malheureusement, la seule activité à laquelle, désormais, se livre quotidiennement Muhammad Ali : la signature des gants et des photos, de tout ce qui peut, de près ou de loin, rappeler sa splendeur passée qui vient enrichir le marché des Memorabilia, une institution américaine plutôt rentable pour ceux qui l’exercent pour peu qu’ils soient encore cotés à la bourse des célébrités.
Les procédés muséographiques ne sont pas toujours maladroits, ils sont quelquefois touchants dans leur maladresse et leur naïveté ; les informations « historiques » sont toutes données ou à peu près, on glisse sur certaines puisqu’il s’agit avant tout de célébrer un culte et de donner une image d’Ali d’où, paradoxalement, toute violence est exclue. L’accent est mis, presque exclusivement, sur le parcours édifiant de celui qui, par la magie de la récupération, est devenu la figure d’un culte New Age où les bons sentiments (interactifs) ne se lassent pas d’être filmés comme un soap opera.
L’intention est affichée d’entrée, il s’agit de promouvoir les valeurs profondes véhiculées par Muhammad Ali (la paix, l’engagement social, le respect et le développement personnel), et de célébrer son influence universelle. Le but avéré est de communiquer ces valeurs au public, mais on ne se gênera pas pour essayer de les faire partager sinon adopter aux visiteurs (plus ou moins considérés comme des semi-croyants ne demandant qu’à être définitivement convertis).
Ainsi, au quatrième étage, on vous propose de trouver votre voie comme Ali a trouvé la sienne (« Lighting the way »), de découvrir vos forces personnelles (« Walk with Ali ») et l’on termine par un Mur de l’espoir et du rêve, 5 000 dessins d’enfants de 141 pays (« Global Voices »). Au cinquième, vous pouvez lire quelques poésies d’Ali, prendre connaissance des idéaux qui resteront comme son héritage : respect, confiance en soi, conviction, générosité et spiritualité…
Il manque à tout cela l’électricité, la foule, le bruit, l’odeur, la passion, l’excès. Le grand absent, c’est Ali lui-même. Avoir un musée de son vivant, c’est mourir un peu, le risque encouru d’y être enterré de son vivant.
Ce qui ne manque pas.
Nous étions quatre ou cinq à errer dans ces espaces sentant encore le neuf et nous avions tous l’air aussi désolés les uns que les autres.
Ne sachant trop ni quoi dire ni quoi penser.
Un artiste improbable se préparait à montrer ses « œuvres » (femmes nues maladroitement peintes et mandalas flous) dans une salle reculée du troisième étage, nous avons eu le plus grand mal à nous en débarrasser, deux jeunes gens préparaient une réception dans une salle que le centre loue pour financer son fonctionnement.
Le soir même, la seule chose qui me restait en mémoire (le reste, j’ai voulu l’oublier) : une photographie d’Howard Bingham, le photographe « officiel » (puisque Ali était Roi et ne se déplaçait pas sans sa Cour) de Muhammad Ali et l’un de ses amis le plus proche. On y voyait Diana Ross et les Supremes à l’enterrement de Martin Luther King. Dans cette seule image était retenu captif l’esprit d’une époque davantage que dans l’inutile déploiement technologique alentour.
Extrait de notes
Louisville (Kentucky)
5-6 novembre 2008
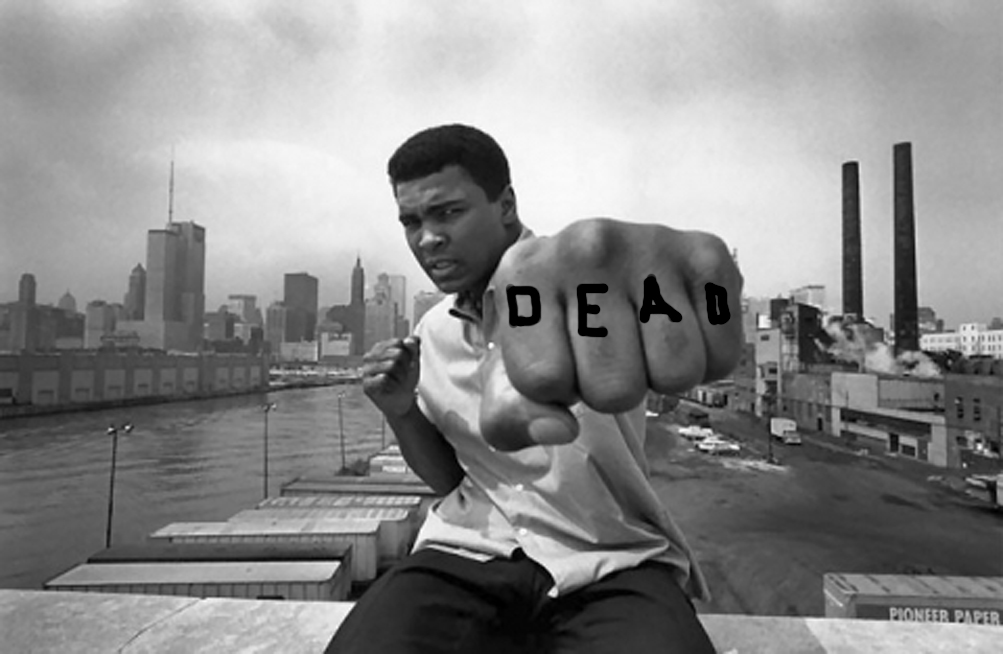
Pour la femme, l’homme est insaisissable. L’homme est l’autre, à domestiquer ; la femme est domestication.
Joyce Carol Oates
En ces temps-là, où les images avaient triomphé sur toute l’étendue de la terre, le visage de Muhammad Ali était familier aux Bambaras comme aux Tchétchènes, aux Farsis comme aux Yoras.
A peu près à cette époque les Beatles avaient déclenché un scandale en déclarant qu’ils étaient plus célèbres que le Christ.
Ali était encore plus célèbre que les Beatles.
Il était donc naturel de les faire se rencontrer.
En février 1965, Ali s’appelait encore Cassius Clay (plus pour très longtemps), il préparait son premier championnat du monde contre Sonny Liston et les Beatles entamaient leur première tournée aux USA. La séance photo, dirigée par Harry Benson, aura lieu à Miami dans le gymnase d’Angelo Dundee où Cassius s’entraînait. Il ne pouvait pas y avoir deux soleils à ses yeux, il était encore moins question qu’il partage sa gloire naissante avec quatre Anglais taillés comme des ablettes et coiffés comme des bobtails, alors le futur Muhammad Ali se frappera la poitrine comme King Kong, poursuivra les Beatles aux quatre coins du ring, les fera s’agenouiller, se rouler par terre et brandir des pancartes à sa gloire.
Dix minutes après que les Fab’ Four aient mis les voiles, alors qu’il avait été traité de « cinquième Beatles, la niaiserie en prime » par Jimmy Cannon (du New York Post), Ali passera un coup de fil à Robert Lipsyte (du New York Times) pour lui demander qui étaient ces « tafioles » ?
Ali préférait Sam Cooke.
John Lennon se rendra compte le premier que Clay les avait fait tourner en bourrique ; en guise de représailles, les Beatles n’adresseront plus la parole au photographe qui avait été chargé d’immortaliser la scène.
Plutôt qu’avec ce jeune nègre hystérique, les Beatles auraient préféré poser avec le champion du monde en titre sur la victoire duquel ils avaient parié, comme tout le monde. Hormis le pari qu’ils auraient perdu, comme presque tout le monde, cela aurait, sans doute, été une plus mauvaise idée encore. Quelques jours plus tôt, quand les Beatles ont commencé à chanter lors du Ed Sullivan Show où il était lui-même invité, Liston avait demandé à Harold Conrad (le promoteur du combat) : « C’est pour ces quatre connards qu’ils gueulent comme des veaux ? » avant de conclure : « Mon chien joue mieux de la batterie que le type avec le gros pif ! »
Sonny n’était pas une tafiole, il n’aimait que le rythm and blues, et sauter à la corde sur Night Train.
Trois ans plus tôt, Steve Schapiro avait réalisé une série de photos sur Cassius Clay, Verona Way (Louisville), là où vivaient ses parents et où le jeune homme revenait souvent.
Il reste encore aujourd’hui à Louisville quelques souvenirs du temps où la limonade était servie sur la pelouse sous le saule pleureur par des domestiques noirs, du temps où tous les Noirs étaient domestiques et où personne de sensé n’aurait seulement pu imaginer qu’un métis serait élu président.
Si Ali n’en était pas le sujet, les photographies de Schapiro pourraient faire partie d’un reportage sur la classe moyenne noire des années 60 : les rues bordées d’arbres pas trop grands où chaque maison de bois a son perron de briques rouges surmonté d’un toit en auvent et son morne jardin de la surface d’un court de tennis. Un peu partout, sur les poteaux de téléphone, des affichettes écrites à la main décrivant des chats et des chiens perdus et, devant les garages, les vaisseaux V 8 de la General Motors passés au polish jusqu’à ce que l’on puisse se repeigner dans le reflet de leurs ailerons aussi bien que dans celui du chrome de leurs pare-chocs.
Derrière les rideaux de nylon, on aperçoit, rutilante, la table basse en faux acajou, le poste de télévision de la taille d’un buffet, les abat-jour recouverts de papier cristal, les napperons, le canapé où l’on ne s’assoit pas pour ne pas le salir… et au mur, les tableaux où des chevaux courent sous un ciel d’orage et les portraits de clowns.
Tout est clair, convenable, d’une propreté méticuleuse, les femmes noires sont des as de la lessive et du ménage, ce sont des professionnelles, et ce depuis l’époque de l’esclavage. La race dont on craint que la saleté déteigne, on l’emploie – évidemment – pour blanchir ce qui doit l’être.
Odessa Clay, la mère de Cassius Marcellus Jr et de son frère, Rudolph Arnette (dit Rudolph Valentino), faisait ça pour les familles blanches d’Indian Hill et de Mockinbird Valley, les quartiers chics de Louisville.
Pour quatre dollars par jour.
— Odessa est tellement chou… depuis le temps, elle fait vraiment partie de la famille !
Les hommes noirs, c’est une autre paire de manches, ils boivent comme des trous, ils jouent aux dés, ils fument, ils se battent comme des chiens et ils ne pensent qu’à baiser la femme de leur voisin. Cassius Marcellus Clay Sr était comme ça. Les flics avaient l’habitude de l’arrêter quand il zigzaguait trop et trop vite pour rentrer au bercail, le plastron de sa chemise éclaboussé de sang, à moins qu’ils ne le ramassent rond comme une queue de pelle s’il avait perdu les clés de sa bagnole.
Ali et son frère sont nés pas très loin, 3302, Grand Avenue.
Ces trois jours-là, Ali a posé avec ses parents dans son polo bien repassé et ses chaussures bien cirées ; il a boxé dans le vide entre la table basse et le poste de télévision ; il s’est mis torse nu et puis, surtout, il a joué avec les gosses parce que c’était ce qu’il préférait. Les gamins avaient tous le même âge que lui, huit, neuf, dix ans. Pas davantage. Il leur a fait des grimaces, montré ses muscles, il a fait du vélo avec eux dans les allées (et l’on se rend compte que, depuis qu’on lui avait piqué le sien, il avait oublié d’en faire).
Il fait beau, ils s’amusent. Ali arbore une chemisette blanche à manches courtes et un nœud papillon saugrenu, le même – déjà – que celui des membres de la Nation of Islam.
Et puis…
Et puis, il s’est assis sur les marches qui mènent au perron. Les vélos sont renversés dans l’herbe, les sept gamins sont autour de lui. Ils ont les mêmes cheveux que lui et à peu près la même coupe, ils gesticulent, ils rigolent… entre eux. Ils ont compris que leur tour est passé, qu’Ali, désormais, ne s’intéresse plus à eux, mais à une petite fille de cinq ans et demi.
Elle est petite, plus petite que le plus petit des garçons, et pourtant c’est elle le centre de l’image.
Et pas seulement de l’image.
Le centre de l’attention d’Ali.
L’une des raisons, la plus surprenante peut-être (mais pas tant que cela, Ali lui-même n’est pas si noir que ça, sa mère encore moins, et il a toujours été plus proche des Blancs qu’il ne le laissait entendre), c’est que la petite fille est claire de peau… presque blanche. Si blanche qu’elle a des taches de rousseur comme il arrive parfois aux Afro-Américains lorsque le blanc est à fleur de leur peau. Ses cheveux ne sont pas lisses, mais ils ne sont pas crépus pour autant, ils bouclent.
Elle s’appelle Yolanda Williams, tout le monde l’appelle Lonnie, sa mère est l’une des meilleures amies d’Odessa Clay. Lonnie a d’abord pleuré quand Ali lui a demandé d’approcher : il a beau lui sourire, il est plutôt impressionnant, ne serait-ce que par sa taille (un mètre 91) et son âge (vingt ans). Elle n’a pas encore six ans, elle porte l’uniforme de son école (une jupe avec des bretelles, un chemisier blanc), mais son geste, les deux bras levés, est celui d’une femme et le regard qu’elle pose sur Ali est – aussi – celui d’une femme, mieux encore, celui de Salomé.
Yolanda Williams dit qu’elle est tombée amoureuse d’Ali à dix-sept ans, mais depuis ce jour où, en face de ce grand jeune homme bientôt champion du monde, elle se tortille en minaudant, elle aura l’œil sur lui. Avant de l’épouser et qu’elle soit sa veuve, il se mariera trois fois. Avec Sonji Roi, la femme pop (celle que je préfère et à qui Alias Ali est dédié), Belinda Boyd, la femme-jumelle dont la ressemblance finit par vous être un reproche, Veronica Porsche, la femme-trophée plus narcissique encore que vous ne l’êtes.
La quatrième sera la « bonne », la femme d’intérieur idéale qui a déclaré un jour : « Maintenant, Muhammad Ali, c’est moi ».
Toute la dernière partie de sa vie, Muhammad Ali a donc été une bourgeoise afro-américaine, diplômée de l’UCLA, religieuse, mais plutôt tolérante, patriote, mais assez libérale sur certains sujets (l’égalité), mais pas tellement sur quantité d’autres (la famille).
Du temps où il était vivant, Ali faisait tout ce qu’il ne fallait pas faire ; du temps où il a été muet, Lonnie lui fera dire tout ce qu’il faut dire.
Il faut que les champions meurent en public au moins une fois (lors de leur dernier combat, souvent une défaite) ; lorsque ce sont de grands champions, on leur permet de mourir une fois supplémentaire (des types avec la gueule cabossée et la cloison nasale de traviole portent le cercueil) ; lorsque ce sont des champions exceptionnels, ils meurent chaque fois qu’on leur demande de le faire. Ainsi a-t-on pu voir Ali, hébété par la maladie de Parkinson, allumer en tremblant la flamme des Jeux olympiques d’Atlanta et de Coca Cola réunis ; le même genre de traîtrise qu’Elvis Presley, raide défoncé, serrant la main de Richard Nixon dans le bureau ovale après lui avoir proposé de lutter contre la drogue et les drogués.
Deux parjures par fidélité à une cause qui les dépasse… les anneaux olympiques, la bannière étoilée !
Deux parjures murés dans leur pyramide.
Le Graceland de Muhammad Ali est situé pas très loin des rives de l’Ohio et de l’Interstate 64.
Le Muhammad Ali Museum a coûté plusieurs millions de dollars financés entre autres par Microsoft, Coca Cola, Lennox Lewis, Delta Airlines, Angelina Jolie, Kodak, la Chase Foundation, la Princesse Haya Bint Al Hussein, General Electric et Adidas… jusqu’à que s’élève, 144 North Sixième rue entre River Road et Main Street, le genre de bâtiment d’un modernisme de bon aloi susceptible d’être détruit sans que personne ne s’en aperçoive. En prévision des foules prévues, l’entrée est de la taille d’un hall d’aéroport. Le guichet d’entrée jouxte la boutique où se vendent les produits dérivés capables de vous transformer en homme-sandwich à des prix défiant toute concurrence.
C’est un musée d’un genre ordinaire aujourd’hui où les musées sont consacrés à tout ce qui est susceptible de se définir comme « culturel » : activités surannées, objets désormais sans emploi, événements historiques oubliés, mais aussi personnages hors du commun dont Muhammad Ali fait, indéniablement, partie.
Une fois sa place payée, il n’y a guère moyen d’échapper au sens obligatoire du parcours. Première station : une employée du musée vous fait prendre la pose devant un fond prévu à cet effet. Si vous restez interloqué, elle mime la pose que vous devez prendre : celle des vieux boxeurs sonnés, celle qu’Ali prenait automatiquement. Le temps de développer le cliché, votre photographie réapparaîtra l’étage au-dessus et l’on vous proposera de l’acheter en différents formats.
Comme chez Walt Disney !
Puisqu’il s’agit avant tout de célébrer un culte et de donner une image d’Ali d’où toute violence est exclue, les informations sont toutes données (en Amérique, on ne ment pas), en glissant sur certaines et en insistant sur les plus édifiantes. L’accent (grave) est mis sur le parcours de celui qui est devenu la figure d’un culte New Age crétin, pour ce faire, les bons sentiments interactifs sont filmés comme un soap opera… flous.
L’intention est affichée sans détours : « promouvoir les valeurs profondes véhiculées par Ali : la paix, l’engagement social, le respect et le développement personnel », et célébrer son influence universelle. Le but avéré étant de communiquer ces valeurs au public.
Au quatrième étage, on vous propose de trouver votre voie comme Ali a trouvé la sienne (« Lighting the Way »), de découvrir vos forces personnelles (« Walk with Ali »), et l’on termine par un Mur de l’espoir et du rêve (« Global Voices ») : 5 000 dessins d’enfants de 141 pays.
Au cinquième, vous pouvez lire quelques poésies d’Ali, prendre connaissance des idéaux qui resteront comme son héritage : « respect, confiance en soi, conviction, générosité et spiritualité ».
Il manque à tout cela l’électricité, la foule, le bruit, l’odeur, la passion, l’excès.
Le grand absent, c’est Ali lui-même.
Avoir un musée de son vivant, c’est mourir un peu, le risque encouru : y être enterré de son vivant.
Ce qui ne manque pas.
Pour écrire sa « biographie » (il n’a même pas lu celle écrite en son nom par Richard Durham), j’ai passé pas mal de temps avec Ali, j’ai lu à peu près tout ce qui a été écrit sur lui, j’ai longtemps craint qu’il meure lorsque j’aurais fini de l’écrire, et retardé d’autant sa publication. Cela ne me confère aucune légitimité, mais lorsqu’il a fallu choisir, j’ai choisi de ne rien écrire sur les années où il n’allait faire que survivre. Sa fin, qui allait durer plus de trente ans, j’ai décidé de l’ignorer.
Souffrant, pourtant, Ali aurait pu m’intéresser. Qu’il n’ait pu presque plus parler, que son corps glorieux n’ait plus été qu’un lointain souvenir, que sa parole si vive ait été désormais empêchée, que son regard ne se soit plus éclairé que rarement, que ce qui lui est arrivé soit en réalité si tragique qu’il est possible, sans beaucoup d’effets, de tirer au lecteur des torrents de larmes…
Cry me a river
Cry me a river
I cried a river
Over you
Que ce qui lui est arrivé : mourir au ralenti devant nous tous, soit si humain que cela nous concerne tous et devrait tous nous intéresser.
Certes, mais…
Si Ali prisonnier de Parkinson m’intéresse et m’émeut, Ali n’était pas seulement prisonnier de Parkinson.
Ali était essentiellement prisonnier de Lonnie.
La prison parfois protège, la prison parfois épargne.
Lonnie a protégé Ali de tout ce qui pouvait lui arriver de mal, elle lui a épargné le reste, comme une mère interdit les mauvaises fréquentations à ses enfants… alors ses copains (les sales types et les dingues) ont disparu et les filles ont cessé d’attendre sagement leur tour dans les couloirs des motels.
Les comptes ont été tenus à jour, il n’a plus été question de balancer l’argent par les fenêtres, mais de faire prospérer une image noyée dans les bons sentiments et le politiquement correct. D’un has been un peu sonné qui répondait présent chaque fois qu’un producteur télé lui proposait de venir faire le pitre, elle a fait un Bouddah bienveillant.
C’est un chef-d’œuvre, mais c’est un chef-d’œuvre commercial.
Adieu la jeunesse ! Adieu la folie ! Adieu la vie !
Les derniers temps, Ali regardait toute la journée les vidéos de ses anciens combats. Il regardait donc défiler sa vie toute la journée et, de temps en temps, il se tournait vers Lonnie (la seule à le comprendre encore) qui ne le quittait pas des yeux et il lui demandait : « J’étais dingue, non ? », elle lui répondait : « Oui ».
Et maintenant ?
Maintenant, Muhammad Ali n’est plus fou, il est MORT.
Comme presque tous ses adversaires et l’idée qu’un autre monde est possible.
Texte publié par l’Equipe Magazine
le 11 juin 2016
La phrase de Oates a sauté.
Pour le reste, si on est atttentif,
on peut remarquer que ce texte est un mix.
TYSON
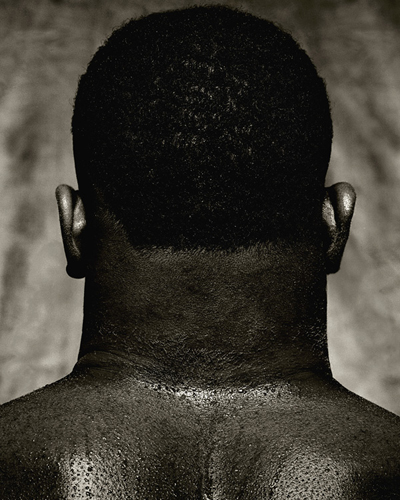
Que la bête meure !
Le vieil homme est penché sur le jeune garçon endormi. Il le secoue et lui demande : « Quelle est ta meilleure amie ? ». Avant que le jeune garçon n’ait pu lui répondre, le vieil homme poursuit : « C’est la peur ! La peur, c’est comme un copain qui pue mais qui te sauve de la noyade ».
Le vieil homme s’appelle Constantine d’Amato, il a été le manager et l’entraîneur de deux champions du monde ; il a décidé que le jeune garçon qu’il réveille en sursaut la nuit pour lui parler de la peur serait le troisième, il s’appelle Mike Tyson.
Lorsque d’Amato faisait de la peur le centre de gravité de son « système », il savait de quoi il parlait : il avait peur des ascenseurs, des tunnels, de l’eau, de la foudre et des éclairs, et planquait un fusil personne ne savait trop où, mais tout le monde savait, en revanche, qu’il était capable de s’en servir.
Un type bizarre d’Amato… borgne, paranoïaque, mystique, un pic à glace dans la poche, au cas où… Qui s’est battu dans les années 50 contre la mainmise de Franck Carbo et consorts sur la boxe, lecteur de Thoreau et du Traité du Zen et du tir à l’arc pour tout simplifier.
En ce qui concerne Tyson, c’est aussi pittoresque : son père l’a abandonné, sa mère vit avec un autre homme. Il grandit dans un coin de Brooklyn où les jeunes Noirs se battent entre eux comme des chiens dans l’arrière-cour de chez Fido. Tout le monde se moque de lui et de sa petite voix, il n’a qu’une seule passion : regarder voler ses pigeons, jusqu’à ce qu’un gamin torde le cou à l’un d’entre eux et que Mike l’assomme. Sa voie est désormais tracée. A treize ans il a été arrêté 38 fois et a épuisé la patience des travailleurs sociaux. Pas tout à fait six pieds, presque cent kilos, élevé à la farine et aux oreilles de porc, il est bâti comme tous les psychopathes grandis à Bedford-Stuyvesant : pour tuer et être tué.
Et puis… Miracle ! Enfermé dans une maison de correction, Tyson y rencontre Bobby Stewart, un ancien boxeur. Etonné par la volonté du garçon et surtout par son crochet du gauche qui l’oblige à garder, en cachette, la chambre le week-end, il le présente à d’Amato qui vit à quelques encablures. Pris en charge par les entraîneurs-maison, le jeune Tyson va devenir une terreur chez les amateurs. Lorsque sa mère mourra, d’Amato deviendra son tuteur légal, Mike passera professionnel et deviendra le plus jeune champion du monde poids lourd de l’histoire, quelque temps après la mort de Cus. Un scénario que Stallone se refuserait à signer.
En réalité, lorsque l’on a quatorze ans, il n’est pas très bon d’être réveillé au beau milieu de la nuit par un vieux fou qui n’a qu’une idée en tête : faire de vous le dernier champion qu’il a toujours rêvé fabriquer, pour s’entendre demander : “Quelle est ta meilleure amie ?” On n’a rien trouvé de mieux, jusqu’à présent, pour devenir un homme qu’un père qui vous ramène à l’école à coups de pied dans le cul et une mère qui vous aime ; à défaut, quelqu’un qui puisse faire passer ce que vous devez être avant ce qu’il faut que vous soyez. Et dormir douze heures.
D’Amato couvrira toujours Mike : lorsqu’il ne foutra rien en classe, qu’il brutalisera ses petits copains. Lorsque Teddy Atlas le menacera avec un flingue parce qu’il a tripoté sa nièce de force, d’Amato se séparera de lui ; il paiera même pour que les exploits du jeune Tyson ne viennent pas contrarier sa gloire future et s’écrasera quand il le faudra. C’était ça ou faire de Tyson un bon garçon et d’Amato ne voulait pas faire de Tyson un bon garçon, il voulait en faire le champion du monde des poids lourds, le plus dangereux de tous, et pour cela il avait besoin de sa haine et de sa frustration. C’est ce qui est mauvais en Tyson qui fait de lui un si bon boxeur. C’est ce qui est mauvais en Tyson qui rapporte des millions de dollars.
Cus ne verra pas son rêve se réaliser. Il est mort depuis plus d’un an lorsque Tyson devient le plus jeune champion du monde poids lourd de tous les temps. Il ne verra pas non plus la suite qui aurait pu le faire douter du bien-fondé de sa méthode… Bruits et confusion… vacarme médiatique sur fond de sexe, drogue et rap’n’roll… suicide supposé… obscures palinodies… millions de dollars… Rolls et B.M.W. embouties… félonies… ramponneaux pay-per-view et millions de dollars encore ; pour culminer, comme dans tout mélo bien foutu sur : un divorce, une défaite inattendue contre un obscur challenger et une condamnation à six ans de prison pour viol.
Moisira trois ans au purgatoire (Plainsfields, Indiana) une victime, orphelin mal-aimé, manipulé, dressé pour tuer, alcoolique, vérolé, maniaco-dépressif, qui continue à ne pas comprendre la différence entre le Bien et le Mal, le rêve et la réalité, à dire n’importe quoi et son contraire au gré des interviews ; qui lit, soi-disant, Victor Hugo et Dostoïewski ; qui se convertit à l’Islam et téléphone à longueur de journées à M.C Hammer, Shaquille O’Neal et aux quelques hommes d’affaires qui attendent impatiemment sa sortie. La plus formidable planche à billets de ces dernières années moisira trente six mois dans un coin perdu de l’Indiana… Un billion de dollars de bénéfice, s’il faut en croire les informations les plus sérieuses à ce sujet, dont pas mal ont atterri dans la poche de son promoteur, Don King, connu sous toutes les latitudes pour son honnêteté scrupuleuse, et dans celles des dirigeants médiatiques chargés d’entretenir la légende selon laquelle tout représentant du quart-monde, pourvu qu’il soit doté d’une droite foudroyante, peut s’asseoir à la gauche de Bill Gates.
Comme un soap-opera se doit de ne jamais avoir de fin et qu’il n’est pas réellement envisageable que le monde du spectacle se prive d’une telle attraction, Mike Tyson, libéré pour bonne conduite, sortira du pénitencier après avoir purgé la moitié de sa peine ; attendu à ses portes par tout ce que le boxing-business compte de limousines, de gourous, de gangsters, de caméras, de bras cassés décorés de gourmettes 18 carats, et de deals fabuleux. On en oublie même, définitivement, Desiree Washington, l’emmerdeuse responsable du manque à gagner qui soigne au fin fond du Rhode-Island sa dépression et les deux maladies vénériennes dont lui a fait cadeau le héros du ghetto une nuit à Indianapolis. Les choses sensées peuvent reprendre leur cours, Tyson devenu entre temps Abdul Aziz signe un contrat fabuleux avec le MGM de Las Vegas (et Don King) pour ses six prochains combats et retrouve ses occupations préférées : le massacre systématique de ses sparring-partners à 2000 dollars la semaine et le shopping dans le centre commercial le plus proche de son domicile avec sortie sous les applaudissements du personnel, comme il est d’usage… Pour leur part, les frères musulmans trop heureux de la spectaculaire conversion de ce généreux gogo, transforment en location de houris à la peau couleur banane les chèques qu’Abdul Aziz signe pour construire des mosquées. Pour Allah, on verra plus tard !
Le film tiré de sa vie captive la ménagère de plus de cinquante ans ; les intellectuels s’interrogent sur la boxe devenue mythologie de notre temps, les effets comparés de la coke et du KO ; les spécialistes tirent des plans sur la comète : Abdul Aziz sera-t-il l’égal de Tyson ? À près de trente ans un boxeur peut-il garder intactes les qualités qui ont fait sa force dix ans plus tôt ? Ce sont des préoccupations un peu simples, des interrogations un peu courtes. Les organisateurs, eux, se frottent les mains, à Las Vegas on astique les bandits manchots, les télévisions subodorent les profits fabuleux possibles, les annonceurs raclent les fonds de tiroir. Les journalistes et les medias se font l’écho complaisant de ce Barnum glauque. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles.
Il faut bien s’imaginer, qu’aux Etats-Unis, le champion du monde des poids lourds pèse symboliquement autant que le Président lui-même et davantage que le Pape. Le destin d’Abdul Aziz est donc lié à l’histoire américaine et le constat ne laisse pas d’être inquiétant. On peut certes voir la saga de Tyson comme celle de l’ascension, de la chute et de la rédemption toujours remise au lendemain d’un jeune homme sorti du ghetto et que le ghetto n’a pas quitté, mais il ne faut pas oublier que, depuis qu’il est devenu, sans y être aucunement préparé, un modèle, sa seule vérité est celle du capitalisme d’aujourd’hui et du spectacle sportif dans tout ce qu’il peut avoir de plus horrible ; celle des télévisions câblées qui programmeraient des “snuff-movies” si cela faisait de l’audience. Mike Tyson ne s’appartient plus, il est devenu une fiction, un phantasme, un mythe.
La fin de tout ça pourrait bien avoir eu lieu dans la nuit du dimanche 29 juin 1997 à Las Vegas. Rendu enragé par les coups de tête (pas si innocents que cela) d’Evander Holyfield, aveuglé par son sang et vaguement conscient que cette fois encore il allait y avoir droit, l’esclave le mieux payé de la planète s’est transformé en direct en chien enragé, crachant sur le ring l’oreille de son adversaire.
Nous venons, peut-être, d’assister là à l’ouverture d’une nouvelle ère ou des cruautés supplémentaires, plus jouissives puisqu’interdites, seront ajoutées pour les pimenter à celles, jusqu’à présent, considérées comme suffisantes sur un ring. On pourrait voir cela, aussi, comme la fin définitive des années 80 de sinistre mémoire et de leur champion emblématique, celles des “serial-killers” et des “golden-boys” ; ce serait oublier un peu vite qu’elles ont vu la naissance du succès du “pay per view” et que celui-ci ne se dément pas. Il s’en irait temps, surtout, d’examiner les responsabilités de chacun dans cette affaire qui, après tout, nous fait plutôt bander. De ne pas s’en laver les mains. Mike Tyson n’est pas devenu fou, il n’a pas fondu les fusibles, il ne s’est pas mis, de son propre chef, dans de sales draps comme on voudrait nous le faire croire pour que nous en soyons innocents. Mike Tyson est fou, il l’a toujours été, personne ne l’a suffisamment aimé pour l’empêcher de l’être. C’était cela qui nous plaisait. C’est pour cela qu’il était payé.
Il est trop facile de faire de la morale a posteriori alors que l’on a soutenu sans ciller l’immoralité lorsqu’elle crevait les yeux, parce qu’elle était raisonnablement envisageable puisqu’elle créait des richesses sans fin ; de sacrifier celui qui a toujours consciencieusement rempli le rôle de bouc émissaire sur l’autel de notre bonne conscience. Qui n’a pas frissonné en voyant la garde noire de Tyson à la sortie de son vestiaire ? Et de quels recoins pas très reluisants de notre inconscient viennent ces frissons ?
Lorsque le miroir nous montre la fange, il est facile d’accuser le miroir. Et Tyson est le miroir dans lequel il faut nous regarder. Chacun est complice de ce qu’un champion soit devenu, en direct, aussi incontrôlable qu’un pit-bull que la seule solution humaine aurait été d’abattre sur place. Tout le monde voulait cela : d’Amato, Jimmy Jacobs et Bill Cayton, Don King, Robin Givens, Donald Trump, John Horne et Rory Holloway, Muhammad Sadeek, Richie Giachetti et Charles Bietry, tous les medias qui se faisaient l’écho complaisant de cette folie qui n’est pas celle de Tyson, mais la nôtre. Celle que nous méritons, pour laquelle nous payons notre abonnement aux chaînes cryptées et dont personne ne nous absoudra.
Ce que l’on voudrait maintenant c’est que la bête meure. Nos désirs sont des ordres, ils seront exaucés. L’un des “psychologues” qui veulent le bonheur de Tyson que l’on reconnaît à son treillis et à son air bienveillant est chargé de lui hurler avant ses combats : “L’exécution sera télévisée !” Ce serait le plus rentable. Ce serait donc le mieux.
Rape rap
Tous les matins Mike Tyson, ancien champion du monde des poids lourds, se lève à 4 heures, le reste de la journée, il lit, fait un peu de gym, prie beaucoup (5 fois) et s’ennuie énormément. Il purge une peine de six ans de prison pour viol à l’Indiana Youth Center. Par le jeu des remises de peine il pourrait être libéré en mai 1995. Tout le « Boxing business », à qui il a fait gagner des centaines de millions de dollars, attend sa sortie avec impatience, il est déjà classé n° 1 par la WBC, l’un des nombreux organismes qui régit la boxe professionnelle, chasse gardée de Don King son promoteur. Comme il ne sait rien faire d’autre, on suppose que Tyson ne pourra que boxer de nouveau, les sommes prévues pour son premier championnat du monde sont de l’ordre du budget annuel d’un état africain de moyenne importance.
Pour imaginer ce que peut représenter aux USA un champion du monde des poids lourds en prison, il faudrait imaginer le Pape en cabane à Rome, ou quelque chose d’approchant. La chose revêt une telle importance, la perversité des médias et les intérêts financiers y sont si intimement mêlés que, depuis quelque temps, l’opinion — qui ne doutait pas réellement de sa culpabilité au moment du procès — s’est renversée et qu’à peu près tout le monde a rejoint le camp de ceux qui ont toujours vu en Mike Tyson le bouc émissaire d’une justice volontiers raciste. On n’hésite pas, pour ce faire, à réécrire l’histoire et à oublier que pour un viol il faut être au moins deux et qu’il existait jusqu’alors une victime, noire de surcroît : Désirée Washington.
En France, soit parce que les conditions de l’accusation ont toujours semblé étranges, soit parce que la façon dont la justice américaine fonctionne nous est mal connue, ou pour d’autres raisons moins avouables, Tyson est toujours apparu comme l’innocente victime d’une hystérique perverse et d’une juge bornée. Les faits sont en réalité très différents de ceux qui nous ont été partiellement rapportés et même si cela doit mettre à mal quelques uns de nos préjugés sur des phénomènes que nous connaissons mal, comme le fameux « politically correct » dans lequel on fourre tout et n’importe quoi, il est temps de les réexaminer avec un peu plus d’objectivité.
Le 17 juillet 1991, Mike Tyson, 36.000 dollars en cash dans les poches, débarque à l’aéroport d’Indianapolis avec son garde du corps, Dale Edwards, un ancien flic de Cleveland. Il s’est enfilé de la bière et du rhum toute la journée pour faire passer les anti-dépresseurs qu’il absorbe régulièrement et dont il contrarie les effets en prenant des amphétamines. Il pue tellement de la gueule que l’équipage de l’avion s’en souvient encore. A l’aéroport, une limousine les attend, conduite par Virginia Foster, 44 ans, qui sera chargée de le conduire durant les 48 heures qu’il doit passer à Indianapolis pour assister à un concours de beauté : Miss Black America. Pendant ces deux jours Tyson lui proposera la botte à plusieurs reprises, essaiera de soulever ses jupes, vantera la taille de son engin, seule l’intervention de Dale Edwards la fera échapper à un viol en règle. Dans ce domaine, Tyson n’en est pas réellement à son coup d’essai, il a été impliqué dans bon nombre d’affaires semblables depuis son plus jeune âge et si elles se sont toutes réglées « à l’amiable » c’est que son entourage a toujours su y mettre le prix.
Mike Tyson se fait conduire à l’Holiday Inn où l’attend sa copine du moment, la chanteuse de rap Angie B. Ils s’enferment dans sa chambre pendant cinq heures au cours desquelles ils font plusieurs fois l’amour. Tournée des boîtes, bière, champagne, retour à l’Holiday Inn, sexe. Quand il rentre au Canterbury où il doit loger pendant son séjour, il n’a pas dormi depuis 24 heures. Les 25 concurrentes de Miss Black America l’attendent.
Désirée Washington vient d’avoir 18 ans, elle se trimballe partout avec l’appareil photo que son père, grand fan de Tyson, lui a prêté pour immortaliser les rencontres qu’elle ne manquera pas de faire. Elle vient de Coventry, au collège elle est le chouchou de tous les profs, membre de toutes les associations caritatives que l’on peut imaginer dans le Rhode-Island. Elle sourit tout le temps, n’arrête pas de jacasser. Une dinde. Les autres concurrentes remarqueront qu’elle monte se changer dans sa chambre entre les différents passages. Sur la table de chevet, elle a disposé la photo de son père et de sa mère et des jouets en peluche. Une cruche. Elle fatigue tout le monde en racontant le voyage en Russie qu’elle a fait l’année précédente. Une emmerdeuse.
Tyson porte un badge sur lequel on peut lire : « Together in Christ », il esquisse quelques pas de danse, titube, marmonne un rap, les concurrentes rigolent et se foutent un peu de sa gueule. Son premier contact avec Désirée Washington dure quelques minutes seulement, il lui dit qu’elle est une « jolie petite chrétienne » et lui propose un rencard. Il affirmera plus tard avoir été plus direct et lui avoir dit : « J’aimerais te baiser », ce à quoi elle aurait répondu : « OK !” ce qui semble être tout à fait son genre. Cinq témoins affirmeront le contraire, Désirée se contentera de lui répondre qu’elle est à l’hôtel et qu’elle veut bien aller faire un tour avec lui. Tyson quitte le concours pour se rendre à une réception où son comportement est si étrange que le révérend Jesse Jackson demandera qu’on le foute dehors. Il rentre à son hôtel à 1 heure et demie du matin, depuis la limousine il téléphone à Désirée Washington pour lui proposer d’aller faire un tour et de rencontrer quelques célébrités. Elle dormait, mais après quelques minutes durant lesquelles Tyson insiste de la petite voix douce qu’on lui connaît, elle se laisse convaincre. Elle a ses règles et porte un pyjama à pois rouges. Les filles qui partagent sa chambre refusent de l’accompagner, elle saute partout, enfile un short par dessus son harnachement pas vraiment sexy, se remaquille en vitesse et n’oublie surtout pas son appareil pour photographier les stars.
Mike et Désirée ne resteront que quelques minutes dans la limousine, il essaie de l’embrasser, elle se dégage, il refoule toujours autant du goulot. Très vite, Tyson lui dit qu’il faut qu’il aille relever ses messages à son hôtel, elle le suit, dans l’ascenseur, elle lui demande avec qui ils vont passer la soirée et si elle pourra prendre des photos. A partir de ce moment, seules deux personnes savent ce qui s’est réellement passé, Désirée Washington soutient qu’elle a été violée, Mike Tyson qu’ils ont fait l’amour le plus normalement du monde.
Un employé de l’hôtel la verra sortir de la chambre 606, ses souliers à la main, l’air visiblement choquée; dans la limousine qui la ramène à son hôtel, Virginia Foster l’entendra répéter à plusieurs reprises : « Pour qui se prend-t-il ? Comment a-t-il pu me faire une chose pareille ? » Le lendemain, elle ne peut pas parler, elle s’évanouit à plusieurs reprises et finit par avouer en pleurant qu’elle a été violée. Elle est examinée par un gynécologue qui note deux « abrasions » importantes au niveau du vagin — lésions ne survenant que lors de rapports sexuels non librement consentis. Entretemps Mike Tyson a quitté Indianapolis, une femme de ménage de l’hôtel Canterbury a changé les draps tachés de sang de la 606.
L’affaire Tyson commence et l’on peut déduire de ce qui précède qu’elle était mal emmanchée pour le champion, d’autant plus que, contrairement à lui, Désirée Washington et ses témoins ne reviendront jamais sur leurs déclarations qui concordent toutes. Reste néanmoins l’objection majuscule que feront spontanément les supporters du boxeur et sur laquelle, assez stupidement, le cabinet d’avocats engagé à coups de millions de dollars pour assurer la défense du boxeur allait axer tout son système de défense : Désirée Washington a suivi Mike Tyson dans sa chambre de son plein gré, c’est un type dangereux, elle devait donc s’attendre à ce qui lui est arrivé. J. Gregory Garrison, l’avocat de Désirée, eut beau jeu de faire remarquer qu’en déclarant cela on prenait le problème rigoureusement à l’envers, qu’au lieu de faire le procès de l’agresseur, on faisait celui de la victime, que la naïveté n’était pas considérée comme un crime contrairement au viol… si une victime savait, elle ne serait jamais victime. Il a donc laissé la défense s’enfoncer dans une description apocalyptique de Tyson, hélas pas très éloignée de la réalité que Désirée Washington n’aurait pas dû ignorer, alors même qu’elle l’était d’amateurs éclairés. Au lieu d’impressionner favorablement les jurés, ce système de défense allait conduire à la perte du champion qui, de plus en plus visiblement, ne pouvait être que l’agresseur aux yeux des 12 jurés qui le déclarèrent coupable à l’unanimité.
Le viol est certainement l’un des crimes qui déclenche le plus de réactions irrationnelles et, en chacun d’entre nous, il y a enfoui au creux du cerveau reptilien la mauvaise pensée suivante : « Si ça lui est arrivé, c’est qu’elle l’a bien cherché ! » Paradoxalement ce sont les femmes qui l’utilisent le plus fréquemment pour se défendre… « Si elle l’a cherché c’est qu’il ne peut rien m’arriver. » On essaie donc toujours d’expliquer le comportement de l’agresseur par une quelconque provocation de la victime, jupe trop courte, soutien-gorge pigeonnant ou par le fait que sa clairvoyance aurait dû lui interdire de se trouver en tel lieu, en telle situation ou en telle compagnie. Si l’on pousse ce raisonnement jusqu’à l’absurde, ce dont les tribunaux ne se privent pas toujours, il est rigoureusement impossible de violer : une pute, une salope, une jolie fille, sa femme, quiconque s’approche d’un violeur à moins d’une distance réglementaire qui n’est pas encore clairement établie, une femme seule et bien sûr, à plus forte raison, une petite dinde de 18 ans qui accepte d’accompagner une vedette dont son père est un fidèle supporter dans sa chambre d’hôtel, avant d’aller faire la tournée des grands ducs.
C’est à la fois manquer de la plus élémentaire considération envers la victime et oublier l’un des acquis des années 70, pas encore admis, il est vrai, par le machisme en usage dans les vestiaires sportifs : « Quand une femme dit non, c’est non ! » Il s’agit toujours en tous les cas de refuser d’examiner les faits avec le peu de bienveillance et d’objectivité dont chacun d’entre nous est capable. Ne parlons pas de charité, Patrick Besson, dont il sera question plus avant, éclaterait de rire.
Quoi qu’il en soit, comprenant qu’il avait fait fausse route, le clan Tyson, qui voyait s’éloigner pour plusieurs années la plus formidable machine à faire du fric jamais imaginée, allait changer de tactique et demander la révision du procès. Pour ce faire on engage, grâce à quelques millions de dollars supplémentaires, Alan Dershowitz, l’un des avocats les plus célèbres des Etats-Unis, surtout connu pour avoir fait acquitter Claus Von Bulow qui n’était pas particulièrement sympathique. Dershowitz allait porter son argumentation sur : la personnalité de Désirée Washington et celle de ses parents, l’attitude du juge et le témoignage de dernière minute de trois jeunes femmes qui déclaraient avoir vu les deux jeunes gens flirter sur le siège arrière de la limousine devant l’hôtel. Passons sur ce dernier, hormis qu’il est pratiquement impossible d’apercevoir quelque chose au travers des vitres d’une limousine, aurait-on le nez collé dessus, il est en totale contradiction avec le témoignage particulièrement fiable du chauffeur de la limousine dont les trois jeunes femmes seront incapables de se rappeler la couleur.
La chasse aux vedettes est certes l’un des exercices favoris de la femelle américaine, Tyson en a été lui même la victime lorsqu’il a dû abandonner des millions de dollars durement gagnés sur le ring à son ex-épouse, Robin Givens et à sa redoutable belle-mère, Ruth Roper ; Désirée Washington n’aurait donc été qu’une « chercheuse d’or », comme on les appelle. Manque de pot il se trouve que la donzelle n’a donné qu’une seule interview pour laquelle elle a refusé les 75.000 dollars qui lui étaient proposés, qu’elle a également refusé de vendre son histoire pour 500.000 dollars. Le cabinet Dershowitz aurait bien dû se douter qu’il n’y avait pas grand-chose à espérer de ce côté là, Désirée avait refusé la modique somme de 1 million de dollars offerte par le Révérend T. J. Jemison pour retirer sa plainte. L’église du Révérend Jemison est financée en grande partie par Don King, mais il ne faut, bien sûr, y voir qu’une coïncidence. Qu’à cela ne tienne les fouille-merde du cabinet new-yorkais allaient déterrer une histoire entre Désirée et son père : à 15 ans elle aurait déjà accusé de viol un de ses copains de lycée et Papa Washington avait poussé une crise, l’histoire se dégonflera comme les autres, mais sera relayée par des rumeurs du même ordre, toutes plus invérifiables les unes que les autres. Comme Désirée Washington et sa famille s’acharnaient, contre toute attente, à présenter tous les signes de l’irréprochabilité, Dershowitz allait se rabattre sur l’attitude du juge, Patricia J. Gifford, or tout le monde s’accorde à dire que la façon dont la juge a mené les débats a toujours été, elle aussi, irréprochable. Raté sur toute la ligne…
On aurait pu croire que la messe était dite, l’affaire définitivement classée et qu’il ne restait plus pour les tabloïds qu’à s’intéresser à O.J. Simpson, et à Désirée Washington à soigner les deux maladies vénériennes dont le champion lui avait fait cadeau. Que dalle ! Que la vérité soit connue ne suffit pas, encore faut-il qu’elle soit crue et beaucoup d’intérêts s’y opposent parfois, nous en avons, en France, des exemples récents. Pour que la vérité sur l’affaire Tyson soit crue il faudrait que chacun d’entre nous renonce, serait-ce inconsciemment, à soupçonner Désirée Washington de l’avoir bien cherché et à en jouir. Et, depuis Farrakhan, activiste musulman célèbre pour ses déclarations antisémites jusqu’à Muhammad Sideq, le nouveau mentor de Tyson désormais converti à l’Islam par ses soins, en passant par tous les commentateurs sportifs de la planète, personne ne se prive de cet argument qui n’est en réalité qu’une opinion. Ce qui est plus gênant, mais aussi plus éclairant, c’est lorsque cette opinion qui les vaut toutes et qui n’a pas grand poids, lorsqu’on la confronte aux faits, se découvre imprudemment et que, sous la plume de Patrick Besson par exemple, elle glisse vers des zones plus nauséabondes.
Dans un petit bouquin, le Viol de Mike Tyson, brillamment bâclé, comme à son habitude, Patrick Besson, entre quelques déconnages hussards et quelques informations de troisième main, avance le raisonnement suivant : Tyson est innocent parce qu’il est coupable, coupable parce qu’innocent, etc… S’apercevant que ces sophismes en miroir ne sont pas des plus crédibles, Besson finit par affirmer ce par quoi il aurait dû commencer : Tyson est un héros, un héros est au dessus des lois, il avait donc le droit de violer Désirée Washington et il a eu raison de le faire, il est bien plus héros comme ça. On comprend bien que lorsque l’on est un frêle écrivain avec de grosses lunettes on a une certaine propension à s’identifier à une brute nègre, seulement on ne convoque pas, pour réaliser ses phantasmes, les faits ou les grandes idées sur lesquelles on vomit. Lorsque Besson écrit que la brutalité est une valeur, ce qui est idéologiquement assez clair ; c’est une déclaration « anti-civilisation » pas très audacieuse de la part d’un écrivain à lunettes qui ne fréquente pas des masses les brutes nègres susceptibles de les lui casser, mais on peut apprécier la provocation qui en vaut une autre et même y souscrire pourvu que ce soit sans risque. Lorsque l’on est une fille et que l’on pèse 45 kilos, le Droit n’est pas mal non plus et la Justice et la Civilisation qui sont faits pour les jeunes filles de 45 kilos et les gringalets qui se sont fait casser leurs lunettes. Et, après tout, si l’on se sert de sa faiblesse comme d’une arme cela n’est pas si mal joué dans une logique qui ne conçoit les rapports humains que sous la forme de deux forces qui s’affrontent. Dans le même registre délirant — Tyson est le Bien/Tyson est le Mal, le pompon revient tout de même à Ferdie Pacheco, qui, dans le numéro de septembre de Boxing Illustrated, voit dans Tyson rien moins que la figure du Christ. Il faudra bien que ces éternels adorateurs se rendent compte que la Justice n’est pas faite pour assurer le service après-vente de leurs héros, mais qu’en revanche leurs opinions servent à merveille les intérêts de ceux qui ne font que regretter le manque à gagner.
Lorsque je me suis rendu cet été à New York en vue d’écrire une biographie de Tyson (qui est beaucoup plus intéressant comme individu et phénomène social que comme mythe), j’ai eu l’occasion de m’apercevoir que la frontière entre ceux qui le pensent coupable et ceux qui le décrètent innocent était d’un tracé bizarre. J’ai rencontré Bert Randolph Sugar, rédacteur en chef de Boxing Illustrated, chez Gallagher’s où les entrecôtes aussi épaisses que les œuvres complètes de Patrick Besson sont alignées dans l’entrée derrière une vitre comme les volumes d’une bibliothèque universitaire. Bert Sugar, qui est une véritable bible de la boxe, unanimement respecté dans le milieu, est atteint du syndrome macho-Hemingway à tel point que l’on se demande si, pendant qu’il s’envoie bière sur vodka, il ne va pas, entre deux voyages aux toilettes, poser ses couilles sur la table. Lorsque la question de la culpabilité de Tyson viendra sur le tapis il affirmera nettement : « Bien sûr que ce fils de pute est coupable ! » Je n’aurai même pas besoin de poser la question à Martine Barrat, une photographe française, pleine de sensibilité, qui travaille depuis près de 20 ans à Harlem, auteur de Do or die, pour qu’elle me déclare : « Cette salope a brisé sa vie ».
En réalité, tout le monde trouve que la comédie des poids lourds sans Tyson, ça commence à bien faire, l’un des champions en titre, Oliver McCall était son sparring-partner, l’autre, Georges Foreman pourrait être son père. Tout le « boxing-business » pense que Désirée Washington et son amour-propre mal placé privent l’humanité entière du spectacle du plus spectaculaire boxeur de ces dernières années, qu’elle est au moins coupable de cela et que ça vaut bien, en terme de spectacle, un viol vaseux dans une chambre d’hôtel à Indianapolis. On lui en veut de ça plus que l’on n’en veut à Robin Givens, garce patentée mais du show-bizz, qui donc faisait tourner la machine, on lui en veut d’empêcher la terre de tourner et les dollars de circuler. C’est un reproche de poids.
De Tyson, d’ailleurs, on se fout un peu. De l’homme Tyson dont on ne s’est jamais préoccupé de savoir s’il allait très bien, puisque le fait qu’il aille mal était la garantie de voir sur le ring un combattant à nul autre pareil. Le boxeur qu’il doit redevenir, comme c’est un sacré capital, on s’en occupe comme d’un investissement qui dort depuis trois ans à l’ombre. Faut pas qu’il déconne ! Voyez pas qu’il ne veuille pas remettre ça ? Se battre… se faire vider les poches ! Dans tous les médias sportifs et autres les observateurs s’interrogent d’un air docte sur sa forme actuelle, sa motivation présumée, le fait qu’il n’ait pas mis les gants depuis trois ans, désappris les coups (pas sûr !), que son style basé sur une phénoménale rapidité et une force explosive exceptionnelle puisse difficilement être adopté par un boxeur qui aura trente ans la prochaine fois qu’il remontera sur un ring.
S’il faut en croire sa dernière apparition télévisée (le 12 novembre sur Canal +), ceux qui comptent sur lui pour réamorcer la pompe à phynances et renflouer leur compte en banque copieusement garni ont du mauvais sang à se faire. L’ex-plus jeune champion du monde toutes catégories confondues y apparaissait amaigri, vieilli, mais surtout comme dépourvu de sa légendaire agressivité, comme brisé. Encore s’agit-il d’évaluer les raisons de cette cassure : anti-dépresseurs ou pire encore et d’examiner sa réalité même : tout cela n’est-il pas qu’un mensonge savamment élaboré ? Ne jamais oublier que Tyson a toujours été « fragile », qu’on a imposé à sa vie une tension telle qu’il est toujours au bord de la rupture. Quoi qu’il en soit, aux questions volontairement banales, pour ne pas dire plus, de Charles Biétry — le combat de rentrée de Tyson sera diffusé sur Canal + et il ne faut donc pas compromettre ses chances de sortie —, Mike répondait par « oui » ou par « non ». Lorsqu’il se hasardait à articuler une phrase entière on était frappé par le désenchantement du propos, un désenchantement proche de la mélancolie. Et l’on peut craindre les risques que courrait un boxeur mélancolique confronté à un autre qui ne l’est pas. Peut-être aussi que tout cela n’est que dissimulation, il ne faut pas oublier que, comme le disait José Torres, le second champion du monde « Made in d’Amato » : « Un boxeur est un menteur ». Le plus important pour Tyson est de faire ce qu’on lui demande, de sortir, ensuite… on verra bien. La vengeance est un plat qui se mange froid. A plusieurs reprises le regard de Tyson se rétablit et ce que l’on voit briller au fond de ses yeux n’est pas vraiment rassurant.
Peut-être que c’était le juge Gifford qui tenait le bon bout lorsqu’elle insistait pour que Tyson avoue enfin, qu’il s’excuse. Peut-être que ce que l’on a interprété comme un entêtement buté à vouloir casser la volonté d’Iron Mike était le seul geste humain envers lui depuis longtemps, celui qui veut délivrer un coupable de ses démons. Seulement Tyson vient du ghetto, il n’en est même jamais sorti et dans le ghetto on apprend à toujours nier, même l’évidence, et à ne jamais s’excuser.
D’autres démons hantent les nuits de Désirée Washington, elle pleure et se réfugie dans les bras de sa mère, mais les démons de Coventry n’intéressent personne. Pour ceux qui refusent de croire à leur existence ce sont les démons habituels qui viennent hanter, quelquefois leur vie durant, les victimes d’un viol.
Le grand bœuf blanc
Comme boxeur, il n’est pas très connu, et pourtant, le 19 août prochain au M.G.M. de Las Vegas, il aura l’honneur de servir de sparring-partner au boxeur le plus célèbre du monde, Mike Tyson “himself” : la terreur des rings, des chambres d’hôtels et des centres commerciaux ; l’ex-plus jeune champion du monde des poids lourds, dont le retour est attendu comme celui du Messie par tout ce que la planète compte de câbles et de paraboles. Il n’est pas même, le pauvre Peter, le plus connu des McNeeley, son grand-père faisait partie de l’équipe olympique de boxe en 1928 et son père a passé une soirée à quatre pattes devant Floyd Patterson, le temps que l’arbitre, dégoûté, arrête les frais.
Leur rejeton présente sur le papier des références qui peuvent impressionner : il a remporté 30 de ses 36 victoires par K.O. (21 dans le 1e round) et subi une seule défaite sur blessure. Rien que ça ! Lorsque l’on examine les choses de plus près – évidemment – les perspectives changent. Pour son dernier combat avant Las Vegas, McNeeley a forcé à l’abandon un nommé Danny Lee Wooford dont le palmarès ne comptait pas moins de 41 défaites sur 57 combats ! Le reste est à l’avenant… Dans son dossier de presse, McNeeley s’enorgueillit de s’être fait casser le nez à 12 reprises, soit une fois sur trois combats, ce qui n’est pas une mince performance, même si on le fait exprès.
On voit que Tyson n’a pas trop de mauvais sang à se faire, qu’on lui a prévu une rentrée à sa main, que tous ceux qui, aux Etats-Unis, auront payé 100 $, “pour voir” (record historique) ne verront pas grand chose. Que l’événement annoncé à grands frais risque fort d’être le prototype du non-événement. Même Don King, qui ne recule d’ordinaire devant pas grand chose et qui avait miraculeusement fait grimper McNeeley jusqu’à la 11e place du classement de la W.B.C., l’a sagement fait rétrograder jusqu’à la 13e par peur du ridicule.
Que les choses soient claires, Peter McNeeley est le brave bœuf blanc promis au merlin, et comparer la rentrée de Tyson à celle de Mohammed Ali est une plaisanterie de mauvais goût. Pour mémoire, celui-ci n’était pas vraiment resté absent des rings trois ans pour les mêmes raisons (refus de servir au Viet-Nam pour l’un, viol pour l’autre) et pour son combat de rentrée il avait affronté Jerry Quarry – l’un des grands “désespoirs blancs” des années 70, pourtant – qui serait venu à bout de McNeeley avec les deux bras attachés derrière le dos. Pour se consoler de participer à cette farce grotesque, l’irlandais de Medfield (Massachussets) pourra toujours se dire qu’avec les 800.000 $ de sa bourse il pourra, enfin, se faire refaire la cloison nasale et même, pour le prix, embaucher une équipe de neurologues – ce qui ne sera pas un luxe. Quoi qu’il en soit, si l’envie vous prenait de parier entre amis devant votre poste, gardez présent à l’esprit le proverbe connu de tous les fauteuils de ring : “Ne parie jamais sur l’homme blanc”.
L’homme qui savait faire les quiches
Au début des années 80, Mike Tyson a intégré une espèce de pensionnat : la bicoque d’Athens (New Jersey) où s’est retiré Cus d’Amato. Il n’avait pas trop le choix : c’était ça ou la maison de correction juste à côté. Cus d’Amato, l’entraîneur mythique, le sorcier qui avait fait deux champions du monde, y trompait son ennui en parlant de boxe des nuits entières avec Norman Mailer, le reste du temps, il scrutait le ciel pour voir si les Martiens n’allaient pas débarquer. Quelques jeunes gens vivaient dans les sept chambres à l’étage qui donnaient sur l’Hudson, ils voulaient tous devenir boxeurs, mais Cus savait qu’ils ne seraient jamais que des minables.
L’un d’entre eux s’appelle Jay Bright. Lorsque Cus l’avait recueilli à la mort de son père, l’adolescent pesait dans les cent-soixante, cent soixante-dix kilos. En prenant un peu d’exercice et en se privant des saloperies qui constituent l’ordinaire du jeune yankee obèse, Jay Bright perdra cent kilos. C’était suffisant, a priori, pour en faire un boxeur présentable, le problème étant que Jay n’était vraiment pas doué. Sa carrière s’arrêtera sur une blessure à l’œil après seulement trois combats amateurs. Cus ne le flanquera pas à la porte pour autant, Jay Bright continuera d’habiter Athens ; pour payer sa pension, il rend de menus services : la cuisine, le ménage. Il rêve maintenant de devenir comédien.
Lorsque Tyson se séparera de Kevin Rooney, celui qui a toujours été son entraîneur chez les pros, Don King, à la surprise générale, fera appel à Aaron Snowell (un illustre inconnu qui avait comme seule référence d’avoir nettoyé les toilettes de la salle où s’entraînait un ex-champion du monde, Tim Witherspoon) pour le remplacer avec Rory Holloway et Jay Bright comme assistants. Lorsqu’il apprendre cette promotion inattendue, Teddy Atlas, le premier entraîneur de Mike, déclarera : « C’est comme mettre des tongs avec un costume Armani ! » À un journaliste qui lui demandait ce que Jay Bright savait faire, Kevin Rooney – laconique – répondra : « Les quiches ! » La fine équipe de bras cassés complétée par Taylor Smith, un « cutman » distrait, s’illustrera plus que de raison lors de la première défaite de Tyson contre James « Buster » Douglas en oubliant la moitié de la trousse de soins au vestiaire et en lui prodiguant des conseils absurdes tout au long du combat. Jay Bright est un nul patenté dont la nullité est de notoriété publique.
Ce que chacun donc présente comme un « retour aux sources » n’est qu’un pas de plus vers la déchéance du meilleur poids lourd des années 80. Tyson lui-même a le plus grand mépris pour Jay Bright… « Il n’y connaît que dalle ! » ; s’il l’a repris comme entraîneur, soit il a parfaitement intégré le fait qu’il dégringole la pente savonneuse et, tant qu’à faire, autant que cela ne lui coûte pas trop cher, soit il n’a rien compris ni à ce qu’il lui est arrivé ni à ce qu’il lui arrive ni, bien sûr, à ce qui va lui arriver.
Encore heureux pour le spectacle, à l’époque où le combat entre les deux meilleurs boxeurs du monde (Trinidad et de La Hoya) peut se révéler être aussi emmerdant à regarder qu’une partie d’échecs, Tyson possède dans ses poings l’arme absolue : le punch qui peut retarder sa fin en accélérant celle de son adversaire et décoller le public des sièges. Le punch c’est la dernière chose que perd un boxeur, juste avant ses derniers amis, et son adversaire a été soigneusement choisi pour ne pas lui faire trop de misères (Orlin Norris vient de la catégorie inférieure où déjà il ne frappait pas), l’affaire devrait donc être vite torchée. Mais que Jay Bright soit dans son coin laisse mal augurer de la suite des opérations.
À la lueur de ce choix, le retour au sommet que l’on nous vante (vend ?) depuis déjà trop longtemps semble fort hypothétique. Cette stratégie signifie surtout que la dynamique suicidaire qui préside à la fin de la carrière de Tyson est en place et qu’aucune volonté ne s’oppose à ce que, dans deux ou trois combats, Tyson donne le spectacle pitoyable d’un has-been en perdition sur un ring : celui qu’il a donné, pour la première fois, devant James « Buster » Douglas… avec Jay Bright, impuissant, dans son coin. C’est tout ce que le public attend : voir crever, en public, celui qui leur a fait si peur et les a tant fait bander. Le pire pour Mike serait que personne même ne s’intéresse à sa chute, que celui qui a soulevé tant de passions et établi tant de fortunes ne suscite plus que l’indifférence, qu’on l’oublie comme tout ce qu’il a représenté à moins, plutôt, qu’on veuille l’oublier comme l’époque dont il a été le symbole un peu à la manière de Bernard Tapie chez nous.
Le seul à sincèrement se réjouir dans l’affaire c’est Jay Bright : il va avoir une jolie casquette toute neuve et, avec son pourcentage, il va pouvoir s’empiffrer de quiches avant de se payer une cure de thalassothérapie.
La cagoule ! La cagoule !
Lorsque les boxeurs sont finis, on leur propose, pour les achever, de faire des conneries, on drape Jack Johnson dans une peau de panthère mitée, on lui colle sur le crâne une couronne en papier chocolat et on le fait jouer dans Aïda, les yeux exorbités et la paupière passée au Zébracier ou alors, comme ils ne savent pas faire grand-chose sur une scène, on les fait remonter sur le ring (qui est leur scène à eux) et on les ridiculise (la seule chose qu’ils savent faire — bien ou mal — c’est boxer). On se souvient de Joe Louis couvert de cellulite s’essayant au double nelson pour payer ses impôts (il en ressortira avec un lumbago tenace) ; d’Ali tournant un quart d’heure comme un dératé autour d’un lutteur japonais tricotant des gigots comme un enfant à la récré pour ne pas se faire attraper. Ce sont des spectacles affligeants, que l’on fait subir, de préférence aux poids lourds (qui sont à l’humanité ce que les éléphants sont aux animaux) pour se venger d’eux, pour leur faire payer ce qu’ils ont été et ce qu’ils ne sont plus : les rois du monde. Ce n’est pas un hasard si ces humiliations, c’est à Jack Johnson, Joe Louis et Muhammad Ali qu’on les a infligées le plus volontiers, ils avaient été des affronts pour l’homme blanc et l’homme blanc n’aime pas que le nègre lui crache à la gueule ni qu’il brandisse le poing.
Mais, jusqu’à présent, ces spectacles dégradants (pour ceux qui les donnent et ceux qui les regardent) ne se réclamaient pas de la boxe, ils se réclamaient du spectacle, du catch le plus souvent. Le combat de ce soir innove peut-être dans la mesure où, s’il se présente, a priori, comme un combat de boxe, il se vend comme un combat de catch.
« Attention, Mesdames et Messieurs ! À ma droite, l’armoire à glace slave, le voïvode des steppes, l’ours polonais… Andrew Goooolo-ta ! À ma gauche, le pit-bull enragé, l’anthropophage, la terreur des ghettos… Mike Tyyyy-son ! »
Le public adore, il patauge dans le pop-corn en rigolant. On l’imagine scander suivant ce qu’il advient sur le ring (qui n’a aucune importance) : « Dans les couilles ! Dans les couilles ! » (la bande à Golota) ; « L’oreille ! L’oreille ! » (le clan de Mike). Le seul plaisir qui lui sera refusé c’est d’entonner : « La cagoule ! La cagoule ! » comme les foules mexicaines lorsque s’affrontent l’Indien Zapotèque et Super-Barrio.
S’il fallait en revenir à des considérations plus sportives et à un ton plus mesuré, disons que s’affrontent ce soir, à Auburn Hills dans le Michigan, deux boxeurs dont la chance est passée.
Andrew Golota, né le 5 janvier 1968 à Varsovie, a émigré aux Etats-Unis en 1990, est passé pro en 1992 ; il a failli devenir deux fois champion du monde en 1996, les deux fois contre Riddick Bowe qui n’était pas n’importe qui. La première, en juillet, alors qu’il menait largement et qu’il n’avait plus qu’à attendre que ça se passe, il se fera disqualifier pour coups bas ; la soirée se finira en bagarre générale, chacun se servant de son téléphone portable comme d’une batte de base-ball. La seconde, en décembre (le Polonais, même à jeun, n’est pas fin), dans les mêmes circonstances, il recommencera. Depuis, après une condamnation pour agression à main armée, il a connu, comme on dit, des fortunes diverses. Il a battu quelques types dont le métier est d’être battu (Elie Dixon, Jack Basting, Quinn Harrare, Marcus Rhode) ou dont le métier est, désormais, d’être battu (Tim Witherspoon, Jesse Ferguson). Il a été vaporisé par Lennox Lewis à la première reprise et, après l’avoir envoyé sur le cul, il a finalement été battu par Michaël Grant que le même Lennox Lewis a pulvérisé il y a peu.
Tyson, c’est du connu, du solide, du rabâché. Où en est-il ? On n’en sait rien ! Lui-même l’ignore. Abruti dans la vie à grands coups d’antidépresseurs, il arrête son traitement lorsque vient l’heure de se battre et se met alors à copieusement déconner en tenant des propos cannibales ou en déquillant comme au bowling arbitre et adversaire. « Strike ! » hurle la foule… C’est toujours un plaisir de le voir débloquer car, malgré le peu de figures laissées à l’imagination en la circonstance, il sait faire preuve d’une créativité débordante.
Lors de la conférence de presse, Mike s’est particulièrement illustré. À la question (très pertinente) d’un journaliste lui demandant combien de temps durerait le combat, il a répondu : « Aussi longtemps que ça prend pour tuer quelqu’un ! » Interrogé sur son traitement, il a déclaré : « J’en prends pour ne pas vous tuer… je tiens pas à prendre du Zoloft… j’suis accro à ça… ça bousille ma vie… je bande plus, Popaul est en panne! » À ce propos, le procureur Garrison qui l’a fait condamner pour viol il y a quelques années a rétorqué: « Sa bite est bien la dernière chose qui tombera en panne chez Mike, si elle ne marche vraiment pas, il n’est vraiment pas en forme ! »
Nous en sommes donc là, à nous demander si la bite de Mike marche ou ne marche pas (to bite or not to bite en quelque sorte !) ; les journalistes spécialisés, eux, continuent de s’interroger doctement sur l’issue d’un combat opposant deux cinglés frappant tous les deux comme des mules, comme si cela avait une quelconque importance.
L’arbitre de ce qui devrait vaguement ressembler à une bagarre de routiers balèzes ayant quelques notions de comment se faire mal s’appelle Frank Garza.
On lui souhaite bien du plaisir.
Mon pit’ s’appelle Mike et je vais te casser la tête !
Il ne viendrait à l’idée de personne d’appeler son chien Proust, alors que tout ce qui traîne en banlieue et qui est de forme molossoïde s’appelle Mike ou Tyson… quelquefois, mais c’est plus rare, Hulk ou Rambo. S’il en avait connaissance, l’intéressé se montrerait flatté pour peu que le pit-bull lui ressemble (court sur pattes, les épaules très larges, puissamment armé). Tout le monde trouve ça naturel, mais on ne m’ôtera pas de l’idée que, lorsque l’on appelle un chien d’un nom d’homme, on considère, plus ou moins, que chien et homme sont équivalents. Que le monde est un chenil.
Tyson dort par terre, il couvre les femelles par terre et l’on baptise de son nom tous les pit-bulls de la planète. Il est la terrible adéquation entre la barbarie qui gagne notre monde et le rôle de barbare qu’on lui demande de jouer et qu’il lui arrive de remplir à merveille lorsqu’il viole ou qu’il dévore les oreilles d’Evander Holyfield. C’est pour cela qu’il est l’idole couverte d’or de ce monde et son esclave. Il est de notre temps, celui de l’analphabétisme voulu, des serial-killers et de la fin de la dialectique ; du refus de la parole articulée ; de la fascination pour la violence et la brutalité ; de la puissance et de la gloire à n’importe quel prix.
Ce que l’on veut, de notre côté, c’est que Tyson nous fasse bander ; qu’il fasse couler le sang pour que nous gardions les mains propres ; qu’il soit une bête et qu’il meure. Même s’il faut payer pour cela. Comme il n’y a personne qui puisse tenir ce rôle, aujourd’hui (sinon un bon Miura), avec autant de sincérité, on lui pardonnera tout pourvu qu’il continue à rester enfermé dans les ténèbres et le chaos pour quelques millions de dollars que l’on finira bien par lui reprendre.
La vie de Tyson est un aller-retour tragique entre sa soumission et son refus de ce rôle tout comme nos sentiments à son endroit oscillent entre la répulsion et la fascination. C’est pour cela qu’il est un mythe, le mythe que nous méritons. Il se cogne encore, quelquefois, aux murs de sa cage pour retrouver l’humanité qu’on lui confisque, mais tout ce que nous désirons – en réalité – c’est qu’il reste un animal et qu’il crève.
Il faudrait être un héros pour échapper à ce cercle de feu et Tyson n’est pas un héros : « Je ne suis meilleur ni pire que personne, j’essaie juste de survivre ! »
Ali nous faisait rêver par sa beauté, sa finesse, sa grâce et son intelligence, il était le support de nos rêves, celui d’un monde meilleur ; Tyson est le suppôt de nos cauchemars : un monde qui ne peut que devenir pire. Ali voulait vivre et vivre libre, Tyson veut survivre, même si, pour cela, il doit renoncer à sa liberté. C’est la différence entre une époque où les utopies étaient envisageables et aujourd’hui où elles ne sont même plus imaginables.
Le meilleur service à lui rendre, celui qui pourrait lui rendre l’humanité qu’on lui dénie, serait de ne pas le regarder boxer, mais il en mourrait aussi. Parce qu’il n’est qu’une image.

L’ombre est sur le luxe…
MISCELLANEES
Enfant seul avec ballon
Au sein du règne animal, l’homme a toujours voulu faire le malin. Rien ne le destinait, pourtant, à y exercer une quelconque suprématie. Bien avant lui, les babouins avaient inventé le One Two Two et le Chabanais, l’ornithorynque le surréalisme à lui tout seul, alors qu’il errait encore, à croupetons, tapis dans des grottes sans mezzanine.
Que faire donc à sa place lorsque l’on est dévoré par l’ambition ? Sinon se dresser, à tout hasard, sur les pattes arrière pour voir le vaste monde de plus haut, en espérant qu’il n’allait pas lui pousser, comme au kangourou qui avait inventé le Madison Square Garden, une poche sur le ventre.
Il semblerait que de cette excentricité n’ait pas seulement découlé l’enfouissement du cerveau reptilien sous plusieurs couches de neurones, mais bel et bien l’apparition de la Culture sur la planète.
On peut déduire de ce qui précède que, à l’inverse de ce qu’avancent ses détracteurs, le sport est bien l’une des entreprises les plus culturelles à laquelle puisse se livrer l’humanité souffrante. En effet, en dehors de certains sports assez proches des activités que pratiquent nos frères inférieurs (courir, sauter, se foutre sur la gueule), la plupart d’entre eux sont parmi les choses les moins naturelles que l’on puisse imaginer.
Le football, lui, est l’un des sports qui concilient avec le plus de finesse la contrainte, donc la Culture, avec le pur plaisir de l’activité physique (courir, sauter, se foutre sur la gueule). Rien de moins naturel, on en conviendra, en présence d’une sphère de cuir de 0,68 à O,71 centimètres de diamètre et pesant de 396 à 453 grammes de n’utiliser que sa tête et ses membres inférieurs pour tenter, aidé de neuf acolytes, de la faire pénétrer dans une cage constituée de trois barres : les verticales éloignées de 7,32 mètres, l’horizontale les surmontant de 2,44 mètres, défendue de surcroît par un individu qui a le privilège de porter le numéro 1 et de pouvoir se servir de ses mains. Ce qui procure, d’ailleurs, aux supporters, pour peu que le gardien soit africain, l’occasion de plaisanteries du meilleur aloi : envoi de bananes accompagné de slogans fins : “Bamboula, au charbon !” et d’injonctions délicates : “Retourne dans ta savane, Blanchette !” en supplément de la bluette dévolue d’ordinaire à tout gardien dégageant son camp : “Oh, hisse ! enculé !”
Tout cela se déroule, dans le meilleur des cas, sur une pelouse soigneusement tondue de 75 à 120 mètres de long sur 45 à 75 mètres de large ; tous les cas de figure pouvant se présenter, pour le support comme pour la surface, depuis la jachère inondée semée de trous d’obus jusqu’à la moquette synthétique qui brûle l’épiderme pour peu que l’on y effectue les spectaculaires glissades destinées à subtiliser le ballon à son opposant direct.
Il n’empêche que, malgré ses règles byzantines, dont le “hors-jeu” est le pont aux ânes, et son application judicieuse le Concile de Nicée perpétuellement recommencé, le football est l’une des plus fantastiques machines à rêver jamais inventées, relativement facile, qui plus est, à jouer dans des conditions où il n’est pas prévu de le faire : à 7, à 5 et même tout seul.
Imaginons l’enfant — seul — avec un ballon ou quelque chose qui s’en rapproche. Pour jouer au basket, il lui faut un filet suspendu et, à force d’y enfiler les perles, lui viendra une impression d’ennui proche de celle que lui procure d’ordinaire l’apprentissage de la table de multiplication. Pour jouer au volley, il lui faudra obligatoirement un mur et, au bout de quelque temps, il aura l’impression de jouer à la pelote basque. Ne parlons pas du water-polo qui nécessite un jacuzzi géant. Alors que s’il rêve de devenir arrière, libero, avant-centre, une souche pourra avantageusement figurer un adversaire pas très futé, un mur lui servira de partenaire pour ses passes redoublées et un trottoir lui fera l’effet d’un boulevard où s’engouffrer bille en tête.
Pour peu qu’à force de faire résonner la cour ou le jardin de “pointus” plus ou moins précis, il récupère un copain, c’est parti pour les “pénos”, si c’est la cage d’escalier qui dégringole, on “paille”. Le premier qui marche sur le pied de l’autre choisit le plus costaud et ainsi de suite, le dernier que personne n’a choisi et qui porte des lunettes fera l’arbitre. On entasse les pulls et les anoraks et allons-y les jeunes !
Avec un peu de chance, à force de le voir revenir sanglant des Vêpres, ses parents offriront à l’enfant seul et qui ne le sera désormais plus, des crampons, des protège-tibias en plastique et l’inscriront dans une école de football où il apprendra, les mercredis après-midi, les délices de “l’intérieur-extérieur” et de la douche froide, à dribbler des cônes de signalisation et les rudiments de Clausewitz dont le célèbre adage, “la meilleure attaque c’est la défense”, a tant desservi le football moderne.
Tous les enfants de sexe masculin savent plus ou moins jouer au foot : bien, pas bien, très bien mais suffisamment pour pouvoir, plus tard, apprécier les tactiques saugrenues, les gestes fous (bicyclette, aile de pigeon, petit pont, Papineries et Cantonades), la syntaxe de Thierry Rolland (“fauché comme un lapin en plein vol”), les explications d’après-match. En bref : passer quelques soirées peinards sur le convertible du salon, entre potes – sans femme. Comme chez les Jésuites, à la chasse, aux Tuileries et à la guerre qui ne sont pas tous, loin de là, des endroits où l’homme prend son pied, mais où se pratiquent en toute quiétude l’une de ses spécialités préférées : l’amitié virile, faite de promiscuité, de bousculades, de Oh ! de Ah ! jaillis en même temps de leurs gosiers.
Le football est également l’une des seules activités où l’homme peut pleurer publiquement — de joie ou de douleur — sans se voir automatiquement qualifié de ce qu’il n’est pas. Si l’on excepte sa variante magnétoscopée qui tient plutôt de la cinéphilie, il présente aussi l’avantage de ne laisser aucune trace, si ce n’est la seule qui compte : le souvenir seulement partagé par le verbe… “Tu te souviens ?” Comme la corrida, l’enfance, les amours illicites, son intérêt vient de ce qu’il peut toujours être raconté, rejoué, à l’infini.
Les trajectoires de Giresse qui étaient, au milieu de terrain, aussi élégantes que les arabesques de Pollock sur l’étendue de sa toile, ont l’avantage sur la peinture d’être imaginaires. S’il était un art, le football serait des plus conceptuels, puisque son objet n’existe plus à peine s’est-il réalisé, que sa beauté prend le risque d’être effacée par un exploit inoubliable qui, à peine advenu, est déjà un souvenir.
Tout ce qui vient d’être dit devrait, Porte-d’Auteuil, faire réfléchir la jeune fille qui n’a que trop tendance à traiter l’ivrogne apoplectique qui vient de lui faire une queue de poisson de : “connard de supporter !” Si ça se trouve c’est un Prix Nobel encore sous le coup de l’émotion que lui a procuré un “cadrage-débordement” de David Ginola. Donc, méfiance et motus. Boulevard Suchet, l’intelligence peut passer équipée d‘un moteur diesel et d’une écharpe aux couleurs du Paris Saint Germain.
Jesse Owens

Avant
Carl Lewis est plus titré que lui ; Bob Beamon a sauté plus loin que lui ; Joe Louis a été considéré comme un dieu, pas lui ; John Carlos comme le diable, pas lui, et pourtant Jesse Owens a fait davantage qu’eux tous réunis : une fois, une seule, il a changé le monde.
En 1936, aux jeux Olympiques de Berlin, il a été celui qui a (dé) montré, aussi clairement qu’il était possible de le faire, que le racisme n’était qu’un délire sans fondement, qu’un Nègre pouvait courir plus vite et sauter plus loin que les plus beaux étalons de la race des seigneurs.
La gloire sportive a cette supériorité sur les autres d’être incontestable, celui qui a couru le plus vite a gagné, celui qui a sauté le plus loin a gagné. Et celui qui a gagné la course, comme il allait gagner le concours, c’était un Nègre : Jesse Owens. Hitler, ses légions, ses étendards et tous les dieux du Walhalla convoqués pour l’occasion n’y pourraient rien, la foudre qu’ils appelaient de leurs vœux était tombée au pied de leur tribune ; le 22 juin 1938, des mains de Joe Louis, c’est sur le menton de Max Schmeling, qu’elle dégringola en moins de trois minutes ; il faudra attendre quelques années supplémentaires pour qu’elle les carbonise.
Un beau jour de 1936, un jeune homme, noir a montré avec l’évidence du sublime que tous les hommes naissaient inégaux devant la nature, ce qui veut dire que tous les hommes ne peuvent être égaux qu’en droit, qu’il n’y aurait, sinon, aucune humanité pensable. Pour ces dix secondes et quelques dixièmes, les damnés de la terre peuvent lui être éternellement reconnaissants.
Tout avait pourtant mal commencé et rien, ensuite, ne fut simple.
James » Cleveland » Owens est né le 12 septembre 1913 à Dainville, son grand-père était esclave, son père, Henry, qui ne savait ni lire ni écrire et sa mère, Mary-Emma étaient métayers, c’est-à-dire guère plus que des esclaves. La nuit en Alabama, de mystérieux cavaliers masqués parcouraient les plaines au galop, on pouvait voir les flammes des bûchers en forme de croix qu’ils allumaient au sommet des collines, au matin, on découvrait le corps d’un Noir – qui ne s’était pas suicidé – se balançant au bout d’une corde. À cinq ans, le petit Owens contracte une pneumonie, aucun médecin ne jugera bon de se déplacer pour soigner un Négrillon et ce sera Mary-Emma qui incisera l’abcès avec un couteau. La plaie à la poitrine saignera trois jours avant de guérir.
La famille Owens, et ses dix enfants, finira par émigrer dans l’Ohio où Dieu est plus clément, ce qui ne veut pas dire clément pour autant : le père de Jesse chôme, sa mère est domestique, Jesse travaille dans une épicerie. C’est à Cleveland, pourtant, qu’un entraîneur, Charles Riley le découvrira et saura deviner les possibilités de ce jeune homme pas très costaud auquel, pour qu’il se requinque, il offre tous les jours un petit-déjeuner de sa composition.
À seize ans, Jesse est déjà marié et confie à son entraîneur qu’il ne peut rien avaler alors que sa famille crève de faim. Riley se chargera de trouver un boulot à Henry Owens, ce qui n’empêchera pas Jesse de continuer à trimer comme cireur de chaussures, homme de peine ou liftier au lieu de poursuivre des études.
En 1935, en moins d’une heure, à peine remis d’une chute, il bat cinq records du monde et en égale un autre. En 1936, il remportera quatre médailles d’or aux jeux Olympiques. Paradoxalement, c’est son adversaire aryen Luz Long qui lui fera changer ses marques pour son dernier essai victorieux au saut en longueur. Une photo noir et blanc les montre penchés affectueusement l’un vers l’autre.
Hitler ne lui serrera pas la main, Jesse déclarera à ce propos : » C’est sûr, je n’ai pas été invité à serrer la main d’Hitler, mais je n’ai pas été invité, non plus, à serrer la main du président des États-Unis ! «
Sur Broadway, pourtant, l’Amérique fera un triomphe à l’homme le plus rapide du monde. Le long du parcours, un inconnu lui lancera un sac en papier contenant 5 000 dollars. C’est tout ce qui lui restera, la parade achevée, pour élever ses trois enfants avec un petit boulot d’éducateur sportif à 30 dollars la semaine. » Quand je suis revenu après toutes ces histoires, je n’ai pas pu m’asseoir à l’avant des bus ni vivre là où je voulais ! Où est la différence, je vous le demande ? » Disqualifié par sa fédération deux semaines après son triomphe pour avoir refusé une tournée en Suède, Owens sera obligé, pour gagner sa vie, de recommencer à faire ce qu’il sait faire le mieux : courir.
Contre des chevaux.
» Ça me rendait malade, mais je l’ai fait ! » dira-t-il à ce propos. Pour tout arranger, ses deux associés blancs l’escroqueront dans une affaire de pressing, le laissant avec 114 000 dollars de dettes.
Il faudra attendre la Deuxième Guerre mondiale pour que le président Roosevelt lui procure un travail correct chez Ford. La suite se confond avec les histoires que raconte le capitalisme : Owens réussira dans le business, il créera une fondation pour venir en aide à la jeunesse ; dévoré par les ulcères qui étaient le prix à payer pour devenir quelqu’un dans cette Amérique où n’importe qui peut devenir quelqu’un, il mourra d’un cancer au poumon à l’âge de soixante-six ans.
De Jesse Owens en tant qu’athlète, il reste cette extraordinaire impression de facilité qui fait que l’on se demande encore si, intrinsèquement, il n’est pas le meilleur athlète de tous les temps. Ses performances sont loin d’être ridicules comparées à celles des champions d’aujourd’hui surtout si l’on prend en compte le fait que, hormis des techniques d’entraînement rudimentaires, on courait à son époque sur cendrée et qu’en guise de starting-block on creusait deux trous dans le sol (10’’2 quand même sur 100 mètres), que son record du monde du saut en longueur (8,13 mètres) a été établi en un seul saut après une course d’élan sur une piste en herbe. Tout cela est de peu d’importance en regard de ce qu’il représente. Légende vivante, héros américain devenu alibi comme Muhammad Ali allumant la flamme des jeux Olympiques d’Atlanta après avoir fait trembler l’establishment, il refusera de s’associer à la contestation la plus radicale, croyant sincèrement qu’il suffisait pour s’intégrer de se soumettre aux modèles proposés et qu’il suffisait pour être un modèle d’avoir du talent et de la volonté. En 1970, il écrira : » Si les Noirs ne réussissent pas aujourd’hui, c’est qu’ils ne le veulent pas. » Ce qui lui vaudra d’être traité d’Oncle Tom et de lèche-cul. C’est le paradoxe de certaines insultes, aussi justifiées soient-elles, elles n’en sont pas moins injustes.
Il était d’un temps où l’on n’autorisait les Noirs qu’à fuir et à se battre, sur les stades et sur les rings, ce qui ne les changeait guère de leur vie quotidienne ; d’un temps où le sport, coupé des intérêts commerciaux, avait une fraîcheur qu’il n’a plus. Les enjeux sont, désormais, différents ; moins visiblement politiques, ils continuent à l’être sauf que le diable y apparaît masqué comme les cavaliers du KKK. Je n’en veux pour preuve que ce clip co-produit par Canal + avec l’aide du CNC, où par les miracles du morphing, Jesse Owens se transforme en Carl Lewis avant que celui-ci » se transforme à son tour en humanoïde de synthèse évoluant jusqu’à Atlanta enveloppé du rouge « Coca » « .
Contre une couleur, que faire ? Et comment s’étonner que personne ne s’y oppose ?
Jesse Owens a changé le monde une fois, il a passé le reste de sa vie à essayer de la changer une fois encore et il a échoué. Personne n’a le droit de le lui reprocher puisque personne n’a fait mieux.

Après
Qu’un seul Arabe lui manque et la France est dépeuplée

Le monde et ceux qui l’habitent sont occupés par fort peu d’évènements de réelle importance. Tous les ans et plus ou moins dans l’ordre : la rentrée des classes, le prix Goncourt, Noël (le foie gras, les chocolats, la belle-mère à qui l’on offre le Goncourt qu’elle a déjà), les soldes (deux fois par an et deux fois supplémentaires dans le rouge à la banque), la saison du blanc, le festival de Cannes, Roland Garros, le Tour de France et, prélude au rut estival, le numéro spécial de « Comment perdre trois kilos avant l’été » des magazines féminins.
Tous les quatre ans, il y a les Jeux Olympiques (d’hiver et puis d’été) et la Coupe du monde de football ; tous les cinq ans : élections législatives, et tous les sept ans : élection présidentielle. Cela suffit dans l’ensemble au bonheur des occupants de l’Hexagone, d’autres contrées restant adeptes d’épiphanies (Super-Bowl, San Fermìn, Dokumenta) sans écho sous nos latitudes.
Quand c’est fini, on respire, on se retrouve enfin seul sous la voûte étoilée face aux interrogations métaphysiques qui nous hantaient parfois pendant les intervalles publicitaires, à la mi-temps ou au changement de côté : « Pleuvra-t-il demain ou y aura-t-il du vent ? » Il faut se hâter, quelquefois, la semaine d’après, on embraye sur Halloween.
Les hasards du calendrier peuvent faire se chevaucher plusieurs évènements, il se produit alors un embouteillage encéphalique, les axones du quidam de base flirtent avec la zone rouge du compte-tours, faisant courir à ses méninges un risque d’échauffement préjudiciable à leur bon fonctionnement. J’avoue, pour ma part, ne plus avoir la souplesse intellectuelle suffisante pour, en aussi peu de temps, pouvoir professer un avis autorisé sur cette Coupe du monde qui tombe mal et la redécouverte de la France d’en-bas, la passation de pouvoir entre Venus et Serena Williams (sans compter l’avenir de Tyson qui me préoccupe) et le jeu subtil des triangulaires ; il me faudrait l’agilité d’un abonné de la rubrique « Rebonds » ou une raquette d’un tamis aussi fin que celle qu’utilise Robert Redeker pour dénoncer l’illettrisme et l’abrutissement des masses d’un même revers le long de la ligne. Je n’en ai ni la volonté ni la technique et, comble de malchance, j’ai jeté une raquette de la dite marque (Dialektik) fabriquée en Allemagne de l’Est le jour où je me suis rendu compte qu’elle était incapable de renvoyer les balles un tant soit peu « travaillées ».
À ce niveau de saturation de l’espace public et privé par des spécialistes incontestables, on n’a guère plus envie que de leur donner à tous raison puisqu’ils ont tous tort ; qu’ils s’intéressent à ce à quoi on veut qu’ils s’intéressent, et qui n’est pas intéressant.
Les analyses les plus pointues sur ce qu’un évènement de cette ampleur produit d’aliénation supportrice ne tiennent pas une seconde comparées à une aile de pigeon réussie par un Equatorien venu du diable vauvert ; le centre au second poteau guatémaltèque le plus pertinent n’empêchera pas un esprit modérément critique de soupçonner que les dispositifs du totalitarisme marchand et la rhétorique assortie sont clairement à l’œuvre sur l’ensemble de la planète câblée. Chacun a donc ses raisons que la Raison ne connaît pas et il n’est rien de pire. Terré dans son T3, l’individu se sent abandonné face à la masse et se tourne avec dépit vers son animal familier couvert de croûtes et de tiques : « Ils sont fous, hein mon vieux Bouchien ! Allez, viens, c’est France-Danemark, on a le temps de faire un tour ! »
La figure d’aujourd’hui ne serait donc plus le Saint, le Yogi, le Travailleur ou le Commissaire politique, mais le milieu de terrain et, accessoirement, sa compagne, ficus blond muni d’un QI de 90-60-90. On peut le regretter, mais on ne le doit pas, le progrès est à ce prix.
Pour que les choses soient claires et tant que nous en sommes au quantitatif auquel se borne, hélas, souvent le discours sportif, je n’ai rien contre le fait que Z.Z gagne dix fois plus que J.2.M, alors qu’il est d’usage de s’indigner vertueusement du salaire de ce dernier, ni même que l’on ait oublié que des Intouchables d’aujourd’hui, dont Hidalgo (Michel) et Platini (idem), avaient eu, si je ne m’abuse, quelques démêlés avec la justice pour onze valises de billets qu’ils avaient oublié de déclarer à l’administration fiscale.
Pour le plus léger, on pourrait se gausser du vocabulaire de Roger Lemerre et de ses stratégies sioux qui feraient prendre Bigeard pour Clausewitz ; de l’importance planétaire que prend parfois l’état du genou de Thierry Henry ou celui de la cuisse de Z.Z. C’est à la portée des chansonniers de la Butte ; ce qui l’est moins, c’est le travail de déconstruction qu’il faudrait opérer à propos des flots de réclame (l’ancienne publicité) qui nous inondent de leurs vertus sédatives.
Car, devrait-on désespérer Billancourt, la Courneuve et les Champs-Elysées (ou plutôt les marchands qui les bordent), les grandes retrouvailles sponsorisées par Adidas du peuple de France Black-Blanc-Beur communiant à cette seule occasion dans une même liesse en scandant : « Tous ensemble ! Tous ensemble ! » des slogans ineptes : « Et 1, et 2 et 3-0 ! », c’est de la propagande pur jus au même titre que l’Argentine absoute en 1978 et retrouvant sa place, Junte ou pas Junte, torture d’état ou non, au rang des nations fréquentables.
On peut toujours préférer l’une à l’autre et se féliciter de ce que la France, contrairement à l’Argentine qui n’existe pas, ait toujours su tirer orgueil de sa Légion étrangère – via Gabin et Piaf –, mais ces flots d’idéologies de coloration variable (il y flotte à la surface un soupçon de mazout) sont à la solde des nationalismes les plus belliqueux ; s’ils ne produisent pas des effets aussi destructeurs que les discours et les désirs de guerre qu’ils servent d’ordinaire, ce sont pourtant les mêmes. Ils vérifient à blanc que tout cela pourrait fonctionner à merveille et pour de bon.
Si l’on en avait besoin.
Comme en 14 !
Et que chacun y participerait.
Moi y compris.
Jour de foot – nuit blanche
La femme de supporter se contentait jusque-là de voir partir son époux pour le stade, bardé de klaxons et de fumigènes. Lorsqu’il restait à la maison il écoutait le « Multiplex » de Vendroux sur France-Inter avant d’aller se coucher.
Dans un cas comme dans l’autre il s’endormait difficilement mais vers deux, trois heures du matin il réussissait enfin la reprise de volée que Ginola avait manquée.
Au début de l’été, elle soignait ses coups de soleil, à l’entrée de l’automne ses engelures, toutes choses qui ne lui rendait pas l’existence trop difficile à supporter.
C’était sans compter sur Canal + et les progrès de la technique réunis. Pour réussir en 20 minutes ce que d’habitude il est impossible de faire en 3 ou 4 heures et lui rendre la vie impossible, ils s’y sont mis à 48 cameramen, 12 journalistes et 12 réalisateurs plus un réalisateur en chef, sur 12 sites.
A peine les sifflets des arbitres ont-ils mis fin aux rencontres de championnat de France (10 en D.1, 2 en D.2) que tout un chacun peut voir sur son écran tous les buts, toutes les actions intéressantes qui ont eu lieu, de Lille à Monaco. L’exploit technique le plus complexe qui soit (plus encore que le petit-pont), les équipes de Canal + l’ont réussi. Entre parenthèses cela donne la minute de télé la plus chère du monde. Leurs concurrents auraient payé davantage, puisque « ça marche ! » et que tous les amateurs véritables en sont « accros ».
Il aurait fallu se douter qu’une chaîne sur laquelle Jean-Pierre Coffe vocifère sur l’air des lampions : « Frais le produit, frais ! » serait la première à proposer ces images là, à peine congelées.
Tout ça fait que désormais le supporter ne ferme plus l’œil de la nuit puisqu’il rate immanquablement ce que Lizarazu a réussi et que sa femme peut songer, les yeux grands ouverts dans le noir, que fou vient du latin follis : « bourse de cuir, outre gonflée, ballon ». Ce n’est pas ça qui va l’aider à s’endormir…
De la démocratie…
Il y a peu, on ne connaissait qu’une seule et unique boxe, celle de Marcel Cerdan et de Ray « Sugar » Robinson, c’était la préhistoire sans les massues. Depuis quelque temps ont fait irruption quelques variantes toutes plus ou moins issues de la boxe française puisqu’elles utilisent pieds et poings.
Comme pour les utilisateurs de baladeurs, la pratiquer telle quelle serait revenu à échantillonner Offenbach pour faire du rap ou à taguer « de Dion-Bouton » sur l’abribus de son quartier périphérique, on a inventé à leur usage : le full-contact, la boxe américaine qui n’a d’américaine que le nom, le kick-boxing et importé la boxe thaï. Les éducateurs spécialisés disent que c’est bon pour l’intégration et le voisin du dessous qu’avec un bon berger allemand, ils peuvent toujours essayer de faire les mariolles.
La télévision ne pouvait donc ignorer ce sympathique phénomène dont elle ne sait pas encore s’il est ou non télévisuel. Le meilleur moyen de le vérifier sera donc de regarder la soirée que lui consacre Canal + qui s’annonce, évidemment, « explosive ». Au programme, 4 combats de kick-boxing dont deux championnats du monde W.K.C entre Rick Roufus et André Manart en lourds-légers et Dida Diafat et Kyogi Katsuyama en légers. Cerise sur le gâteau, la rencontre de boxe thaï (on y utilise les coudes et les genoux pour faire bonne mesure) entre Joël Cesar et Danny Bill.
Lorsque la fin de l’Histoire sera enfin survenue et le post-modernisme réalisé, les caméras de télévision seront installées en permanence sur les parkings des boîtes de nuit pour retransmettre en léger différé des combats d’Absolut-boxing avec coups de tête, doigts dans les yeux et torsions des testicules. On s’impatiente…
Fouette cocher !
Il est des sports qui se traîneront toujours la même image, quoi qu’ils fassent pour la changer. Qui dit boxe française voit rappliquer aussitôt les poncifs belle-époque par tombereaux entiers. Les voyous de barrière (c’était la banlieue d’avant), Casque d’Or, les moustaches en guidon de vélo, Milord l’arsouille, Jésus la Caille, Hector Guimard, les réverbères à gaz et bien entendu, les Panhard et Levassor que l’on démarrait à la manivelle et les Brigades du Tigre.
Tout cela est bien dommage car il y a longtemps qu’il n’est plus d’usage d’aller chercher la boxe française au rayon des curiosités modern-style, des amusettes pour nostalgiques. La boxe française est un très joli sport certes et qui, contrairement à beaucoup d’autres sports de combat peut être pratiqué par tous, sans adopter, qui plus est, l’idéologie bizarre qui va avec ses succédanés orientaux ; mais c’est aussi un sport à part entière, redoutablement efficace, il suffira à celui qui en doute d’encaisser un chassé médian pour en être définitivement persuadé.
En se refusant à devenir professionnelle la boxe française a, certes, définitivement perdu son combat contre la boxe anglaise, mais la vogue des arts martiaux l’a fait sortir du ghetto où elle stagnait depuis la seconde guerre mondiale. Une nouvelle génération de pratiquants l’a rendue plus rugueuse et a quasiment résolu le problème des enchaînements pieds-poings qui était, jusqu’il y a peu, assez académique.
Spectaculaire et proche de la chorégraphie à l’entraînement où les femmes excellent par leur souplesse et leur adresse, son spectacle en compétition est plus confus, l’efficacité et la rapidité prenant le pas sur le joli geste. Pour peu que les deux adversaires soient des battants on n’est parfois plus très loin des confuses mêlées du samedi soir au sortir du bal.
Que Saïd et Mohammed regardent les championnats du monde que diffusent Paris Première samedi et ils abandonnent le karaté aussitôt, avec un peu de chance même, le fils du traiteur-plats à emporter cambodgien va laisser tomber la boxe thaï… Enfin quelque chose de typiquement français qui peut plaire à ceux qui ne le sont pas encore… de quoi rêver !
Mongkon, Fanny et les 3 canards
Avec Carlos et Main d’Or, au camping des 3 Canards, on gagnait tout ce qu’on voulait. Le blanc, le rouge, le rosé et même le « jaune » ne faisaient pas trembler nos bras. On intéressait les parties quelquefois, pas grand chose, mais une fois que les teutons avaient plié l’auvent on échangeait en douce les marks contre le salmis de palombes de la mère Baillet.
Alors, quand les Thaïlandais ont débarqué on n’a même pas soulevé le bob. Et quand ils nous ont proposé d’en faire une petite, Carlos a demandé à sa fille d’aller jouer plus loin, au cas où elle prendrait une boule sur la tête et Main d’or a dit qu’il n’avait pas que ça à faire, qu’il leur demandait pas la recette du canard laqué… Comme ils ont insisté, bien gentiment, il faut le reconnaître, on a repris les boules que l’on avait rangées dans le coffre de la R 12. Y’en avait deux qui avaient des noms à coucher dehors et un autre qui s’appelait Mongkon.
Si l’on compte le terrain que l’on connaît par cœur, on était quatre contre eux. Carlos, il a fait comme d’habitude pour décourager le novice, il a placé sa boule contre le bouchon et il a pris un air modeste. Mongkon lui a souri et trois dixièmes de seconde plus tard c’était sa boule qui était à la place de celle de Carlos, une O’But toute neuve que l’on n’a jamais retrouvée. Le reste c’est pas la peine de raconter, les plaies sont encore fraîches. On a embrassé Fanny tout l’été.
Aux dernières nouvelles on les a retrouvés les Thaïlandais, ils sont engagés dans le Trophée de Pétanque Canal + 94, avec des Hollandais et des Tunisiens. Seulement, ce à quoi ils jouent, aux 3 Canards on appelle pas ça de la pétanque. C’est peut-être du sport, de la géométrie ou alors de l’art mais de toute façon, c’est pas un truc pour nous.
Tendido ou Nintendo ?

Il y a longtemps, les seules images – si l’on excepte celles des rêves et des souvenirs, que l’on avait de la corrida c’était des photos un peu grasses au fond d’un restaurant où les habitués étaient tous rescapés de Teruel et quelques bouts de films tremblés où l’on voyait Ava Gardner assise et Antonio Ordonez debout. En ces temps là il ne valait mieux pas mettre le sujet sur le tapis si l’on voulait travailler la jeune fille pour l’estoquer à l’hôtel.
C’est elle, maintenant, qui vous explique que le « tremendisme », décidément, c’est pas terrible et que le classicisme va avec tous les imprimés de chez Souleïado. Simon Casas est passé par là et la Movida, Jacques Durand aussi et Canal +. Grace à eux n’importe qui, au nord de la Loire, sait désormais qu’un « derechazo » s’effectue habituellement de la main droite et que les banderilles ne sont pas forcément posées pour faire joli. Pourquoi pas ? Mais pourquoi pas, non plus, le replay et le ralenti ?
Aucune réalisation, aussi pudique et sophistiquée soit-elle, n’arrivera à rendre ce qui se passe – vraiment, dans une arène, que l’on ne peut saisir que collé au ciment des gradins, en regardant, de loin parfois mais pour de bon, ce qui se passe au centre : la mort défiée, la mort déviée, la mort donnée.
La seule justification de la corrida, c’est qu’elle ne puisse, réellement, sans horreur, être regardée en face. Il est fort à craindre que la télévision (et les anabolisants) n’accouchent d’un autre spectacle, fait pour elle où l’accent serait mis là où il ne faut pas. Que les matadors et les taureaux que l’on élève pour eux cherchent le meilleur angle, non pas celui de leurs trajectoires antagonistes puis liées mais celui de la focale qui les filme.
Quoi qu’il en soit : « Suerte, hombre ! ».
CULTURE
Après le combat de trop, le livre de trop
Le problème avec les livres qui traitent de sport, c’est que l’on ne sait pas s’il s’agit de littérature ou bien de sport, de chiasmes bienvenus ou du compte-rendu plat de sanglantes mêlées ouvertes. La critique s’en trouve désarmée et, du coup, s’en désintéresse.
À l’inverse des pays anglo-saxons, où la littérature sportive est un genre répertorié où les plus grands (Hemingway, Mailer, Schulberg) se sont illustrés, en France, on n’y parle que de sport et c’est tant pis pour la littérature. Sous nos latitudes, le livre de sport est soit l’hagiographie d’un sportif de renom dont la vie se révèle être ennuyeuse comme la pluie (gamin turbulent, mari modèle, il est devenu, son service militaire accompli, un père attentif), soit une variation journalistique plus ou moins talentueuse sur un problème (l’argent, le dopage) ou un événement exceptionnel (la Coupe du monde, la traversée du Pacifique nord en pédalo). Editorialement, cela produit des succès publics formatés pour et par le marketing (Massacre à la chaîne de montre, Les yeux bleus dans les étoiles filantes) ou des échecs inattendus (Zizou, ma vie, mon œuvre), littérairement, cela donne une prose bien-pensante sous une jaquette en couleur à ranger dans la bibliothèque du living entre un gadget dont la pile manque et un vase de Murano ébréché. Et pourtant, quoi de plus romanesque que le destin des sportifs (Deschamps et Forget font exception) et que les scénarios proposés par une activité où se télescopent à qui mieux mieux le grotesque et le sublime ?
Le livre de Christophe Tiozzo, Ma terrible descente aux enfers, aurait pu être intéressant dans la mesure où il se situe juste à la croisée de ces écueils, manque de pot, il se fracasse sur les deux et l’on en sort avec l’haleine douteuse et une furieuse impression de gâchis.
Le roman possible est là pourtant, dans cette vie qui trimballe un gamin trop doué de la cité des Courtilles (93) à l’Ocean Drive de Miami pour s’arrêter (jusqu’à quand ?) derrière le comptoir d’un rade au fin fond de l’Ardèche (08), dans le trajet météorique de cette beauté qui ne veut que se détruire, dans l’oubli de soi et des dons que l’on a reçus du ciel à grands coups d’alcool, de coke et de boustifaille. C’était du tout cuit pour un écrivain qui aurait eu le courage (ça va pas de soi, le gonze fait plus de cent kilos et n’est pas fin…) de s’opposer à son sujet pour qu’il ne se contente pas de la vulgarité de ces clichés narcissiques et geignards maladroitement enfilés, qu’il comprenne qu’en littérature, comme sur le ring, le respect que l’on mérite est à la mesure des risques que l’on prend.
Comme le cadet des Tiozzo est tout l’inverse d’un exemple pour notre belle jeunesse, l’auteur en a rajouté une louche dans le genre « grand public ». Alors, les vestiaires sont « de douleurs et de déchirures », on a la tronche « imbibée d’alcool », on se balade « d’une fille-pute à une fille de pute », la débandade est « programmée », d’ailleurs : « elle aurait fait fuire (sic !) le premier homme d’affaires venu ». Dans le meilleur des cas, on dirait Les nuits fauves (c’est dire le niveau !), dans le pire Interview… De temps à autre, on ne peut s’empêcher de sourire, sans doute parce que l’on a mauvais esprit, lorsque Christophe suppose que les Acariès sont honnêtes et qu’il va récupérer un jour ou l’autre le pognon qu’il s’est fait piquer en Suisse.
La raison de cet échec est simple : celui qui a été chargé de l’écriture de ce livre, Alain Azhar, n’a pas le niveau requis par son sujet. Lorsque l’on parle de littérature (et non pas d’imprimerie), il faudrait toujours avoir présent à l’esprit ce que l’on fait perpétuellement mine d’ignorer : pour écrire un livre, il faut être un écrivain. Tout le reste c’est du pipeau ! Il ne viendrait à l’idée de personne, sous prétexte qu’il a deux poings, de croire qu’il peut devenir champion du monde des super-moyens ; cela reste un mystère que, sous prétexte que l’on « sait » écrire (on a appris à l’école), n’importe qui puisse se baptiser écrivain ou même « professionnel » de l’écriture.
Finalement, toute cette prose à l’épate fait remplir à Tiozzo le rôle que notre société offre aux idoles déchues et donne au lecteur bonne conscience tout en lui permettant de jouir de sa veulerie. Elle aura, heureusement, beaucoup moins de conséquences sur les finances de l’ancien champion du monde que les judicieux conseils que lui a dispensés son ancien manager, Jean-Christophe Courrèges, mais on peut regretter, là encore, que Christophe ait été mal conseillé. Résultat des courses : on lui a salopé sa bio comme on lui a salopé sa carrière et comme il a salopé sa vie. C’est dommage !
La littérature et la boxe, qui en ont vu d’autres, s’en remettront… Lui ? Faut voir !
Homeboy
La boxe c’est avant tout de la violence pure et ce qui frappe le plus dans la violence, hormis la masse par la vitesse au carré, c’est son invisibilité. Un coup de poing va aussi vite qu’un coup de couteau, en un instant on est mort et l’arbitre compte, le sang ne coule pas forcément.
Le cinéma a toujours eu un problème pour représenter ce qui n’est pas spectaculaire et la violence, contrairement à ce que le cinéma fait croire l’est moins que tout. Le ralenti est le moyen le plus usité actuellement ; plus que paradoxal, il est immoral car si la violence et la mort sont présentes sur un ring et dans le monde elles n’y mettent aucune complaisance.
Pour qu’Homeboy n’échappe en rien aux stéréotypes il y a au moins un effet de ralenti par scène de combat et il y coule une barrique de sang (225 litres). Sans parler, bien sûr, du nombre hallucinant de coups directs que se portent les boxeurs sans trop sourciller (Emile Griffith tua Benny Paret en dix-huit coups de poings) et du bruit effrayant qu’ils font.
Comparées au reste et par le seul fait que Mickey Rourke remue davantage comme un boxeur que Sylvester Stallone, les scènes de boxe sont ce qu’il y a de moins effroyable en une heure et demie de projection. Attachez vos protège-dents : sa mère était folle, son père buvait, pour arranger le tout, ils l’ont appelé Johnny… Johnny Walker. Encore heureux, lorsqu’il n’était que “baby” sa grand-mère était chouette avec lui, elle lui faisait faire des tours de manège en le gavant de Marshmallows. Devenu grand, il est un peu autiste, on le saurait à moins. Il boit beaucoup par atavisme, surtout avant ses combats où, en souvenir de son aïeule, il porte des culottes en peau de vache. Il n’a pas trop à se plaindre, son copain a été trouvé tout bleu dans une boîte à lettres, sa copine est propriétaire d’un manège en panne qu’elle essaye de réparer avec une clé à molette foirée et ses poneys ont la colique.
Johnny Walker boxe. Des fois il gagne, des fois il perd. C’est la vie ! Il en prend surtout plein la tronche, ce qui lui procure des visions comme à Henri Michaux. Il en prend tellement plein la tronche qu’il a l’os temporal bousillé, à tel point qu’il peut en mourir à la moindre chiquenaude. Pour se reposer il se promène avec sa copine dans des paysages filmés avec des focales pas ordinaires. Pour lui changer les idées son pote lui propose un hold-up à mains nues, seulement il a un match qu’il ne peut pas décommander le même jour au cours duquel il crache un demi-muid (135 litres) de sang au ralenti. Pendant ce temps son copain qui n’a pas renoncé à toucher le gros lot se fait descendre et sa copine repeint sagement ses chevaux de bois. Comme, en définitive, son os temporal a tenu le choc Johnny Walker retrouve sa copine qui a allumé son manège. C’est fini et tout le monde est bien soulagé.
“Moi j’essuie les verres au fond du café” n’est pas moins tartignolle, mais avec un truc pareil Piaf vous tire toutes les larmes du corps, Michaël Seresin n’arrive qu’à être grotesque. Les quelques rangs qui ne somnolent pas ricanent mollement.
Si l’on a des sous et que l’on veut savoir ce qui se passe sur un ring, mieux vaut acheter De la boxe (Stock) de Joyce Carol Oates (et oui ! une femme…). Si l’on a du temps à perdre, on peut aussi guetter une hypothétique reprise de Fat City, un des plus beaux films de John Huston et l’un des plus mal distribués. Pas un seul ralenti autant qu’il m’en souvienne…
La jeune fille et les ombres
Antonia Logue. Double cœur. Editions Calmann-Lévy
Double cœur arrive sur le marché précédé d’une réputation à tout casser. Antonia Logue figure déjà dans les vingt et un écrivains anglais qui marqueront le siècle ; son ouvrage a été vendu dans sept pays à la simple lecture du prologue et a obtenu l’Irish Times Literature Prize en 1999. Il présente – a priori – trois avantages aux yeux des professionnels et du public : c’est une bonne idée, c’est écrit par une femme qui connaît que dalle à son sujet et c’est extrêmement mal traduit de l’anglo-saxon. Il ne serait donc pas étonnant que Double cœur se retrouve en tête de gondole avec un mot du libraire griffonné vantant son intérêt et sa profondeur avant de finir dans le bac des soldeurs qui raffolent, eux aussi, des ouvrages à jaquette bariolée.
Miss Logue a imaginé que, vingt ans après sa disparition, Arthur Cravan demandait à Jack Johnson de prendre contact avec sa femme Mina Loy pour savoir si elle l’aimait encore. L’argument est légèrement tiré par la coquille, mais l’auteur a tous les droits, qui kidnappe de la sorte trois excentriques dont la vie est bien mieux qu’un roman.
Arthur Cravan d’abord, le « poète aux cheveux les plus courts du monde », qui préférait la boxe à la littérature et les brutes nègres aux pâles professeurs, ce qui le rend sympathique et impressionne les littérateurs dispensés de gym tout au long de leur scolarité. La réalité est plus cruelle : Cravan, champion de France amateur sans disputer un seul combat, a pris dérouillée sur dérouillée chaque fois qu’il est monté sur le ring. La dernière fois à Barcelone en 1916 contre Jack Johnson.
Le premier Noir champion du monde des poids lourds, exilé en Europe pour ne pas finir en prison, vivait à l’époque d’arnaques de ce genre pour continuer à entretenir ses femmes (blanches), acheter des voitures (de course) et ouvrir des bordels. À côté de lui, Tyson ferait figure de premier communiant ; après qu’il eut massacré James J. Jeffries, on releva 19 morts et 251 blessés aux quatre coins de l’Union. Ali n’existerait pas sans lui, pas plus que Dada sans Cravan.
Dans son genre, Mina Loy n’était pas mal non plus : femme libérée, peintre d’avant-garde, poétesse scandaleuse, elle pose pour Man Ray, un thermomètre en guise de boucle d’oreille, rencontre Cravan à New York (il y donne des conférences où il tire des coups de revolver à poil), le suit au Mexique où il disparaît sous ses yeux en essayant le voilier qui devait les emporter. Il lui laissera une fille, Fabienne.
Miss Logue a composé son livre autour de l’absence de Cravan (le titre original est Shadow-box, astucieusement traduit par Double cœur) comme on monte une tour de Babel en Lego : Jack écrit à Mina qui écrit à Jack et ainsi de suite… chacun raconte sa vie. La fiction vue comme un sandwich-club ! Avec quelques interludes en italique pour tenir le rôle décoratif de la salade : l’un du fait de Cravan (pour que l’on comprenne bien que son absence est, en réalité, une présence), les autres de sa fille qui semble – Dieu sait comment – au courant de l’intrigue. Cela permet à l’auteur, s’appuyant sur la documentation ad hoc, de se montrer aussi à l’aise dans la peau d’une poétesse que dans celle d’un boxeur.
Mina fait l’expérience de la liberté qui « équivalait à être perchée sur une échasse et appuyée contre un mur en cherchant déjà le suivant », dans ces conditions périlleuses ses idées « se mettent à saigner » ; à peine remise, elle croise Marinetti dans un salon : « tandis que je circulais dans la pièce, je sentais mon dos cloué par les stigmates de son regard ». Persécutée de la sorte, on comprend qu’elle se réfugie dans les bras de Cravan, surtout que « les expressions de son amour coulaient, plus épaisses que de la cire chaude », bien qu’une fois le corps d’Arthur disparu, elle soit « incapable de concéder qu’il était parti » alors même que « l’émotion prédominante était un soulagement débridé ».
Pour ce qui est des dons acrobatiques, Jack Johnson n’est pas en reste puisque son adversaire « penché pour essayer de se battre contre son plexus solaire du plus près possible » lui envoie de « grands coups de balancier dans le ventre… qui lui ébranlaient la tête et les pieds » ; encore heureux, il les écarte « d’un uppercut du gauche à la poitrine, utilisant son aisselle pour faire levier… avant de l’envoyer dinguer, telle une porte sur ses gonds, d’un uppercut volant sous le menton », ce qui a pour effet de laisser l’imprudent « inerte en dehors de son rythme cardiaque ».
Tout cela est très approximatif, qui donne du réel l’impression qu’en donne la lecture d’un mode d’emploi de répondeur numérique, mais, en réalité, nullement rédhibitoire. Toute l’affaire repose sur le sentiment que l’anglo-saxon nous est supérieur en tout et que, face à lui, nous ne saurions, bien entendu, exister dans le détail. Lorsqu’il s’agit de boxe par exemple ; à tel point que l’on a vu la critique encenser la biographie de Liston (Tosches) alors qu’elle n’est pas encore traduite, comme elle l’avait fait du Combat du siècle (Mailer) et de Tricoté comme le diable (Algren) qui oscillent entre médiocre et franchement mauvais.
En réalité celui qui domine le monde domine la culture et les dominés se doivent de lui donner des signes voyants de soumission.
Ainsi va la littérature chez les Bonobos.
Fat City

Des films sur la boxe, il y en a un paquet, des tartignolles encore plus. On y voit, en CinémaScope, des types vomir de pleins baquets d’hémoglobine au ralenti, puisque le cinéma n’a rien trouvé de mieux pour rendre la violence spectaculaire ; alors même que la vraie violence est si rapide que l’on se demande si elle a bien eu lieu et qu’elle n’est pas vraiment spectaculaire. Pas un seul ralenti dans Fat City et pas beaucoup de sang, du cinéma, cela suffit et du respect pour ce que l’on filme, ce qui crève les yeux.
Tiré du roman culte (jamais compris pourquoi) de Leonard Gardner, Fat City était l’un des films préférés de John Huston, c’est pour cela, sans doute, qu’il est si mal distribué. Stacey Keach et Jeff Bridges y sont impeccables*. Ça parle de boxe bien sûr et pas qu’un peu, mais aussi de l’amour, de la vieillesse et de la mort, de sentiments inusités et de vertus oubliées. « It’s so sad to be alone** », y chante Kris Kristofferson, si triste qu’il vaut mieux, pour ne pas que ça vous arrive, se battre avec quelqu’un, se taper une poufiasse ou bien boire pour oublier que l’on a perdu et que l’on sait maintenant « quelque chose que ceux qui gagnent toujours ne sauront jamais ».
* Je ne compte pas Susan Tyrell (aujourd’hui cul-de-jatte) qui les écrase tous aussitôt qu’elle apparaît
** « Yesterday is dead and gone/And to morrow out of sight »
Lettre à LIRE
Pierre Assouline,
Sur un ring, j’étais plutôt rapide, dans la vie, il m’arrive d’être lent. Ce qui explique que je vous écrive si tard pour m’étonner de voir figurer « La brûlure des cordes » de F.X. Toole parmi les 20 meilleurs livres de l’année dans votre numéro de déc. 2002-janv.2003.
Je veux bien, vous n’aviez, peut-être, rien d’autre à vous mettre sous le hit-parade (ce serait inquiétant) et vous faites comme vous l’entendez, mais avez-vous porté un peu d’attention à la manière dont ce livre a été traduit ?
Passons sur les aspects techniques de la chose… Bernard Cohen n’avait peut-être pas de calculette sous la main et il préfère le badmington à la boxe, ce qui est parfaitement son droit, mais tous les boxeurs excèdent d’une dizaine de kilos la catégorie censée être la leur, il leur arrive d’hériter d’un ring (prudemment qualifié, il est vrai, d’exigu) de cinq mètres carrés, soit un peu moins de 2,5 mètres de côté, juste la place de s’y coucher « pas toujours à cause d’un KO qui les étalerait par terre mais plutôt par peur d’un knock-out ». Thomas « Hit Man » Hearns est rebaptisé Thomas la Cogne Hearns, c’est un « puncher » qui « sert des punchs avec ses seuls bras » (connaissant Hearns, c’était largement suffisant). Ce, entre autres fantaisies…
Même si l’on n’est pas abonné à Canal+, on ricane.
Là où le traducteur se surpasse, c’est dans le courant du texte. J’ai bien dû noter une centaine de passages hilarants. J’en ai retenu quelques-uns à votre attention. Histoire que vous jugiez sur pièces.
Le narrateur soigne son « pugiliste » pour « lui envoyer de l’énergie au travers de la cloison nasale », « depuis qu’il a passé pro », il a travaillé « avec une branlée de champions ». C’est dire si on peut lui faire confiance pour que ses champions n’en prennent pas une (branlée).
Ravigoté « grâce aux vitamines qu’on lui administre par sonde », son « pugiliste », « après s’en être tenu à « des jabs en petits coups de patte » « charge avec un grand crochet » (a big hook en VO), il s’emplit « de la magie de la compréhension et de la sensation de puissance » (Il devrait faire gaffe !).
Son adversaire, qui n’est pas en reste, lui « châtie le coude gauche d’un uppercut du droit », il lui délivre des « coups à la ceinture et sur le côté en prenant des angles » avant de lui placer sa botte de Nevers : « un direct du droit dans les reins », le genre dont « l’impact est atténué » mais qui « reste assez violent pour affecter son oreille interne » et, entre parenthèses, rigoureusement impossible à réaliser si l’on ne lui tourne pas le dos.
Il est vrai qu’il y a « encore d’autres frappes autorisées tout aussi terribles »… On s’en doute ! On redoute tous ce genre d’acrobaties et l’on est reconnaissant que l’on nous les épargne.
Malgré les soins dont il est l’objet, et comme son adversaire continue à lui « banguer sur la tête », il n’a plus d’autre solution que « s’enfuir dehors » où il retrouve sa mère, une jolie femme avec des traits « à la fois plats et délignés, qui font d’elle l’image même de la mère de l’Afrique » qui l’attendait « en pelletant du riz aux haricots » dans un « kiosque de casse-croûte ».
« Plus de la peur que du mal ! », il n’y avait « pas de quoi sonner la cloche » d’après Bernard Cohen.
À mon avis, on aurait dû la sonner avant.
Faut pas déconner !
Je suis, il est vrai, de la plus parfaite mauvaise foi en la matière ; j’ai publié un livre sur la boxe (Lève ton gauche ! , Gallimard) ainsi qu’une biographie de Tyson (Grasset) accueillie par un silence assourdissant et je peux donc donner l’image du vilain petit rancunier, il n’en est rien ; en toute immodestie, j’aurais honte d’écrire des conneries pareilles.
Ce qui m’agace en réalité davantage (après tout, la critique, les libraires et les lecteurs font ce qu’ils veulent, ils ne sont pas connus pour leur bon goût et, une fois que j’ai eu l’impression de bien faire mon boulot, je me tamponne le coquillard de la reconnaissance que l’on peut porter à mon travail), c’est la « prime à la traduction » et, surtout, ce qu’elle signifie : la soumission à un ordre.
Je vous prie d’agréer, Pierre Assouline, l’expression de mes salutations les meilleures
Interview exclusive de Phil Knight, président du CIO

Monsieur le Président, comment se porte le CIO quelques mois après les circonstances dramatiques qu’il a vécues et quelques mois avant l’ouverture des prochains jeux Olympiques à Kouan-Tcheou ?
Après le lâche assassinat dont a été victime Emanuel Hudson, ce n’est pas le seul CIO qui a accusé le choc, mais l’ensemble de la communauté sportive. Emanuel Hudson a été un président aussi remarquable que l’avait été Avery Brundage. Certains l’ont critiqué pour avoir calqué les méthodes des multinationales dont il était familier à la gestion du CIO, mais chacun, au vu des résultats, ne peut que s’en féliciter. Après sa disparition plus une seule voix ne s’est élevée contre sa politique, cela simplifie grandement ma tâche, je n’ai plus qu’à mettre mes pas dans les siens.
Le temps a fait son travail, le CIO et ses membres ne sont plus sous le choc, chacun d’entre nous, en revanche, espère que le jugement du coupable et de l’organisation dont il faisait partie, diffusé en direct avant la cérémonie d’ouverture des Jeux, sera exemplaire et découragera toute autre tentative de ce genre. Nous n’avons plus désormais, en dehors de celui-ci qu’un seul objectif : le succès des prochains JO.
Ne craignez vous pas que le choix de Kouan-Tcheou pour la tenue de ces jeux ne soit prématuré peu de temps après l’arrêt des conflits dans cette zone ?
Bien au contraire, l’olympisme a toujours été un vecteur d’universalisme, de paix, d’humanisme et de réconciliation entre les peuples, l’Empire du milieu, la Chine du Sud, la Chine de l’Est, le Japon, les États-Unis et l’Inde, tous les pays qui ont été impliqués dans ce conflit participeront ensemble à ces jeux. Dans ces conditions, je dirai que le choix de Kouan-Tcheou n’était pas le meilleur choix, à mes yeux il était le seul possible.
À ce propos, on ne peut s’empêcher tout de même d’évoquer le problème de la sécurité, celle des athlètes comme celle du public…
La sécurité sera assurée. Le gouvernement de la Chine du Sud et le CIO ont travaillé ensemble dans une atmosphère de collaboration responsable avec l’aide financière de Montesanto, d’American Express et l’appui technologique de la Bill Gates Foundation et de Lookheed. Cela peut apparaître à certains comme un paradoxe effroyable, mais les découvertes technologiques qui ont été perfectionnées lors de ce conflit vont nous permettre d’atteindre le risque zéro. C’est la première fois que les méthodes de traçabilité seront appliquées à une telle échelle. Toute personne présente, sans exception, se verra greffer une puce électronique reliée à un ordinateur central qui traitera en temps réel toutes les informations reçues. Tous les flux et tous les éléments qui composent ces flux seront ainsi sous nôtre contrôle absolu. Dans ces conditions, on ne peut même plus vanter l’efficacité de la répression, le système que nous avons mis au point est le système de dissuasion et de prévention le plus perfectionné qui ait jamais été mis au point. Ce système a fait ses preuves, à une échelle limitée, lors des derniers championnats du monde où aucune agression sexuelle n’a été à déplorer.
Certains ont ironisé sur ces mesures en disant qu’elles étaient inutiles dans la mesure où les caractéristiques sexuelles des athlètes étaient de moins en moins discernables.
C’est une autre question. Ces jeux seront, peut-être, en effet, les derniers où les sexes seront séparés puisque les performances des filles sont de plus en plus comparables à celles des garçons, mais laissez-moi vous dire que la question de la différenciation sexuelle est une chose, que celle du viol en est une autre et qu’il n’y a pas à ironiser là dessus.
Cela nous amène à aborder la mesure qui a déclenché le plus de critiques au sein de l’Union européenne : l’abandon de tout contrôle toxicologique et de tout suivi médical sous le contrôle des fédérations nationales, ce qui, clairement, veut dire que tout est désormais autorisé. Pourriez-vous faire le point sur cet ensemble de mesures et la nouvelle situation ainsi créée ?
Je trouve très étrange que ce soit l’Union européenne qui ait été la plus présente sur ce front alors que c’est sur son territoire que l’on a entendu pour la première fois le slogan : « Il est interdit d’interdire », c’est un principe que nous exprimons différemment en affirmant que tout sportif use de son corps comme il l’entend, et que c’est dans ses laboratoires qu’ont été menées les recherches les plus sophistiquées sur le clonage, l’embryologie et la génétique, mais enfin, la vieille Europe a toujours des pudeurs de vieille fille…
Si je veux vraiment répondre à votre question, il faut que nous fassions un peu d’histoire… un peu de biologie aussi et je ne suis pas certain que nous soyons tous les deux d’éminents spécialistes en biologie.
Vous n’êtes pas sans savoir que le CIO a été en son temps à la pointe de la lutte contre ce que l’on appelait encore le dopage. Vous n’ignorez pas non plus que cette lutte était absurde dans la mesure où elle mettait en place des procédures de détection de produits indétectables puisque leur structure était aisément modifiable. Absurde, mais aussi anti-démocratique puisqu’elles faisaient des athlètes d’éternels mineurs et, dans la mesure où ne bénéficiaient de ces traitements que ceux qui pouvaient se les offrir, pire encore, cette politique s’est avérée dangereuse, le cas des trois athlètes africains décédés il y a une dizaine d’années à la suite d’injection de PFC l’ont bien démontré.
De toutes les façons, l’évolution de la biologie et la révolution génique ont clos définitivement cette période, il n’est plus nécessaire d’absorber un quelconque produit pour faire produire à votre corps tel ou tel autre produit, il peut le faire désormais naturellement.
Ces nouvelles conditions posent tout de même des problèmes moraux et pas seulement sportifs, le problème central c’est celui de la nature humaine…
Mais la nature humaine n’existe pas ! Il n’existe qu’une culture humaine. Certains utilisent à dessein le terme post-humanité pour insinuer que nous avons abandonné les valeurs qui fondaient autrefois l’humanité, tout cela est faux, l’humanité n’a jamais été la même. En sport, on ne court plus sur cendrée, on ne saute plus en ciseaux, les perches ne sont plus rigides, est-ce que cela veut dire que le sport n’existe plus ? Non, bien évidemment. Chaque avancée technologique fait changer l’humanité, il y aura toujours des rétrogrades pour se lamenter à ce propos, ils disparaissent au bout de deux ou trois générations comme les espèces inadaptées.
Il n’empêche que l’on peut être inquiet, à juste titre ou non, en voyant l’apparence de certains athlètes qui semblent tout droit sortis de l’imagination des auteurs de science-fiction du siècle dernier.
Mon fils fait vingt centimètres de plus que moi, nous avons choisi ensemble pour quelques-uns de ces centimètres, les autres c’est l’évolution de l’espèce qui les lui a fait gagner, les implants de carbone pour les participants de l’épreuve d’absolut-fighting, on n’y fera pas plus attention, dans quelques années, qu’à la disparition du canoë-kayak du programme. Des pratiques disparaissent, d’autres les remplacent, c’est la loi du marché, c’est la loi de la vie. L’apparence des hommes et des femmes change, c’est un fait, ce qui est une réalité c’est qu’elle change en mieux et qu’elle n’est pas synonyme des conditions de vie apocalyptiques que les auteurs dont vous parlez liaient à ce changement. Les conditions de vie de chacun s’améliorent en permanence, chacun en est le témoin et l’apparence des sportifs l’exemple le plus voyant.
Une dernière question encore, si vous le permettez, verra-t-on un jour Jesse Owens, Bob Hayes, Carl Lewis, Ben Johnson Maurice Greene et Lloyd Heffner s’aligner dans le même 100 mètres, comme on nous le promet depuis si longtemps ?
Ce sont les dernières avancées en matière de clonage qui peuvent nous apporter la réponse, le programme CHS (Clone History Sport) financé par Soft-Cola est entamé depuis trois ans seulement. Les derniers entretiens que j’ai eus à ce sujet avec l’équipe de chercheurs à sa tête sont suffisamment encourageants pour que je ne m’avance pas inconsidérément en vous annonçant que cela sera sûrement possible dans les dix années à venir. Imaginez quel 100 mètres de rêve nous allons vivre ! Sûrement un moment aussi exaltant que celui où l’homme a posé pour la première fois le pied sur la Lune, une avancée, en tous les cas, à mon sens, aussi déterminante pour l’histoire de l’humanité.
Le cochon est dans le maïs… transgénique !


Mécontent, Jean Bordenave, dit « l’Ancien », pouvait démonter une palombière à coups de tronche. Sur le terrain de « ruby » du bled dont il était natif (les années bissextiles, on y plantait du maïs), il se rendait en marchant vers les regroupements (nombreux et confus) d’usage à son époque, mais on pouvait compter sur lui pendant le trajet pour s’occuper de celui dont on lui avait demandé de s’occuper avant le match. Il avait des inimitiés qui remontaient au bornage litigieux d’une parcelle en friche de 3 ares 37 centiares, et ce depuis la guerre de 70.
Son fils, Marc, selon certains indigènes le joueur le plus talentueux qu’ait connu le canton, roi de la biscouette et de la passe croisée, jouait centre, le col relevé, les chaussettes baissées comme il l’avait vu faire aux frères Boniface. Son père ne l’avait jamais trouvé bien vaillant, la semaine, Marc buvait des bières place de la Victoire à Bordeaux avec ses adversaires, étudiants en pharmacie comme lui.
Luc, le petit-fils, perpétue la tradition, il joue flanker en Pro D 2 ; pour rester digne sur le banc des remplaçants, entre deux Samoans fraîchement importés, il est obligé de faire de la musculation trois fois par semaine et de commander sur Internet des « protéines » en bidons de 20 litres. Célibataire, épilé au laser après avoir posé nu, assis sur la béchigue, oint d’écran total, pour un calendrier vendu au bénéfice du syndicat d’initiative des Landes de Gascogne, il a adopté récemment Mathieu, un petit garçon d’origine roumaine qui ne s’intéresse qu’au foot.
La vie de Jean aurait pu inspirer Guy de Maupassant, Antoine Blondin et Marc ont bu des coups ensemble, rue de la Soif, Luc ne jure que par Chuck Palahniuk ; les Bordenave de sexe mâle sont censés, pourtant, avoir le rugby en commun (le foie gras, le jurançon et quelques gènes dans une moindre mesure). Sauf que le rugby de l’un est mort et enterré depuis belle lurette, que celui de l’autre n’est plus qu’un souvenir dont se gargarisent après boire Daniel Tillinac et les nostalgiques du poulet de grain, seul existe celui qui se pratique aujourd’hui, qui ressemble chaque jour davantage à une variante régionale du football américain : percussion/progression/percussion/écran publicitaire. L’improvisation y tient autant de place que dans un logiciel de comptabilité, celui qui tourne dans la batterie d’ordinateurs à la disposition des techniciens nationaux assis dans les tribunes.
Il arrive donc, parfois, tandis que la pièce rapportée roumaine rejoue pour la énième fois Brésil/Croatie sur sa Nintendo, que Jean, Marc et Luc parlent « rugby » ou du moins croient le faire en discutant de l’équipe de France, de sa composition et du jeu qu’elle pratique ; c’est une manière détournée de parler politique (l’attaque est de gauche, la défense de droite, la chistera progressiste, le maul pénétrant réactionnaire) et de s’engueuler à ce propos.
L’ancêtre fait les chœurs en grommelant qu’à son avis Amédée Domenech aurait brisé en un tournemain les cervicales de n’importe quel première ligne moderne ; Luc ne jure que par la sainte Trinité issue des années 80 : Laporte/Sarkozy/Kerviel, et Marc voit la nouvelle équipe, celle de Lièvremont/Ntamack/Retière, comme la possibilité d’une île (où l’on pourrait faire tomber des ballons sous les applaudissements du public pourvu que l’on attaque à la sortie du tunnel) au sein d’un morne océan, celui du pragmatisme anglo-saxon.
Tous finissent par se traiter de « con ! » sans se rendre compte que, désormais, il n’est plus possible de jouer autrement que ne l’exigent les conditions actuelles de représentation. Un sport où la musculation, la préparation physique (euphémisme pudique), les gabarits uniformes (hier, pilier, demain, demi d’ouverture), la vidéo, l’informatique, le spectacle, l’argent ont fait cesser tout jeu. Un sport où il est interdit de s’amuser sans risquer de se faire taper sur les doigts (par le staff), rappeler à l’ordre (par les diffuseurs) ou couper les vivres (par les sponsors).
Quand l’économie se généralise, que le chiffre est la seule notion comprise par tous, les conditions de vie deviennent semblables, la culture s’uniformise et les goûts, les couleurs et les jeux. La stratégie des équipes victorieuses (les seules qui comptent) se décide à la Bourse et non pas aux zincs de Grignols et de Villeneuve-de-Marsan ; la composition de l’équipe de France aussi et son style avec. De manière si voyante qu’il n’y aura même plus moyen dans un avenir proche de s’y traiter de « con ! » pour le plaisir.
Ce texte m’avait été commandé pour GQ par Jacques Braunstein. Il ne sera pas publié.
Jacques Braunstein le trouvant, non pas « pas très bon » (c’est vrai qu’il n’est pas excellent)
sinon « franchement mauvais » (ce qu’il n’est pas non plus),
mais plutôt contraire à la démarche des rédacteurs en chef d’aujourd’hui
(qui ont l’âge de mes fils) désirant des textes critiques, bien sûr,
mais ne désespérant pas pour autant Jean Bouin
(et les propriétaires d’une carte d’abonnement à un club de remise en forme)
ou Boulogne-Billancourt et ses abonnés à GQ.