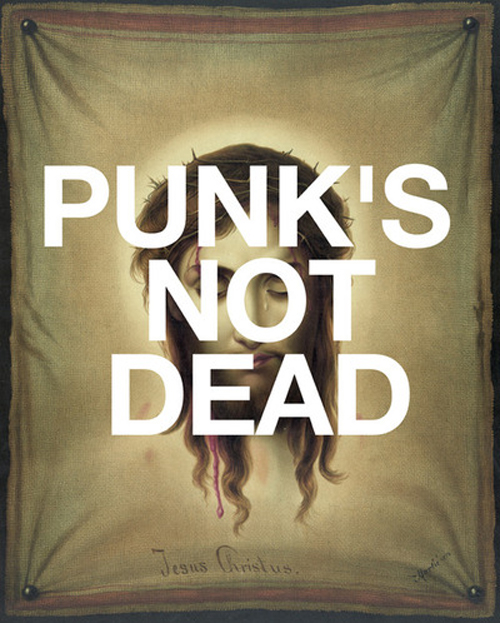INÉDITS
Interview Frédéric Roux
par Michaël Sebban
pour la revue Studio
Sebban
Pourquoi, à ton avis, lorsque l’on parle de Présence Panchounette, on parle automatiquement de l’I.S. ?
Roux
Pour de bonnes et de mauvaises raisons… C’est-à-dire : les mêmes… On avait, tous, plus ou moins vingt ans en 68 et l’on n’était ni maoïstes ni trotskistes, ce qui était plutôt original à l’époque pour des types qui n’étaient pas non plus communistes ou gaullistes… On n’était pas contents du monde et pas contents non plus de ceux qui n’en étaient pas contents… Tu vois ?
Sebban
Vaguement ! Mais l’I.S. ?
Roux
C’était les seuls qui n’avaient pas l’air contents et qui n’aimaient pas les militants… on a trouvé qu’ils nous ressemblaient… En réalité, ils nous ressemblaient qu’à moitié, ils n’étaient plus très jeunes, nous si… Ils étaient cultivés, nous, pas tellement… Ce qu’ils racontaient nous paraissait comme étant le plus proche de ce que l’on pensait… confusément. Ça nous donnait l’impression d’être moins seuls ! Il faut comprendre que l’époque n’inclinait pas à la rigolade… les militants étaient pires que des scouts, toute la journée occupés à rédiger leurs fiches… pas une gonzesse… la discipline, le parti, le catéchisme… en rang par deux et silence dans les rangs ! Des flics ! Si l’on était plutôt enclins à pencher à gauche, on était aussi des habitués des rangs du fond… des petits délinquants… des branleurs ! C’est de cette conjonction, somme toute banale, qu’est venue notre familiarité avec le situationnisme. Du fait, aussi, que l’on venait « esthétiquement » du même endroit : le surréalisme ; avec, chez nous, des intrusions dans le petit monde du surréalisme dégénéré, du kitsch : les romans-photos, les cartes postales, les cendriers anthropomorphes. Il faut, aussi, préciser qu’à l’époque nous n’étions pas très nombreux… la revue de l’I.S. circulait comme les samizdats circulent… « T’as lu ça ? » « Non ! » « Lis-le, tu vas voir ! ». C’est en vente libre partout maintenant, mais à l’époque, non. Et tous ceux qui, aujourd’hui, sont idolâtres, hier, soit ils ne connaissaient pas, soit ils étaient violemment opposés. Le surréalisme : pareil ! On n’utilisait pour ceux qui y étaient restés collés et qui, il est vrai, n’étaient pas très brillants que l’épithète « surréalisant » qui voulait dire : un peu crétin ; la modernité c’était la grande peinture abstraite à l’américaine mélangée au matérialisme dialectique… C’est pour te dire la confusion qui régnait… C’est pour ça, hein ! Faut pas me la faire…
Sebban
Comment ça ?
Roux
Si l’on avait été plus nombreux à l’époque, peut-être que les choses seraient différentes aujourd’hui, non ? Peut-être que cet engouement tardif vient du fait que ces théories sont devenues inoffensives… C’est comme être anti-raciste dans le XVI° ou, je suppose, pro-palestinien dans les beaux quartiers de Tel Aviv… c’est pas mal, c’est toujours ça, mais c’est plus facile qu’ailleurs… ça mange pas de pain. Le côté radical-chic… « J’suis très râââdicââle, tu vois ! » quand ça se paie pas… la peau sur la table, j’me méfie ! Et des situs, on s’est aussi méfié très vite… On est des types méfiants !
Sebban
De quoi vous vous méfiez ?
Roux
De ça justement… du côté radical… C’est bien joli de dire qu’on va tout casser, mais qui va commencer ? À mon avis c’est encore nous qui allons nous faire péter la gueule, alors… que les grandes gueules passent devant ! C’est plus facile de proclamer que le monde va changer de base que de demander à son voisin balèze de baisser la radio !
Et puis, il y avait, aussi, le côté secte auquel on a été sensibles dès le début et qui nous plaisait qu’à moitié. Déjà l’aspect « happy few », c’était limite ! Mais l’adoration sans condition, on marchait pas ! C’est l’avantage du cancre, il marche pas dans la combine… Il ne sait pas pourquoi, c’est l’inconvénient… il est infoutu d’expliquer pourquoi, mais il veut pas y aller, il freine des quatre fers !
Les analyses, j’suis encore d’accord, c’est plutôt juste dans l’ensemble, bien plus juste, en tous les cas, que ce que produisait la pensée critique à l’époque… Ce qu’ont pu soutenir des types, soi-disant supérieurement intelligents au nom du Maoïsme, par exemple, c’était quand même croquignolet… faut pas oublier non plus ! « Lumière divine ! » « Pasteur de tous mes troupeaux ! » « Arc-en-ciel de la dialectique ! » Les deux pieds dans des torrents de sang, ça mérite davantage que deux heures de retenue… Passons ! De l’intelligence, il ne serait pas juste d’être banni à vie, mais il y en a à qui on pourrait demander leurs papiers plus souvent… Les analyses, donc, d’accord ! Elles sont d’ailleurs presque entièrement reprises de l’École de Francfort, d’Adorno, de Benjamin qui avaient l’avantage de ne pas être si péremptoires. La posture, l’attitude qui allait avec, on était moins pour…
Sebban
Alors ?
Roux
Alors, c’est pour ça que nous dire situs, c’est un peu abusif…
Sebban
Tu peux préciser ?
Roux
Dans un sens, notre attitude était bien en deça de celle des situs… nous, on faisait de l’art, ils n’en voulaient plus, nous n’avions pas de projet révolutionnaire, eux, si ; mais, d’un autre côté, le regard critique que nous portions sur eux n’était pas dénué d’acuité.
Sebban
Tu peux nous parler du détournement qui est commun aux situationnistes, à Présence Panchounette et aux jeunes artistes ?
Roux
Il est commun à bien d’autres… c’est le problème… un de plus ! Le détournement vient de bien avant le situationnisme, même si c’est eux qui l’ont le plus abondamment théorisé. Il vient de la métaphore forcée, du romantisme, de Lautréamont, du surréalisme, il s’est étendu maintenant au monde de la marchandise. La publicité ne fonctionne pratiquement plus que sur ce modèle. La dérision, le second degré sont les modes privilégiés de son fonctionnement jusqu’à ce plus personne n’y retrouve les siens. C’est sa limite : l’affolement perpétuel du sens jusqu’à ce que plus rien ne veuille dire quelque chose…
Les jeunes artistes n’en parlons pas ! Ils ont oublié que les situationnistes voulaient la fin de l’art, sa réalisation… Que gagner sa vie en édulcorant des théories radicales leur apparaissait comme lamentable et participer de ce à quoi ils voulaient s’opposer…
La fin du détournement c’est, qu’à son tour, il est détourné jusqu’à ne plus être qu’un procédé stylistique dépourvu de sens.
Il n’empêche, bien sûr, qu’il peut avoir, de temps à autre, son utilité, son efficacité, mais elles ne sont pas automatiques… Pour les jeunes artistes le détournement n’est plus qu’un fétiche et les fétiches ne sont plus que des procédés qui ont perdu leur poids ; lorsque les valeurs sont en crise, il n’y a plus de blasphèmes qui tiennent !
Sebban
Et tu penses que c’est là que Debord a été pris au piège ?
Roux
Il a été pris au piège comme tout un chacun le serait, car il n’est pas Dieu ! Acculé au temps qui le rattrapait il n’a pu que produire son dernier film avec l’aide de Canal +, la chaîne du spectaculaire intégré. C’était le dernier geste possible, mais il ne pouvait que mener à la mort. Il n’y a pas manqué… il s’est tué avant même qu’il ne soit diffusé. C’était la seule solution envisageable ! La dernière posture qui ait du panache, mais qui, en même temps, voulait dire qu’il avait échoué, qu’il était rejoint par ce qu’il haïssait. Que le spectacle est une vieille lune platonicienne : il y a un monde et son ombre et il n’y a que l’ombre qui nous soit perceptible. Au-delà de ce mensonge, il y a un Paradis qui nous est rendu inaccessible par l’État moderne, les vilains capitalistes, les médiatiques qui tiennent le rôle que tient le Mal dans les religions. Que le détournement est désormais le mode privilégié d’expression de la marchandise. Que le plagiat accouche du post-modernisme… Rien de très réjouissant ! Largement de quoi se faire sauter le caisson !
Sebban
Tu en es arrivé, dans certains textes, à faire le reproche à Guy Debord d’être réactionnaire, ce qui apparaît, a priori, comme un paradoxe. Tu peux me préciser ta position là-dessus ?
Roux
Ce n’est pas un paradoxe, c’est de la grammaire ! Debord est réactionnaire dans le sens littéral du terme, il suffit de lire ce qui suit la Société du spectacle, il n’y est question que du temps où Paris était une vraie ville, où l’air était respirable et où le vin avait le goût du vin. Ce sont les ratiocinations habituelles du vieillard contre le bel aujourd’hui… après « demain on rasera gratis », hier c’était mieux ! Si ce n’est pas réactionnaire, je ne vois pas ce qui peut l’être. Sans parler de l’affectation de grand style… Faut pas déconner ! Écrire comme le cardinal de Retz, c’est faire l’impasse sur Joyce… Céline, et j’en passe !
Tout son dernier film, assez beau d’ailleurs, est marqué au coin de la nostalgie, de la mélancolie et ce sont deux tendances qui mènent tout droit à une attitude politique réactionnaire… Je veux bien en discuter, mais je crois que, là-dessus, je ne suis pas loin d’avoir raison.
Tout le monde a tendance à accepter tout de Debord comme si tout devait être accepté sans examen, comme s’il ne faisait qu’un alors qu’il y a deux sinon trois Debord. Le premier, artiste influencé par le dadaïsme, la fin du surréalisme, le lettrisme… pas très bon artiste d’ailleurs… tartiner : « Ne travaillez jamais ! » c’est comme peindre le prolétariat marchant sur les eaux du Yang Tsé… un peu littéral sur les bords ! Le second, le plus intéressant, hégélien hystérique d’ultra-gauche, paranoïaque, mais incontournable si l’on veut étudier la pensée critique contemporaine et lui donner une suite. L’enthousiasme que l’on peut avoir à l’égard de ce Debord-là doit être tempéré par le fait que, politiquement, il se gourre tout le temps : il voit Mai 68 comme ce qui va ébranler le monde, on voit ce qu’il en a finalement été : un renouvellement des élites. Il se branle à sec. Résultat des courses, rien n’a changé, tout est pire qu’avant. Le troisième fait un retour sur le premier, son projet n’est plus qu’artistique, le prolétariat a disparu… Il n’est plus question que de l’horreur que la domination fait régner dans le monde et il n’y a plus d’instance envisageable qui peut y mettre fin. Si la mort règne, la mort gagne… il ne reste plus qu’à se la donner, à en faire la bande annonce de son testament et il ne reste plus à ceux qui n’avaient pas vu le coup venir qu’à se frapper la poitrine… « On n’avait pas voulu ça ! » Mon œil, vous ne vouliez que ça !
Sebban
Tu penses donc qu’il n’y a pas d’avenir pour le situationnisme ?
Roux
Je n’ai pas dit ça ! Il n’y a pas d’avenir pour le situationnisme tel qu’il est révéré par les gardiens du temple. Il n’y aura d’avenir pour le situationnisme que si ceux qui ont de l’intérêt pour ces choses-là s’obligent à un réexamen critique du situationnisme. S’ils s’essaient à le dépasser… il n’y a rien, a priori, d’indépassable ! Tous les espoirs sont donc permis… c’est l’apanage des espoirs !
Sebban
Pour finir, tu peux me dire ce que tu penses de ceux qui, en Israël, parlent de « Société du spectacle » ?
Roux
C’est grotesque ! Il suffit de regarder par la fenêtre pour se rendre compte qu’il est stupide de parler de spectacle en Israël. C’est une mauvaise lecture de la première thèse de la Société du Spectacle où il est écrit que le spectacle domine les sociétés où règnent les conditions modernes de représentation. En Israël, ce n’est pas le cas… Vous êtes en guerre ! Faites la paix d’abord, transformez vos soldats en agents d’ambiance, construisez un centre de loisirs virtuel au milieu de la bande de Gaza, louez le Mur des lamentations à Walt Disney, on verra pour la société du spectacle ensuite… Aucune société n’est post-moderne avant que d’être moderne… Vous êtes dans le religieux… l’agricole… le provincial. Il n’y a rien de honteux à ça. Il faut savoir qui on est et où l’on habite ; on est, sinon, dans le spectacle du spectacle… malheureux et ringard… Je ne vous le souhaite pas
A ma connaissance, cette interview n’a pas été publiée par la revue Studio.
Par la même occasion, on trouvera ci-dessous une nouvelle
qui doit (presque) tout à mon séjour en Israël
où j’avais été invité par Michaël Sebban à donner une conférence
à l’Ecole des Beaux-Arts de Jerusalem
(Ah, l’ancien sergent de sexe féminin qui peignait, sans s’en rendre compte, des bites par centaines !).
Le second tour

L’avantage d’avoir eu un père antisémite, c’est que l’on peut se retrouver avec un fils juif ; l’inconvénient c’est que, pour peu que son père ait été branque, on hérite d’un juif branquignol. « Fils » n’est pas le terme exact, Eli n’est pas de moi, « fils adoptif » serait plus juste, sauf que je ne l’ai pas adopté non plus. Disons qu’il a l’âge de mon fils aîné (qui a un prénom aussi juif que lui), disons, surtout, que le truc le plus juste à son sujet, c’est qu’il est branquignol (mon fils aîné aussi, mais dans le genre goy).
À vingt ans, Eli ne savait pas ce qu’il voulait faire : tueur aux abattoirs, Kenny Slatter, critique d’art, Jacques Derrida, Chuck D ou rabbin. Vingt ans après, il n’a toujours pas choisi et il n’est toujours pas marié au grand désespoir de sa mère, mais il m’a entraîné – entretemps -, et j’ai eu la faiblesse de le suivre : dans des restaurants chinois casher, des boîtes de nuit remplies de jeunes connards, des galeries d’art où je ne mettais plus les pieds depuis un siècle et demi ; il a même réussi à me faire donner une conférence dans une université à Jérusalem où il était vaguement prof. Le pire étant que ce que je leur ai raconté a fait rigoler les étudiants, ce qui, de leur part, est une marque d’intérêt notable, et une satisfaction inouïe pour le conférencier ordinaire. Comme je ne parle pas hébreu, je me demande si ce n’était pas la traduction d’Eli qui était plus marrante que ce que je disais.
J’ai beau lui dire que je m’emmerde souvent dans les endroits où il m’emmène, que ce sont pas des endroits pour un goy de mon âge, que j’y fais autant tache que lui n’importe où avec son chapeau, son pif ahurissant et son goût pour la vocifération, ça ne fait rien, il y tient et c’est vrai que je ne vois pas pourquoi, tant que ça ne me dérange pas outre mesure, je ne lui ferais pas le plaisir de lui faire plaisir.
Cette fois – ça manquait – c’est son côté surfeur qu’il voulait me faire admirer : un week-end complet à Biarritz à le regarder patauger dans les vagues avec un copain à lui, un grand brun aux yeux verts, fils d’un Australien et d’une Israélienne, le seul surfeur qu’il avait rencontré là-bas lorsqu’il vivait en Terre promise. Ils surfaient ensemble à Djezer Zarka, un bled arabe à dix kilomètres de Natanya. C’était le week-end de rêve qu’il m’avait organisé et qu’il était hors de question de refuser sous peine de le vexer comme il est hors de question de l’inviter à déjeuner chez moi pour des histoires de tasses en verre, d’évier double bac, de femme qui peut avoir ses règles en cachette, sans compter quantité d’autres conneries plus ésotériques encore.
— Des tubes, hein, rien que des tubes, se rappelait Victor en tirant sur le pétard qui ne le quittait jamais.
— Et ça craignait pas, j’ai demandé ?
— Après Oslo, ça craignait pas les villages arabes, m’a répondu Eli.
Du surf, j’en ai fait au début des années 70, même à genoux, je n’ai jamais pu prendre une seule vague et j’ai bu cent fois la tasse. Je n’ai jamais été doué pour les sports d’équilibre et les babas m’ont toujours cassé les couilles, je n’ai donc pas insisté outre mesure. Je les ai laissé fumer leurs cônes en regardant les vagues.
Biarritz, ça me disait bien parce qu’avec un peu de pot, entre leurs tubes et leurs joints, je pourrais aller me taper du Jabugo à San Sebastian et acheter des Belicosos à Irùn. Pour les cigares, Eli était d’accord, pour le jambon, pas tellement. On s’arrangerait sur place.
La voiture garée devant le spot, ils ont fixé l’océan un bon moment d’un air pénétré. Y avait, soi-disant, à les entendre, une super droite d’un mètre cinquante, des vraies vagues, puissantes, courtes, tubulaires. Grand bien leur fasse !
— Des barriques, a conclu Victor, dont je commençais à me demander – vu le regard californien qu’il se payait – s’il n’allait pas couler à pic aussitôt qu’il n’aurait plus pied.
Dans la malle, y avait une caisse de bière et du houmous. J’ai ouvert une bière et j’ai goûté le houmous. C’était le meilleur que je n’avais jamais mangé. Je m’en suis mis plein les doigts avant de m’installer confortablement et d’allumer l’autoradio. Si je voulais, pour me distraire, je pouvais regarder le soleil dans le rétroviseur.
Ce con de Victor se démerdait comme un chef, il enchaînait tube sur tube, on pouvait le voir disparaître sous la lèvre et réapparaître au bout de quelques secondes qui semblaient des siècles, Eli essayait de l’imiter, de ramer fort pour prendre le maximum de vitesse et démarrer en travers de la pente, mais il se faisait ramasser comme une crêpe à chaque fois.
— Le Pen est au second tour, je leur ai gueulé.
Ils n’ont pas entendu, ils pataugeaient joyeusement comme des phoques dans leurs combinaisons noires avant de repartir au pic.
— Le Pen est au second tour, j’ai gueulé plus fort.
Victor est revenu le premier après un tube de toute beauté. Manquait juste le photographe. Eli a ramé vers la barre pour effacer l’humiliation.
— Le Pen est au second tour, j’ai fait à Victor pendant qu’il enlevait sa combi.
— C’est pas vrai, il m’a répondu.
— Ils l’ont dit à la radio…
— Putain, c’est con !
Eli a merdé une dernière vague avant de rentrer.
— Le Pen est au second tour lui a dit Victor.
— Et merde ! La dernière fois, ils avaient flingué Rabin… Ils peuvent pas nous lâcher le nœud, merde ! Qu’est-ce qu’ils vont inventer pour nous faire chier la prochaine fois ?
— Tu déconnes ! Y aura pas de prochaine fois avec Le Pen… Ça craint plus que Rabin… avec Le Pen, c’est terminé les conneries, a fait Victor en se tournant vers moi d’un air interrogatif, comme si j’étais un spécialiste, à moins qu’il ne m’ait considéré, vu mon âge, comme une espèce d’arbitre des élégances et de la montée des extrémismes, un type qui avait dû connaître Adorno et Benjamin à la crèche.
— J’en sais rien, je lui ai répondu, j’suis pas juif, mais à mon avis un juif qui tue un juif, ça doit craindre pour les juifs !
— Le houmous est pas dégueu… et des juifs qui tuent des juifs, à mon avis à moi qui suis juif, c’est pas la dernière fois, a postillonné Eli la bouche pleine en décapsulant une bière.
— T’as pas voté, ça craint, m’a fait Victor d’un ton de reproche.
— J’ai jamais voté, je vois pas ce que ça change ce coup là, je lui ai fait.
— Ça change que ça craint… Le Pen, merde ! Ça craint…
— Quand Kennedy est mort, la télé était en noir et blanc, quand Elvis est mort, j’ai eu la trouille que les Beatles se reforment, c’est pas que Le Pen soit au second tour qui va me faire flipper, j’ai essayé de lui expliquer, mais j’avais déjà bu trop de bières pour que mes exemples lui semblent très pertinents.
— Pour du houmous basque, il est vraiment pas dégueu, a insisté Eli.
— C’est tout ce que ça te fait, s’est énervé Victor.
— Ce que ça me fait, c’est que je vais retourner à l’eau et que je vais essayer de faire un tube aussi bon que le dernier que t’as fait.
Eli avait fini le houmous, il se suçait les doigts, je buvais une bière, Victor allumait son joint.
On se faisait la gueule.
— Fais fumer, j’ai dit à Victor en tendant l’index et le majeur dans sa direction.
— Tu fumes, il m’a fait, l’air étonné ?
— Qu’est ce que tu crois ? Tu me prends pour qui ? Je vote pas, mais je fume… Quand j’ai envie de fumer, je fume…
— Au second tour, tu votes alors ? Ça va te faire envie de voter…
— Je crois pas, je lui ai fait, vu le nombre de connards que ça va faire bicher, je crois pas que ça me fera envie… tous ces types qui croient qu’ils s’engagent dans les brigades internationales parce qu’ils vont voter Chirac, vraiment, je crois que ça va plutôt me faire gerber!
— Tu fais fumer, oui ou merde, a demandé Eli d’un ton insistant ?
Victor m’a fait passer son joint et il s’en est préparé un autre aussitôt. Ce type n’avait aucune culture ou c’était le nouveau savoir-vivre : chacun pour soi, chacun sa merde, à bas Le Pen et le Sida !
— Pourquoi « connard », il m’a demandé, l’œil plus californien que jamais ?
J’en avais pour mille bornes à lui expliquer pourquoi il en était un lui-même et pourquoi il fallait voter Taubira* au second tour. Pour tout arranger, son herbe était génétiquement modifiée.
* cf ci-dessous mon appel à voter Taubira au second tour (avril 2002).
Les Deschiens sont lâchés, il faut les boire
En tant que membre de la lumpen intelligentsia et donc à la lisière de la reconnaissance (artiste dilettante, auteur incertain, journaliste à temps perdu, anciennement licencié sans cause réelle ni sérieuse par un hebdomadaire de gauche et récemment licencié par un conseil d’administration socialiste), je ne peux qu’être tenté de joindre mon filet de voix au concert tonitruant donné par les vingt millions d’analystes politiques dont nous avons hérité au soir du 21 avril.
J’admets volontiers que ceux qui se sont le plus lourdement trompés hier sont qualifiés d’office pour être les plus écoutés aujourd’hui, et je n’ignore pas que la rengaine que l’on veut entendre est la plus mélodieuse ; j’essaierai donc, en toute modestie, de prendre le risque de la plus extrême modération et même celui du bon sens, ce qui sera, en cette période où l’intelligence critique est aussi troublée que ses repères, pris pour une grinçante cacophonie.
La plus grande tentation de la démocratie est de ne pas l’être (démocratique) ; des effets fort peu démocratiques peuvent survenir d’une consultation démocratique ; sont-ce des raisons suffisantes pour vouloir dissoudre le peuple chaque fois que son vote déplaît aux élites qui le consultent ?
Culpabiliser tous ceux qui se sont abstenus, tous ceux qui ont voté Atchoum, Grincheux, Simplette, Dur de mèche ou Buste à pattes est coupable ; suivant le stupide principe démocratique qu’il faut de tout pour faire un monde, que chacun a ses raisons que la raison ne connaît pas, et que tous les goûts sont dans la nature, il y aura toujours des nostalgiques de la schlague, de Staline (surtout les Trotskistes) et de l’encre violette, des fervents du Mandarom et des amateurs de boniments pour ne pas voter comme il faut. Il faut sinon revenir au candidat unique.
Avoir honte de la France ne veut pas dire grand-chose (Qui c’est la France ?).
S’imaginer que deux personnes que l’on croise sur dix ont voté Front national est stupide : deux dixièmes de chaque électeur ont voté Front national, exceptionnellement moins pour certains qui ont pourtant voté Front national et souvent davantage pour d’autres qui n’ont pas voté Front national.
Se laver les mains dans l’ignominie supposée des autres pour oublier la sienne est ignoble ; l’emploi de vocables grandiloquents, grotesque, et la convocation de situations passées douloureuses, indécente.
Il n’y a pas très longtemps encore, il était d’usage de penser chez des gens fort instruits que Mitterrand était socialiste, Bernard Tapie plutôt honnête, que Chirac allait réduire la fracture sociale, Christian Blanc sauver l’emploi des cadres moyens et même que Jack Lang, secondé par Patrick Bouchain, allait apprendre à lire aux enfants en leur faisant construire des cabanes dans les cours de récréation, pourquoi donc reprocherait-on aux ignorants de voter pour un démagogue qui va faire augmenter le prix de la barrette et du pack de douze ?
Les gens qui ont voté Le Pen n’ont pas voté Le Pen pour ne pas voter Le Pen ; ils ont juste voté Le Pen.
Jean Marie Le Pen est le seul homme public qui parle politiquement de la réalité telle que le vulgaire peut l’appréhender vulgairement, mais aussi telle qu’elle existe réellement, et qui lui promette un avenir qui lui semble envisageable.
Jean Marie Le Pen n’a jamais été invité par Ardisson, Drucker et consorts pour communiquer au peuple son avis sur la fellation et la sodomie (on peut juste supposer qu’il est pour sa pratique en privé, mais qu’il s’y déclarerait opposé en public), il ne communique donc que du politique, contrairement à d’autres qui ne communiquent que de la communication. On peut comparer l’efficacité des deux méthodes.
Que ceux qui ne sont pas imposables voient comme une mesure positive la suppression de l’impôt sur le revenu en dit long sur la rationalité de leur vote, qu’on ne leur explique pas que cela les appauvrira automatiquement en dit long sur la confiance que l’on place en leur raison.
Jean Marie Le Pen a fait une très bonne campagne au premier tour.
On peut perdre par KO, aux points, mais aussi par abandon, Jacques Chirac a donc perdu son débat contre Jean Marie Le Pen par abandon.
Les médias font monter la cote de Jean Marie Le Pen à proportion des efforts qu’ils déploient pour la faire baisser.
Les médias font de gros efforts pour faire baisser la côte de Jean Marie Le Pen, jusqu’à diffuser des sondages qu’ils savent faux.
Bien que n’étant pas un candidat de second tour, Jean Marie Le Pen fera un bien meilleur score que ceux dont il est crédité par les sondages. Ça fera une «grosse surprise » pour le soir du second tour, et bicher tous ceux dont le phantasme est qu’il arrive en tête.
Jane Birkin agrippée à une pancarte agace le métallo qui n’arrive pas non plus à croire que Mazarine Pingeot et Pierre Bergé veulent son bien.
Il ne faudrait pas en déduire que le métallo est nécessairement limité intellectuellement.
Le mépris pour ceux qui ne maîtrisent pas la dernière version de Word, qui ne savent pas ce que veut dire « start-up », qui n’ont pas les mêmes goûts littéraires qu’Arnaud Viviant, ne se chaussent pas chez Prada et n’en ont pas l’intention même s’ils gagnent au Loto, dont les enfants ont les dents en mauvais état et de la cellulite à l’intérieur des cuisses, dont la voiture ne démarre pas le matin, qui ne comprennent pas pourquoi Guillaume Dustan porte sa perruque de traviole, qui ne savent pas à quoi ressemble agnès b., c’est la haine de classe.
Les pauvres, on les hait parce qu’ils sont laids.
Les racistes qui ont un Arabe comme voisin de palier sont moins racistes que les anti-racistes.
Le prolétariat, rendu invisible aux pas très bien voyants par ceux qui avaient quelque intérêt à dissimuler sa présence, a refait son apparition… chez les contre-révolutionnaires ! Ça lui est déjà arrivé, et ça ne lui a pas porté bonheur, pas plus d’ailleurs que de pencher de l’autre bord, mais comme le prolétariat est joueur, il veut jouer encore.
Pour tout cela, et parce que placer Chirac, qui n’en a pas l’envergure, en position gaullienne est un problème d’importance, que la classe politique n’a toujours rien compris, contrairement à ce que voudrait faire croire son hypocrite contrition publique, puisque les abonnés de la gamelle, qui préféreront toujours leur intérêt à leur honneur, se frottent déjà les menottes à l’idée des futures triangulaires, après m’être abstenu au premier tour, je voterai Christiane Taubira au second tour.
Tous les citoyens responsables en feront autant.
De façon étonnante, ce texte ne sera publié
ni par Le Monde ni par Le Figaro ni par Libération,
à qui je l’avais adressé.
Dans la veine Judaïca, j’ai publié une nouvelle :
« Change pas de main, lâche pas l’affaire » (cf rubrique Littérature)
« remix » d’une nouvelle (Djezer Zarka) de Michaël Sebban destiné à la revue éponyme (Remix).
Finalement, ce seront Chloë Delaume et Mikaël Agi qui s’en chargeront, dans le même numéro #1 ;
je remixerai, pour ma part, une nouvelle de Philippe Nassif (Je te lâcherai pas, petit 16/9°),
l’autre « remixeur » étant Guillaume Dustan (qui, pour l’occasion, ne s’était pas foulé).

Paris-Hollywood et retour
Por todos los caïdos y las que lleguan
On fumait des Parisiennes… Dix-huit centimes le paquet de quatre clopes.
À l’époque, on disait plutôt cibiches, sèches ou même tiges.
Il y en avait qui racontaient que les P 4 étaient fabriquées avec les mégots ramassés par les clodos. C’était crédible. Pour faire les mariolles, la braise tournée vers la paume, et faire sortir la fumée par le nez, c’était bien suffisant.
Quelquefois, nous achetions des Week-End. Sur la boîte en fer bleu et or, il y avait marqué : Tabac de Virginie. Ça nous faisait voyager plus que n’importe quel afghan ne l’a jamais fait. Les limonades glacées sur le perron, le punch dans les saladiers en cristal, les serviteurs noirs, les panamas, les complets blancs (pastels) et les uniformes des cavaliers confédérés, sans oublier, en arrière-plan, deux ou trois brunettes en mousseline vert amande et rose bonbon… On s’y voyait !
Une civilisation emportée par le vent. Tout comme la nôtre.
Dans les années cinquante, on se contentait de peu, il n’y avait rien de tel que l’ignorance pour faire rêver les morpions.
Avec les P 4, on (stagnait) retombait tout de suite dans le casuel, dans le vulgaire… Pour rêver, on écoutait Guy. Il était plus vieux que nous, il avait déjà redoublé deux fois, en dehors du cul, ce n’était pas une lumière. Un duvet mou lui était poussé sous le nez pendant les (dernières) grandes vacances, il avait des furoncles plein le cou, mais il avait vu tous les films interdits aux moins de 16 ans.
D’après ce qu’il nous en rapportait, fallait de l’estomac. Le genre gynécologique dominait, avec des infirmières mahousses et, plutôt vers la fin, c’était le règlement : un accouchement au ralenti. Pour les forceps, le placenta et le moutard, on lui demandait de mettre la pédale douce, c’était avant que l’on trouvait ça chouette. Et encore, souvent il y avait de quoi couper l’appétit aux plus affamés. Il faut bien le reconnaître, Guy avait une mémoire d’une exactitude Scialytique, en revanche, il manquait un tantinet de poésie.
L’affaire nous semblait, à nous qui n’avions de duvet nulle part, plus compliquée encore que le théorème de Pythagore. Pour que l’on fasse des progrès, Guy nous a ramené le mode d’emploi des tampons périodiques de sa sœur.
Tu parles d’un bordel !
On en a déduit que sa sœur était une contorsionniste d’envergure doublée d’une satanée salope.
On pataugeait.
On croyait tout et n’importe qui. Le bruit a même couru qu’il y avait un bouquin de Jean-Paul Sartre où tout était expliqué noir sur blanc, beaucoup d’entre nous ont essayé sans succès de lire la Nausée bien avant l’âge, le plus crétin s’est farci l’Être et le Néant à 12 ans sans trouver le moindre indice. J’ai fini par l’avouer aux autres, en fac de philo, dix ans plus tard.
Et puis, Guy a commencé à nous les briser avec ses grands airs. On lui refilait du fric sans rechigner pour qu’il améliore ses connaissances dans les salles ad hoc, mais quand il a voulu nous imposer des interrogations écrites, on l’a prié d’aller se faire voir, lui, ses aides-soignantes nazies et leurs ustensiles nickelés. Résultat des courses, on imaginait les femmes comme des chimères gravides dessinées de profil.
De dépit, on s’empiffrait de caramels mous pendant que Jeff Chandler dessoudait une armada de Shoshones avec ses colts inoxydables.
On a écumé tous les cinoches du quartier, une fois, au Rialto, on a failli demander un ticket pour un truc interdit avant de se dégonfler ; une autre fois, au Florida, on a cru entrapercevoir un bout de nichon. On est resté à la seconde séance pour savoir si l’on n’avait pas rêvé, mais quand le sirocco s’est levé et la danse des sept voiles aussi, on a fait un tel barouf que l’ouvreuse, une brune, avec un spencer gris et des moustaches, nous a flanqués à la porte.
Marc nous a sortis du marasme quelque temps. Il avait mis la main sur une pile entière de Paris Hollywood planqués sous le lit dans la chambre de son grand frère.
Il faut le reconnaître, les infirmières à poil pullulaient, la blouse dégrafée, le stéthoscope ballant entre les mamelles idem, mais il y avait aussi des secrétaires, de robustes paysannes, des baigneuses en pagaïe, une palanquée de strip-teaseuses, des chairs mirobolantes, d’affriolantes lingeries, des aisselles comme s’il en pleuvait, des fesses abondantes, des seins en pomme, en poire et en scoubidou-bidou !
Le seul truc qui coinçait ? Là où commençaient les affaires sérieuses… Elles exhibaient toutes le même désespérant aplat à la gouache du nombril jusqu’entre les cuisses, et pas moyen de reconstituer l’affaire, même avec le prospectus des bidules de la sœur de Guy.
On a fini par renoncer.
On s’astiquait comme des malades.
Sur ces entrefaites, Guy a refait surface. Ce con avait toujours deux ans de plus que nous, donc une longueur d’avance.
Ça y était !
Il n’était plus puceau, il s’en était dégotté une. Une vraie de vrai. Au début, on n’y croyait qu’à moitié, on avait du mal à l’admettre, mais quand il nous l’a présentée, il a bien fallu que l’on se rende à l’évidence : ce morveux baisait une fille.
Josy était comack, elle faisait une tête de plus que lui, 24 ans, vendeuse à la Belle Jardinière, rayon chaussettes. Sacrément sexy, avec du rouge à lèvres, le vernis à ongles assorti, des bas à coutures, une jupe en flanelle écarlate au-dessus du genou, des bas résille et un chignon comme de la barbe à papa noire. Assez carrée, pas bésef de nichons mais, pour compenser, pas avare sur les bretelles bleues de son soutien-gorge.
Elle aurait pu poser pour Paris-Hollywood. Sans problème. Sauf qu’à croire Guy elle en avait un : elle voulait bien lui rouler des pelles avec la langue et tout le bastringue (la langue ? le bastringue ?), baiser tous les jours où elle n’avait pas ses ourses (baiser ! ourses !), mais elle ne voulait rien lui montrer de plus que ses bras jusqu’au coude et ses jambes jusqu’à mi-cuisse.
En plus, elle voulait faire l’amour la lumière éteinte, les rideaux tirés, sans qu’il la touche, debout et toujours par derrière. Il fallait aussi qu’il lui promette de garder les yeux fermés, elle l’avait surpris une fois dans le miroir qui essayait de la reluquer en douce, elle avait cassé un mois.
Cette histoire le minait. Nous étions d’accord avec lui, c’était une tordue, mais on aurait signé pour plus tordue si l’occasion s’était présentée (il y en a quelques-uns qui ne se sont pas gênés plus tard et qui s’en mordent encore les doigts).
Sur ces entrefaites, le frangin de Guy qui faisait son service militaire en Algérie a eu sa première perm’. C’était un drôle de margoulin, nos parents nous interdisaient de le fréquenter, nous étions quatre ou cinq perpétuellement suspendus à ses basques. On avait cru comprendre que, s’il était parti en Algérie, c’est qu’il y avait été obligé. En métropole, il trafiquait le pot d’échappement (et la pipe d’admission) des 4 Cv Renault, il avait un Rumi qui faisait un bruit de turbine, il avait été blouson noir, on le soupçonnait d’être maquereau sans savoir au juste en quoi cela consistait, il avait une moustache à la Clark Gable et une dent en or sur le devant.
C’est lui qui nous a fait fumer nos premières Troupes.
Il logeait dans l’hôtel où vivait Josy (mais pourquoi donc vivait-elle à l’hôtel ?). Ils avaient tous les deux à peu près le même âge et, franchement, ils faisaient un plus beau couple que celui qu’elle formait avec Guy. On ne voyait pas ce qu’une vendeuse à la Belle Jardinière pouvait bien trouver à ce morbac avec son duvet qui faisait sale, et que, rapport à son âge, elle était obligé de faire grimper dans sa chambre en cachette de la gérante.
On s’est même demandé si ça n’allait pas faire d’histoires entre eux, mais non, le biffin avait plutôt l’air fier que son frangin se tape une fille plus âgée que lui. Il avait l’air de bien l’aimer. Suffisamment, en tous les cas, pour que l’aîné n’essaye pas de soulever la fille avec laquelle l’autre sortait.
Le gus nous racontait ses aventures en Algérie en buvant des monacos à la terrasse du Mazarin : les mousmés, le djebel, les fellaghas, le bled, la casbah… ça nous changeait les idées, les obsessions, ça va bien un moment. Des fois, il nous payait un baby-foot ; à l’arrière, personne pouvait arrêter ses « enroulées » ; quand il jouait au flipper, il faisait tilt une fois sur deux ; il mettait When des Kalin Twins au juke-box. Nous aurions tous voulu avoir un frère aussi sensass que lui. On conseillait à Guy d’arrêter de lui casser les bonbons avec Josy qui ne voulait toujours rien lui montrer.
— Si ça se trouve, elle a un défaut… pas de nichons ou une infirmité pire encore que les nénettes elles n’aiment pas qu’on se rende compte !
Il geignait.
Pas nous, mais nous, nous n’étions pas ses frères.
Un beau jour que le troufion s’était enfilé trois Pernod en plus de sa dose quotidienne de monacos, il a flanché. Il avait repéré, par hasard, un trou dans la cloison qui séparait sa chambre de celle de Josy. Un trou qui était là depuis longtemps et qui, à son avis, avait dû servir à ce à quoi ce genre de trous servait.
On leur a proposé un tas de brouzouf pour assister à la séance, mais rien n’y a fait, Guy disait qu’il était pudique et son frangin que, s’il nous faisait monter dans sa piaule, la patronne allait croire des trucs à son sujet. Il avait déjà assez mauvaise réputation comme ça…
Nous n’avions qu’à les attendre au bistro, ils nous raconteraient tout.
On s’est imaginé les pires saloperies en sirotant nos diabolos-menthe. On fixait la façade de l’hôtel comme si l’on avait pu voir à travers. La séance nous a semblé interminable. On en pleurait… jusqu’à ce que le frangin de Guy et Josy roulent sur le trottoir, incrustés l’un dans l’autre pire que dans un dessin de Dubout. Ils se flanquaient une peignée terrible, double-nelson, bras roulé, cravate à la toulousaine, ceinture à rebours, tour de tête à la Arpin et tutti-quanti, une sacrée partie de gréco-romaine.
C’est Josy qui est parvenue à se libérer la première de leur étroite étreinte, elle en a même profité pour étendre le frère de Guy d’un uppercut à la pointe du menton. Elle n’a pas demandé son reste, elle s’est cavalée en boitant dans la direction de la Belle Jardinière, le chignon approximatif.
Nous, on s’est approché.
Doucement.
Le bidasse était assis, le cul dans le caniveau. Il avait beau, soi-disant, avoir fait du close-combat pendant ses classes, il s’était pris une bonne toise par une fille, et l’on avait tout vu. Il se frottait la mâchoire. Pensif. Il a vérifié que son incisive en or était toujours en place et il s’est relevé en s’appuyant sur mon épaule.
Sur ces entrefaites, Guy est sorti de l’hôtel.
— Qu’est ce qui s’est passé ? lui a demandé je ne sais plus lequel d’entre nous.
La question a eu l’air de sortir le bidasse du coaltar, il a traité Guy de tapette avant de lui flanquer un coup de pied au cul qui lui a fait traverser la rue en vol plané.
Le fin mot de l’histoire, on l’a reconstitué plus tard.
Par bribes.
Petit à petit.
Comme le reste.
Josy avait tout ce qui va avec une paire de couilles.
À l’époque, on disait plutôt roustons, roupettes ou même roubignolles.
Dix ans plus tard, on baisait toutes les filles que l’on voulait, il suffisait de leur demander poliment.
Il y en a qui m’ont dit : « C’est moi que vous cherchez ? », d’autres « Viens ! » Il y en a qui m’ont écrit qu’elles voulaient soigner ma blessure et d’autres demandé si ce n’était pas trop grave si elles s’attachaient à moi avant de me larguer lorsque je m’étais attaché à elles.
Des fois ça a gazé, d’autre fois pas.
Il faut être juste, je n’en ai pas trop profité, j’ai préféré faire des enfants : quatre garçons, et une fille que j’ai eu en me retirant. C’est dire que, de ce côté-là, je suis plus doué que de l’autre.
Guy travaille à La Réunion, soi-disant comme éducateur. Son frère a été égorgé près de Constantine une semaine avant la signature des accords d’Evian. Marc s’est tué sur la route avec sa fiancée. À Guérinville où l’on vit encore, quand on croise son père, on ne lui dit pas bonjour pour ne pas qu’il pleure en nous parlant de lui.
J’avais écrit, à la demande du Monde 2, cette nouvelle
basée sur le principe de la « métamorphose » déjà utilisé dans
Les dernières cartouches à Sedan in Contes de la littérature ordinaire chez 1001 nuits…
Sans doute un phantasme homosexuel !
Comme à mes interrogations à ce propos, Jacques Buob,
rédacteur en chef, m’avait assuré que je serais payé :
« à la mesure de nos modestes moyens », et comme mes moyens
sont sans commune mesure avec ceux du Monde 2, j’y ai renoncé.
Des écrivains d’un talent bien plus considérable que le mien, non.
Horizon Balard
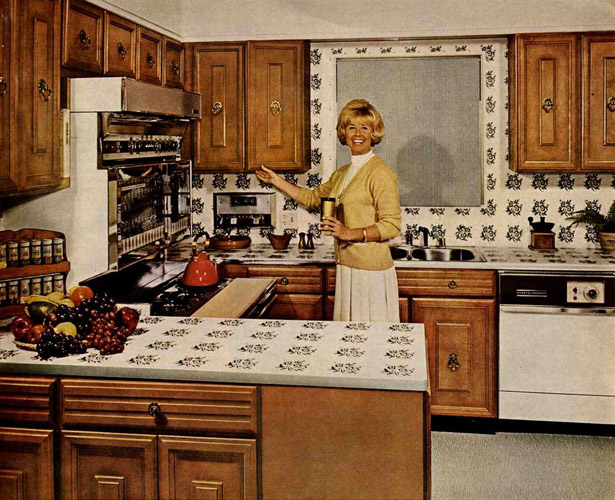
La vie est là simple et tranquille
Le quidam de type ancien, coiffé d’un melon et muni d’un cache-nez tricoté main, attendait le métropolitain, station Glacière, avant de regagner son galetas au troisième sur cour avec WC sur le palier. Aurait-il été un fervent de l’internationalisme, il ne pouvait pas faire autrement que d’être français : merlan, merlu, miroton, Peugeot (ou bien Citroën), les congés payés à faire les foins chez de vagues cousins de la campagne, chat de gouttière, poisson rouge, France Soir, Le Parisien, Jean Tissier ! Raimu ! Carette ! Seul son chien (un Loulou de Poméranie pas très net du pedigree) était exotique. Son équivalent contemporain ne se réclame ni de l’internationalisme ni de son contraire, ce sont des notions qu’il ignore en les dépassant, à moins qu’il ne les dépasse en les ignorant (sa pensée est montée sur roulements à billes). Quoi qu’il en soit, il se régale de sashimi batave arrosé de sangria roumaine, son 4X4 (à deux roues motrices) est japonais, il écoute du rap rwandais à fond la caisse sur son lecteur MP3 coréen en contemplant son vivarium où s’ébat un caméléon de contrebande, pour peu qu’il soit lecteur d’hebdomadaires où un mot sur deux est écrit en anglais, il ne jure que par les blockbusters de Bollywood. Kyoto ! Karlsruhe ! Kigali ! Le quidam post-moderne n’appartient pas à grand-chose et ne s’appartient pas réellement non plus, il est vacant.
De vacant à vacances, la frontière est ténue (les frontières aussi sont floues, rien ne ressemblant davantage à un centre commercial qu’un autre centre commercial, à commencer par les boutiques duty-free des aéroports, les nouvelles frontières sont désormais sans frontières, comme les clowns et les médecins) et que faire en vacances sinon partir. Pour se fuir ? Se retrouver ? Pour se ressourcer ? Se perdre ? Rien de tout cela sans doute puisque l’homme vacant transporte sa vacance partout et sa vacuité avec (elle tient dans l’espace d’une clé USB). Partout où il se transporte, il sème la désolation aérodynamique à la vitesse du son… Boeing ! Kérosène ! Airbus ! Afin de l’encourager, à l’approche de la belle saison, les magazines polychromes sont bourrés jusqu’à la gueule de sites d’assistance au nomadisme immobile et de conseils pour ne pas être dépaysé hors de son accul… le plus sûr moyen d’abolir le paysage étant de le contempler au travers de l’écran de son appareil numérique pour vérifier que ce que l’on voit d’ordinaire à la télévision est la réalité. Fuji ! Panasonic ! Pixels !
Figurant au sein de sa ville natale dont on a changé l’échelle et la possibilité de s’y promener en lui greffant un tramway, équivalent urbain du tapis roulant (puisqu’il n’est de ville digne d’intérêt qui ne se confonde avec un grand magasin ou une galerie marchande), les conditions de représentation étant ce qu’elles sont, le temps qu’il occupe, celui d’un éternel week-end et son espace, celui de la marchandise, il ne peut guère rêver échapper – ailleurs – à son sinistre destin : n’en avoir aucun.
Il y a quelques années, la supposée fin de l’histoire a fait l’objet de débats sans fin (l’auteur, un certain Francis Fukuyama, a depuis reconnu qu’il s’était un peu pris les pieds dans les rallonges de son imprimante), il vaudrait mieux craindre l’abolition de la géographie dont les signes avant-coureurs sont lisibles dans le monde devenu en son ensemble un lieu de villégiature à la libre disposition de chacun (pas de tous, certes, il y aura toujours un tiers-monde pour faire son intéressant, des pauvres pour faire chier et des caissières aux guichets des parcs d’attraction).
Les grandes vacances de mon enfance, j’ai toujours vaguement servi de main-d’œuvre à ceux qui m’accueillaient car ne rien faire en ces temps-là n’était pas concevable, s’emmerder en regardant les vaches brouter, si. S’emmerder, ne pas pouvoir faire autrement que s’emmerder, faisaient partie de la vie et l’enfance ne devait surtout pas en être dispensée alors qu’aujourd’hui elle est perpétuellement sollicitée et priée d’élever une réclamation au moindre temps mort de son emploi du temps, il lui sera bien temps de découvrir la vacuité adulte (Rosé ! Taboulé ! Pennac ! Darrieusecq ! Dubois ! Taboulé ! Rosé !) lorsque ses mérites lui crèveront les yeux juste après s’être lassée de l’accrobranche puis défoncée en rave. Ecstasy ! Ecstasy ! Ecstasy ! C’était – les années 50 – le temps de la préhistoire, du mojito depuis est passé sous le pont des Soupirs et du daïquiri aussi…
Il faut être juste, les choses ne sont pas survenues brutalement, Rome n’a pas été détruite en un jour, il a fallu des étapes pour que le tourisme triomphe, la déterritorialisation ne s’est pas obtenue sans effort, la figure épouvantable du touriste, avant de semer la désolation sur toute l’étendue des territoires où son portable connecte, a revêtu des formes où sa barbarie humaniste était adoucie par l’insuffisance des techniques mises à sa disposition. La villégiature du baby boomer (pionnier en ce domaine comme dans toutes les entreprises de libération) a d’abord revêtu la forme de la « résidence secondaire » avec poutres, piscine, petits carreaux, crépi tyrolien, brou de noix et cheminée qui refoule lorsque les vents sont contraires. Les indigènes se sont longtemps moqués de ces occupants saisonniers avant d’adopter le mode de vie de leurs envahisseurs, de transformer leurs fermes en lofts de plain-pied et d’émailler leur patois de termes à consonances psy… « Quelque part, ma fonction de cantonnier, ça m’interpelle ! »
Le méchoui (talonné par la pizza calzone) devenu le plat national arverne, le touriste a poussé plus loin ses explorations. L’Espagne a très tôt servi de laboratoire à l’héliotropisme septentrional, à tel point que la péninsule ibérique a été saccagée de fond en comble en un demi-siècle à peine (jusqu’à sa langue qui n’est plus pratiquée sur toute l’étendue de son littoral, remplacée par un espéranto anglo-teuton). Le Maroc, chasse gardée jusqu’il y a peu des gays branchés, semble être promis, sous l’assaut des retraités hétérosexuels, à un destin de ce genre, il est déjà difficile d’y trouver un ryad à un prix avantageux. On reconnaît bien là le mouvement ordinaire des avant-gardes ouvrant la piste qu’emprunteront, une fois goudronnée, les hordes de beaufs à venir. La règle du jeu étant de découvrir ce qui ressemble encore à quelque chose et ne ressemblera bientôt plus à rien avec, tapie dans le fond de tout cela, la mauvaise pensée suivante : « Ce serait tout de même pas mal si les autochtones caltaient ! » puisque, c’est vrai, on est tout de même mieux entre soi et soi, serait-on partisan affirmé de la « découverte de l’ailleurs », de la « rencontre de l’autre » et néo lecteur assidu de ce nouveau sous-genre de néo écrivains à l’usage exclusif des éducateurs spécialisés anciennement collectionneurs des aventures du Poulpe : l’écrivain-voyageur. On reconnaît surtout ce qui fait sortir le loup de sa tanière : baiser un max de gonzesses pour pas un rond, s’en foutre plein la lampe, se mettre minable, rétablir des rapports disparus dont l’esclavage est l’horizon indépassable, gagner au change et recouvrir l’Everest d’ordures en prime.
Shameless ! Sin vergüenza (but mit vergüenzas) ! En toute bonne conscience…
Vous comprendrez de ce qui précède que je ne recommanderai aucun lieu de villégiature, parce qu’il n’en est aucun qui soit recommandable à mes yeux et que, si j’en connaissais un seul en dehors du XVe arrondissement (La Motte-Picquet ! Convention ! Balard !), je le tairais soigneusement par crainte de le voir envahi par d’étonnants voyageurs.
Comme je ne suis pas rancunier, à la demande de Christine Rousseau,
j’ai accepté d’écrire un texte pour Le Monde.
Comme je n’ai pas de chance, il y a eu confusion dans la commande
et j’ai été obligé de couper un tiers environ de ce que j’avais écrit tout d’abord.
C’est cette version qui est disponible ci-dessus.
La « short-version » a été publiée dans Le Monde daté du 15 août 2008.
L’Hiver indien
Epilogue*
Hear me, my chiefs ! I am tired. My heart is sick and sad.
From where the sun stands I will fight no more forever.
Chief Joseph
Bury my heart at Neah Bay
Deep in the Sea
Cover me with pretty lies
Bury my heart at Neah Bay
Lloyd « Red Dog » Hefner
Acte 1
L’eau était bleue sous un ciel printanier, et l’on pouvait apercevoir quelques nuages d’altitude filer droit vers l’horizon. Ce jour-là, l’équipage du Colibri a dépassé Shi-Shi et Ozette jusqu’à Wedding Rock où avait été découvert en 1965 le plus important site archéologique des Etats-Unis. Les baleines étaient au rendez-vous, les opposants à la chasse aussi, ils semblaient nerveux comme un chien de berger qui a reniflé le loup. Dans un ballet parfaitement réglé, lorsque le Colibri se rapprochait des baleines, les bateaux des militants se rapprochaient du canoë pour les effrayer. L’équipage makah pagayait, le moteur des Zodiac tournait à plein régime, les opposants hurlaient de toute la force de leurs poumons, les baleines soufflaient avant de replonger pour aspirer sur les fonds les tonnes de boue qu’elles filtrent chaque jour pour se nourrir. Les Makahs ont prévenu par téléphone cellulaire les gardes-côtes afin qu’ils fassent respecter le périmètre de sécurité obligatoire, que les opposants ne cessaient pas de franchir.
La chasse était lancée, tous les fils du drame se nouaient et Wayne n’était pas là. Il était resté à Neah Bay pour régler quelques détails, tout comme Starbuck reste sur le pont du Pequod quand ses chaloupes sont mises à l’eau. Lorsqu’il a entendu que la chasse avait débuté, il a couru jusqu’au débarcadère du port et il est parti en toute hâte pour Wedding Rock à bord du deuxième bateau d’appoint.
Sur le Colibri, Darell pagayait avec vigueur alors que Theron, assis devant lui, à côté du harpon, brandissait la pagaie qu’il avait sculptée et peinte lui-même. Il manquait un rameur, mais le canoë fendait l’eau comme une lame, soulevant un ruban d’écume. Et, aussi étonnant que cela puisse paraître, les Sea Sheperd, les ennemis les plus déterminés de la chasse, n’étaient pas sur le site, aucun de leurs bateaux ne harassait le Colibri, ni le Sirenian du Capitaine Paul Watson qui croisait au large du détroit de San Juan de Fuca, ni le Sea Dog avec Steph Dutton et Heidi Tiura à son bord qui relâchait à Monterey, un peu comme si Achab avait abandonné son équipage et s’était retiré dans sa cabine pour écrire.
Aussitôt qu’une baleine faisait surface, le canoë la poursuivait tandis que les opposants essayaient de la faire fuir, sans cesser d’insulter les membres de l’équipage du Colibri.
— Rentrez chez vous !
— Nous sommes chez nous ! leur a crié Donnie.
Sur le bateau d’appoint piloté par Dan Greene, Arnie Hunter veillait avec Donnie Swan et Keith Johnson sur les harpons, les flotteurs et le fusil.
— Nous aussi, on a un fusil ! a hurlé l’un des marins du Sirenian.
— Le nôtre est plus gros, lui a répliqué Arnie, en souriant.
Après que les Makahs eurent signalé les menaces des opposants aux gardes-côtes, ces derniers n’ont pas manqué de les prendre au sérieux, après tout Paul Watson parlait de lui comme d’un guerrier et de la guerre qu’il faisait aux chasseurs ; à un moment donné, il avait couru un bruit à Neah Bay selon lequel le Sirenian transportait des AK 47 et comme ils considéraient que Paul Watson était assez cinglé pour s’en servir, les garde-côtes ont perquisitionné à bord du Bulletproof, le bateau de la Sea Defense Alliance, mais ils n’y ont trouvé aucune arme.
Il y eut encore des menaces, encore des courses éperdues à la poursuite des baleines qui ne cessaient de faire surface avant de replonger jusqu’à ce que le canoë parvienne enfin à se rapprocher d’une baleine isolée. Alors qu’elle allait plonger, Theron lança le harpon. La lame fendit l’eau, faisant un trait blanc à sa surface, la baleine se retourna.
Raté !
Entretemps, les hydravions, les hélicoptères de la télévision ont fait irruption pour couvrir comme un fait divers ce que les Makahs considéraient comme une cérémonie secrète. Wayne était arrivé lui aussi juste à temps pour voir Theron lancer son harpon de nouveau, et de nouveau manquer sa cible.
Au coucher du soleil, l’équipage aborda sur la plage de Shi-Shi pour y passer la nuit. De retour à Neah Bay, Wayne put constater que la meute des journalistes au complet était de retour. Il répondit distraitement à quelques interviews avant d’aller se coucher. Alors qu’il venait juste de s’endormir, Ralph Marschalleck, le directeur de l’équipe cinématographique allemande, lui téléphona pour lui demander si la chasse ne pouvait pas attendre jusqu’à ce que son équipe revienne de Hambourg pour la filmer.
Acte 2
Le lendemain, au lever du soleil, le ciel était bleu, mais le temps s’est couvert rapidement et le vent s’est levé. Il y avait sur l’océan une houle régulière avec des creux de trois mètres que le canoë pouvait franchir aisément et de courtes vagues désordonnées de moins de un mètre de haut qu’il ne pouvait pas affronter sans risquer de se renverser. Encore une fois, les baleines étaient au rendez-vous, mais le capitaine Paul Watson, revenu du Détroit à bord du Sirenian, également, les Zodiac des membres de Sea Sheperd étaient à l’eau et diffusaient à plein régime le cri des orques pour effrayer les baleines grises dont elles sont les prédateurs naturels. Par un hasard incroyable, un groupe d’orques fit son apparition quand les opposants se retirèrent sous les ordres des gardes-côtes. La chance était avec eux. Les conditions étant trop mauvaises, Wayne donna le signal de la fin de la chasse. De retour à Neah Bay, il avait sa tête des mauvais jours.
— Va y avoir des morts, il a grogné en allumant une cigarette.
— Ouais, l’a approuvé Donnie.
A la frontière de la réserve, les opposants continuaient de brandir sans relâche leurs pancartes où l’on pouvait lire : « Demain l’océan sera un bain de sang » et des slogans hostiles aux Makahs ; le courrier des lecteurs des journaux de Seattle débordait de messages de protestation. D’un autre côté, les canoës des nations amies des Makahs, les Quileutes, les Puyallups, les Tulalips, les Hohs avaient fait leur apparition dans le Détroit malgré les menaces dont ils étaient l’objet : un collège puyallup avait été évacué après une alerte à la bombe.
Le lendemain, je suis passé chez Wayne, le capitaine, en jean et T-shirt, jouait avec son neveu tout en buvant son café (Wayne en buvait des litres) dans un mug décoré d’une baleine stylisée.
— Je pourrai chasser un jour ? lui demandait le petit garçon.
— Un jour, peut-être.
Ralph Marshalleck, le réalisateur allemand, n’arrêtait pas de le harceler au téléphone pour lui demander de les attendre et il avait des tas de papiers à remplir avec George Bowechop. Il détestait la paperasse et, malgré qu’il ait acheté un attaché-case pour ranger ses dossiers, comme chaque fois qu’il devait s’en occuper, il était de mauvaise humeur.
Les jours suivants, le temps s’est mis au beau, mais Wayne a préféré que son équipage se repose tandis que les opposants ne relâchaient pas la pression. Comme ils n’avaient rien d’autre à se mettre sous la dent, les journalistes demandaient aux femmes makahs si, depuis le temps, elles savaient encore cuisiner la baleine. Ils interrogeaient aussi Ben Johnson sur la reprise de la chasse. « Nous sommes d’ici, nous savons ce que nous faisons, on chassera le moment venu », leur répondait-il en haussant les épaules. Un réalisateur de télévision s’est même risqué à lui demander si des cameramen ne pourraient pas embarquer sur le bateau d’appoint pour filmer la chasse de plus près.
— Je crois pas, il leur a répondu.
Malgré le calme apparent qui régnait dans la réserve, les gardes-côtes étaient inquiets.
J’ai passé tous ces jours à relire Moby Dick sous ma tente, derrière le Cape Motel où les autres journalistes faisaient des paris : les Makahs allaient-ils ou non y arriver ? En étaient-ils vraiment capables ? Depuis le début de mon séjour chez les Makahs, j’avais toujours essayé de trouver des correspondances entre ce que je voyais et ce que Melville avait écrit, même si la première chose qui m’avait frappé était une coïncidence ridicule : Starbucks était le nom de la chaîne que l’on connaît, si l’on n’y sert que des espresso, elle a été fondée à Seattle qui n’est pas si éloigné que cela de Neah Bay, le premier slogan qu’elle avait utilisé faisait allusion à Starbuck avant que l’association des Amis d’Herman Melville ne leur fasse remarquer que le marin n’en buvait jamais. Plus sérieusement, il m’avait toujours semblé que les relations qui unissaient Wayne et Arnie avaient quelque chose à voir avec celles d’Ishmaël et de Queegeg, certes, les personnages du roman d’Herman Melville sont si proches qu’ils dorment ensemble (à tel point que beaucoup de lecteurs de cette scène de Moby Dick ont pu nourrir quelques doutes sur les véritables orientations sexuelles de l’auteur), mais, surtout, Queegeg aide davantage Ishmaël que celui-ci ne le croit, de la même manière, inconsciemment, Wayne se reposait sur Arnie plus qu’Arnie ne se reposait sur lui. Donnie était tout le portrait de Stubb tel que le décrit Melville : joyeux, calme, toujours de bonne humeur, indifférent au danger. Quelquefois, l’attitude de Wayne me faisait penser à celle de Starbuck, une phrase précise de Melville m’avait mis la puce à l’oreille : « Je ne veux pas d’homme sur mon bateau qui n’ait pas peur de la baleine » et, plus loin : « Je suis ici pour tuer des baleines et non pas pour être tué par elle à cause d’eux », c’était exactement ce que répétait sans cesse Wayne que n’aurait pas pu dire Theron, le harponneur qui ressemblait tellement à l’image que l’on se fait d’un harponneur. J’ai pris quelques notes sur d’autres correspondances troublantes (que je trouvais troublantes avant de me rendre compte qu’elles étaient seulement tirées par les cheveux) jusqu’à ce que le vendredi soir Wayne me prévienne que samedi serait un jour de chasse.
Le lendemain, le canoë était mis à l’eau, l’équipage était presque au complet, il ne manquait qu’un seul des rameurs qui avait le mal de mer ; Wayne, Donnie et le mystérieux tireur avaient embarqué sur le bateau d’appoint. Une fois informées, les stations de télévision ont arrêté de diffuser les play-offs. Ce jour-là, l’équipage a ramé plus de dix heures et Theron Parker a lancé son harpon une seule fois. Sans succès. Tout ce temps-là, les gardes-côtes se sont appliqués à faire respecter le périmètre de sécurité de quatre cents mètres autour du Colibri et ils ont même intimé aux opposants l’ordre de se retirer sous prétexte que, chasse ou pas, cet endroit était un « sanctuaire » et qu’ils dérangeaient les baleines. Ce qui n’a pas manqué de déclencher la colère de Paul Watson.
— Je ne sais pas dans quel asile de fous j’ai mis les pieds, je suis ici parce qu’ils veulent assassiner un animal intelligent et pacifique avec un fusil anti-tank et l’on vient me dire que les bateaux de Sea Sheperd dérangent les baleines… C’est monstrueux !
A la télévision, la retransmission des play-offs (les Sonics étaient en course) avait repris tandis que Wayne s’engueulait au téléphone avec Ben Johnson qui insistait une fois encore pour que la baleine, comme l’imposaient les réglements internationaux, soit tuée avant d’être harponnée, Wayne n’était plus d’accord.
Le soleil s’est couché, un nuage noir est venu obscurcir le ciel rouge vif, les rameurs ont prié sur la plage, les opposants ont plié bagages pour aller se reposer, les journalistes aussi. Wayne, inquiet pour le confort de son équipage, leur a ramené quelques vivres, ils étaient assis autour d’un feu de camp, ils riaient tous ensemble. A quelques mètres, la carcasse d’un daim avait été jetée sur le sable. Wayne a ri avec eux, il leur a dit que l’un des Indiens Tulalip venu soutenir les Makahs avait rêvé que la baleine serait tuée. C’était le signe qu’ils attendaient.
Acte 3
Le dimanche matin, l’équipage pagayait au large de Cap Alava, le Colibri était entouré par deux bateaux où avaient pris place les journalistes et le Boston Whaler des National Marine Fisheries, chargé de contrôler si les choses se passaient de façon réglementaire, mais bizarrement ni le Sirenian ni le Bulletproof n’étaient présents sur les lieux tandis que les baleines venues du Detroit de Behring et en route pour Baja étaient encore là. Quand le canoë est arrivé sur la zone de chasse, Dan Greene a coupé son moteur, Donnie, Eric Johnson et le tireur n’ont pas quittée des yeux celle qu’ils avaient isolé tandis qu’ils préparaient les derniers détails. Wayne pouvait bien voir que son avance sur le canoë diminuait. Les rameurs, leurs casquettes de base-ball enfoncées jusqu’aux yeux, pagayaient en cadence, sauf Theron qui semblait déchaîné. Vu du ciel, filmé par les hélicoptères, le canoë semblait minuscule à côté de l’ombre de la baleine qui filait à la surface de l’Océan, pour un peu, on aurait pu la confondre avec un morceau de falaise arraché par les éléments à la dérive. Theron a rangé sa pagaie, il a saisi le harpon, maintenant, malgré tous les bateaux et les hélicoptères, malgré tout le vacarme, bien que tout ce qu’ils faisaient soit retransmis en direct sur tous les écrans de l’état de Washington, les Makahs étaient seuls avec la baleine. Tout comme leurs ancêtres l’étaient, bien avant que l’hélicoptère ne soit inventé, et la télévision. Quand le dos de la baleine couvert de bernacles est apparu, le harpon de Theron l’a frappé de plein fouet. Theron a pesé sur le harpon pour le planter plus profond encore, avant de se rasseoir.
La baleine a roulé sur le côté droit avant de se renverser complétement et de montrer son ventre plus clair, un peu comme si elle s’était rendue. Theron a laissé filer la ligne jusqu’à ce que la première bouée passe par-dessus bord, à ce moment-là, les rameurs ont commencé à pagayer en arrière. Avant de disparaître, la baleine a donné un coup de queue si puissant qu’une vague a soulevé le Colibri.
Sur le bateau d’appoint, Wayne a demandé à Donnie de tenir le deuxième harpon prêt tandis que Dan Greene remettait les gaz. Le tireur allait appuyer sur la gâchette lorsqu’un bateau a croisé sa ligne de tir, il a reposé son fusil pendant que la baleine blessée continuait à remorquer le Colibri et que Wayne hurlait en gesticulant pour que le bateau des reporters sorte de la ligne de tir, son barreur a fini par virer de bord et le tireur a pu épauler de nouveau. Il a tiré deux fois. Sans résultat. Donnie a lancé le deuxième harpon, la queue de la baleine a frappé de nouveau la surface de l’océan. La panique régnait à bord du bateau d’appoint où personne n’arrivait à mettre la main sur les balles… jusqu’à ce que le tireur se rende compte que son fusil était chargé. Il a tiré une troisième balle qui a traversé le cerveau de la baleine. L’océan autour est devenu rouge. La baleine était morte. Les rameurs avaient lâché leurs pagaies, ils priaient. Comme s’il s’était agi d’un plan de coupe dans un film hollywoodien, le soleil a disparu à cet instant-là, et le Sirenian a fait irruption toutes sirènes hurlantes. C’est aussi le moment exact qu’une chaîne de télévision, jugeant le spectacle trop violent, a choisi pour arrêter la retransmission. Et la baleine coulait.
Wayne a prévenu Donnie de ce qui était en train de se passer : la baleine coulait, retenue seulement par leurs deux lignes. Donnie s’est déshabillé pour plonger, lorsqu’il a ouvert ses bouteilles, le détendeur a poussé le même soupir qu’un pneu qui se dégonfle : Pssssscht ! Les bouteilles étaient vides. Donnie s’est retourné vers Wayne, la seule solution aurait été que Donnie plonge en apnée, mais Wayne était affolé à l’idée que Donnie se prenne dans les lignes et se noie, il préférait encore perdre la baleine plutôt que de perdre un homme.
— Pas question que tu plonges, tu vas te tuer !
Pendant que les deux hommes se demandaient quoi faire et comment, le Colibri est venu s’amarrer au bateau d’appoint et les rameurs sont montés à son bord, ils sont tombés dans les bras les uns des autres, ils riaient en se donnant de grandes claques dans le dos, ils se frappaient dans leurs mains ouvertes. Indifférent à leur joie, Wayne – seul – se tenait la tête entre les mains. Le vent s’était levé, une pluie glaciale avait commencé de tomber. Une demi-heure est passée et la baleine continuait sa descente inexorable vers les abîmes. Une première ligne a cassé, désormais la baleine n’était plus retenue que par une seule ligne qui pouvait rompre à tout moment. Wayne avait téléphoné à la Marina pour qu’on leur envoie un autre jeu de bouteilles. Pleines cette fois. En attendant, unissant leurs efforts, ils ont essayé, comme on remonte un filet, de remonter la baleine à la main. Sans guère de résultats. Le temps passait, les bouteilles n’arrivaient toujours pas, leurs muscles étaient tétanisés, la paume de leurs mains douloureuses, le bateau dérivait remorqué par la baleine qui dérivait, il courait déjà une rumeur sur la péninsule selon laquelle les Makahs l’avaient perdue et que la chasse s’achevait par un désastre.
Et puis, lentement, doucement, la baleine est remontée comme un noyé finit par remonter à la surface. Lorsqu’ils ont pu l’apercevoir, Donnie a mis son masque, il a plongé et il a attaché un filin à la queue de l’animal.
Sur ces entrefaites, Arnie est arrivé à bord du Heidi, un chalutier de Neah Bay, les marins ont relié le câble au winch hydraulique. Le remorquage de la baleine a duré six heures.
A Neah Bay, un concert d’avertisseurs a salué la nouvelle : la baleine était en route pour Neah Bay. Les gens tombaient dans les bras les uns des autres en riant, les enfants couraient dans tous les sens, les chiens aussi. L’atmosphère était électrique. J’ai marché en direction de la plage, j’ai croisé Hanrriette Cheeka (en plus d’être fille-mère, Hanrriette était, entre autres, conductrice d’ambulance, vétéran de l’armée, membre du club de fléchettes et peintre), accroupie, elle disait à une petite fille : « Aujourd’hui tu vas voir une baleine », et elle riait. Le chef de la Police tribale mâchait son cigare au volant de sa Jeep en regardant les eaux du Détroit.
Arrivés en face de Neah Bay, les marins du Heidi ont détaché la baleine pour que le Colibri ait l’honneur de la remorquer jusqu’à terre. Theron, torse nu, se tenait debout à la proue du canoë en brandissant sa pagaie. Lorsque la baleine s’est échouée sur la plage, elle allait et venait avec la marée comme si elle respirait, comme si elle avait été encore vivante. Theron est grimpé sur son dos le premier, et puis Darrell et puis tous les autres, ce que les opposants à la chasse ont dénoncé comme un « manque de respect ».
Une courte cérémonie a eu lieu, la Police a interdit à la foule des journalistes de déranger les Makahs tant qu’elle n’était pas terminée. Ben Johnson et George Bowechop ont fait un petit discours, Janine Bowechop, la directrice du Musée, filmait la scène avec son Caméscope. Tout le monde voulait approcher Wayne et Donnie, mais c’était Theron, une simple couverture jetée sur les épaules, qui était le plus entouré, c’était à lui que les journalistes voulaient parler. Il leur a déclaré au lieu de ses habituels borborygmes, la visière de son éternelle casquette sur laquelle on pouvait lire « Indigène » rabattue en arrière : « Ça fait un an que nous nous préparons. Ça fait un an que nous prions le Créateur pour ça.» Derrière lui, Andy et Darrell avaient commencé à découper la baleine sous les instructions de Ralph Butterfield, un spécialiste venu d’Alaska pour les aider. Quand les policiers nous ont autorisés à approcher de la baleine, j’ai cherché Darryl et j’ai fini par le trouver, il serrait des mains tout autour de lui, mais il était redevenu sérieux, presque triste. D’énormes morceaux de viande rouge se détachaient de la baleine dont les hommes garnissaient des sacs-poubelle et des glacières venues tout droit du supermarché. La baleine diminuait à vue d’œil comme une dinde à Thanksgiving. Wayne a fini par quitter les lieux, soi-disant pour se doucher. Des projecteurs avaient été allumés pour que l’on puisse continuer à débiter la baleine toute la nuit s’il le fallait. Les hommes pataugeaient dans le sang.
On aurait dit qu’un crime avait été commis sur la plage.
Après que le rideau est tombé
Le lendemain, la baleine était toujours là, même si elle était méconnaissable. Les chiens reniflaient ses restes. Le ciel du matin par-dessus était clair, un officier de police était posté en faction aux côtés de la carcasse. Je suis passé voir Wayne, il avait les yeux bouffis de sommeil.
— Tu vas pouvoir te présenter au Conseil tribal, je lui ai dit pour plaisanter.
Un autre journaliste a frappé à sa porte, Wayne lui a fait dire par sa mère qu’il donnerait une conférence de presse plus tard. Après avoir fini son café, il a ouvert la porte.
— Allons voir ceux qui me haïssent, il a dit.
Les télés passaient en boucle les images de la chasse. Les Makahs faisaient la une du New York Times ; le Seattle Post Intelligence avait reçu plus de quatre cents appels téléphoniques à leur propos, la grande majorité de ceux qui appelaient exprimaient leur opposition à la chasse, l’adjectif qui revenait le plus souvent était : « barbare ». Paul Watson ne cessait de répéter que la chasse était illégale et les USA devenus une nation pirate. « Aujourd’hui, avec des bateaux rapides, des armes de guerre et la complicité du gouvernement, des Américains ont pu assassiner une baleine avec comme alibi un soi-disant privilège culturel ». Sur le site Internet de Sea Sheperd, on pouvait lire : « Que les Makahs soient maudits pour l’éternité » ; la baleine avait été baptisée : Yabis (bien-aimée), les jours suivants, Sea Sheperd mettrait en ligne sur son site où l’on vend des casquettes et des T-shirts, des photographies montrant la baleine en train d’être dépecée et sa carcasse sanguinolente suspendue à un chariot élévateur.
Lors de la conférence de presse, Wayne a insisté sur l’urgence qu’il y avait à chasser une autre baleine, mais Ben Johnson semblait moins enthousiaste que lui à cette idée, il a insisté sur les menaces de mort reçues par la tribu et surtout sur la tenue du potlatch auquel avaient été conviées toutes les tribus du Nord-Ouest.
Quelques jours ont passé, Wayne a préparé un petit discours tard dans la nuit, la veille du jour où le potlatch devait avoir lieu, c’était pour lui l’occasion de remercier tous ceux qui avaient participé à la chasse ou qui l’avaient rendue possible.
Le potlatch eut lieu le premier samedi après la capture de la baleine. Les festivités ont débuté par une parade dans tout Neah Bay avec, à sa tête, l’équipage du canoë remorqué par une voiture. Le potlatch se tenait dans le gymnase du collège, il y a eu des chants, des danses et tout le monde a eu droit à un cadeau, des jouets pour les enfants, pour les adultes, des vases, des couvertures, des torchons, des serviettes, des poêles à frire.
Des plats de graisse et de viande de baleine ont circulé parmi les invités avec du saumon, des pommes de terre et du Jell-O. Et puis vint le moment des discours, Ben Johnson, John McCarthy et Al Zintz, l’avocat de Seattle qui défendait les intérêts des Makahs depuis les années 6O, se félicitèrent tous de ce que le traité ait été respecté, de l’issue heureuse de la chasse et de la fierté retrouvée des Makahs. Theron, rayonnant, était assis entre un chasseur de lion masai et un chef fidjien qui, en tournée à Seattle, avaient décidé de se joindre à eux. Tout ce temps, Wayne a gardé son discours dans sa poche. Il était assis à la même table qu’Arnie, il se sentait bien, il plaisantait avec un reporter : « L’invité du potlatch, c’est moi qui l’ai amené… c’est la baleine ! », il est sorti fumer une cigarette, mais son tour ne vint jamais, les organisateurs ne le laissèrent pas parler et il quitta le gymnase pour rentrer chez lui, il ne put pas s’endormir tellement il était en colère. Il voulait rester seul.
J’ai été l’un des derniers à goûter la baleine, quand je me suis assis à une table, Donnie est venu m’en apporter une assiette. J’ai regardé l’assiette, j’ai regardé Donnie, je me sentais un peu gêné de l’honneur qu’il me faisait. « C’est bon, hein ? », il m’a fait. J’ai hoché la tête, j’ai mastiqué. J’ai mastiqué encore. La viande était un peu dure, ça ressemblait à du bœuf ou à du gibier, je suppose. Je suppose que ça avait surtout goût de baleine. C’était l’une des expériences les plus curieuses que j’avais eu l’occasion de vivre. J’ai continué à mastiquer. J’ai avalé. J’ai repris une bouchée, je l’ai mastiquée et puis j’ai cherché le sel et le poivre, mais il n’y en avait pas. J’ai souri à Donnie et à tous ceux qui étaient assis à ma table et j’ai pensé : « Tu manges une baleine ! ». Cette nuit-là, j’ai dormi dans ma tente, le matin, je l’ai démontée avant de la ranger dans le coffre de ma voiture, j’ai pris mon petit déjeuner. Je rentrais chez moi. Sur le chemin du retour, je ne sais pas si c’était les saucisses ou la baleine, mais je ne me sentais pas très bien.
Avant la fin du potlatch, j’étais passé voir Wayne, j’avais entendu dire qu’il était triste. Ses bottes étaient rangées devant sa porte et la seule lumière que j’ai aperçue par la fenêtre était celle de son poste de télévision. Je n’ai pas osé frapper à sa porte, je suis resté là, debout dans la rue encombrée par les détritus. Lorsque je suis revenu au gymnase, j’ai croisé Ralph Marshalleck, il était en colère après Wayne, il lui en voulait de ne pas les avoir attendus pour qu’ils puissent filmer la chasse.
Sur mon chemin de retour, j’ai pris un auto-stoppeur. Il venait d’un village Nuuchahnulth en Colombie britannique, il était très bavard. Il m’a parlé de sa langue qu’il avait oubliée, il m’a expliqué comment il avait arrêté de boire et le bien que lui avait fait ce qu’il avait vu à Neah Bay, de la fierté que c’était pour tous les Indiens que des Indiens aient réussi à faire quelque chose dont on les croyait incapables. Je l’ai laissé à Forks. Rentré chez moi, je n’ai pas cessé de penser à Neah Bay : c’était donc fini, comme Herman Melville un jour avait mis un point final à Moby Dick (bien que la fin du livre n’ait pas été publiée dans la première édition anglaise), il fallait mettre un point final à ce qui avait été ma vie durant plus d’une année.
La semaine suivante, je suis retourné à Cap Flattery. Sur le parking, les voitures des opposants à la chasse avec leurs autocollants « Ceux qui maltraitent les animaux en restent rarement là », « Sauvez une baleine/Harponnez un Makah » avaient disparu, le soleil brillait, j’ai regardé Sooes Beach en contrebas, la plage à marée basse ressemblait à n’importe quelle autre plage un week-end ensoleillé : le ciel était dégagé, seuls quelques nuages d’altitude couraient dans le ciel, l’air chargé de sel sentait bon les roses Nootka dont les pétales volaient dans le vent, les enfants jouaient sur le sable. Je suis descendu marcher sur la plage au milieu des étoiles de mer, des moules et des bernacles dont une baleine grise peut porter plus d’une tonne incrustée sur la peau.
Plus tard, je suis passé voir Wayne, il était étendu sur son lit, il avait gardé ses bottes. Il m’a dit qu’il avait pris un jour de vacances à Victoria, mais qu’il n’avait même pas pu aller déjeuner au restaurant, tout le monde le reconnaissait, personne n’avait voulu le servir et maintenant, le docteur refusait de soigner sa mère, la haine qu’on leur portait continuait d’infester le cœur de leurs ennemis. Il avait eu une conversation avec son fils à Seattle, il espérait que, maintenant, tout irait mieux entre eux. Nous avons parlé de Donnie qui avait trouvé un boulot et puis Wayne m’a montré une cassette vidéo que lui avait donnée un reporter. Pendant qu’on la regardait, il m’a confié : « Arnie et Donnie sont les deux types qui ont été les plus importants. Plus importants que moi, j’aurais rien pu faire sans eux. » Sa voix était triste, quand la bande a été finie, je me suis rendu compte qu’il pleurait. Je lui ai demandé s’il allait bien. Il m’a répondu : « Ça va, mais je sais pas ce qui va arriver maintenant. » Sa voiture était réparée, nous sommes passés voir Arnie après avoir été prendre les nouveaux gilets de sauvetage qui avaient été livrés. Ils étaient trop grands. « Va falloir que tu grossisses », il a dit au jeune homme lorsque Arnie a essayé le sien. En riant, sa femme lui a dit : « Ça te va bien ». Nous avons parlé tous les quatre de ses ennuis : Ralph Marshalleck avait écrit une lettre au Conseil tribal pour protester contre l’attitude de Wayne, plus sérieusement, on lui reprochait d’avoir autorisé Eric Johnson, qui n’avait pas l’agrément des autorités, de participer à la chasse. Il était question de lui infliger une amende. Qu’il ait réussi avec tous les autres n’était pas suffisant pour tout régler dans sa vie. Wayne ne se laissait pas abattre pour autant, il espérait pouvoir de nouveau chasser cet automne, il essayait de recruter un équipage alors que de leur côté, Theron et John McCarthy faisaient la même chose. On a quitté Arnie, sur le pas de sa porte.

Ocean Drive, Neah Bay
(Washington)
Wayne a allumé une cigarette et j’ai regardé Neah Bay, je lui ai dit combien je trouvais tout ça beau, je me suis retourné vers lui pour lui demander ce qu’il en pensait.
— Moi ? J’ai envie de me casser de là, il m’a répondu.
J’ai cru qu’il plaisantait, mais il ne plaisantait pas. Il s’est tu un moment avant de rajouter : « C’est pas vrai, c’est beau, c’est vrai… La vérité c’est que c’est le seul endroit pour lequel je suis fait ».
Jusqu’à l’automne, je suis resté en contact régulier avec lui. J’avais commencé mon livre, un autre journaliste qui avait le même projet que moi m’avait téléphoné pour me dire qu’il y avait renoncé, d’après lui, seul un Makah pouvait le faire, seul un Makah pouvait savoir ce qui s’était vraiment passé ; peu de temps auparavant, Wayne m’avait confié qu’il avait commencé à écrire et je l’avais encouragé à le faire en pensant que ce serait une bonne chose pour lui. Il allait bien, il pêchait le saumon avec Donnie, des tas de saumons, ils les vendaient 50 cents le kilo. A Seattle, au marché aux poissons de Pike Place, ils étaient revendus vingt fois plus cher.
A Neah Bay, il était de plus en plus question de reprendre la chasse, dans un premier temps, Wayne a annoncé qu’il ne chasserait plus qu’avec les membres de sa famille et puis il a changé d’avis, si l’occasion se présentait, il chasserait… même avec Theron. Durant l’été, Wayne a laissé plusieurs messages sur mon répondeur. Il semblait complètement déprimé. Je l’avais rappelé à chaque fois, à chaque fois, il était sorti, mais j’avais pu parler avec sa mère. Elle se faisait du souci pour son fils, il n’allait pas bien, il avait des ennuis avec sa copine, la banque ne voulait pas lui accorder un crédit pour qu’il s’achète un nouveau pick-up. « C’est beaucoup de choses pour un seul homme. » D’après ce qu’elle me disait, j’avais l’impression que Wayne était en train de réaliser que la chasse n’était pas une fin en soi, qu’aussi importante qu’elle ait été pour lui sur le plan culturel, politique et même spirituel (lorsqu’on l’interrogeait à ce propos, il répondait invariablement : « C’est pas trop mon truc ! »), c’était juste une chasse et qu’elle était terminée.
Et moi, je me demandais : « Quand tout cela va-t-il réellement finir ? » C’est pour répondre à cette question qu’en plein mois de décembre j’ai décidé de retourner une dernière fois à Neah Bay.
J’ai retrouvé tout le monde ou presque : George Bowechop était content que les jeunes Makahs se soient rendu compte que les Makahs n’existaient pas seulement au Musée, mais qu’ils pouvaient aussi faire la une des journaux ; Gary Ray se préparait pour sa troisième campagne électorale. « Cette fois, c’est la bonne ! », il avait choisi une phrase de Theodore Roosevelt comme slogan : « Ce que nous faisons pour nous-mêmes nous suit dans la tombe, ce que nous faisons pour les autres dure éternellement ». Lorsque les Makahs se préparaient pour la chasse, il m’avait dit un jour : « Ces types sont sur les montagnes russes… des fois en haut, des fois en bas. » Je le lui ai rappelé et je lui ai demandé où ils en étaient maintenant à son avis. « En haut », il m’a répondu avant d’ajouter : « Une fois pour toutes. » Arnie m’a montré les feuilles de canneberge qu’il faisait sécher, « ça donne un thé du tonnerre », il m’a dit en froissant les feuilles entre ses doigts, je lui ai demandé si c’était meilleur pour la santé que le ginseng dont il était un grand consommateur. « C’est mieux, c’est moins cher et puis ça vient de chez nous », il m’a répondu en souriant. J’ai pris un Pepsi avec Donnie au Makah Maiden. Sa petite amie était enceinte, il était content d’avoir un enfant, mais à vingt-trois ans, il se trouvait trop jeune pour se marier. Theron voulait le prendre dans son équipe, mais il avait refusé, il ne croyait pas que Theron ferait un bon capitaine, à son avis, il n’était même pas un si bon harponneur que ça : « A la façon dont il s’y est pris, on aurait pu y passer ». Je me suis rappelé que la seule fois que j’avais entendu Arnie dire du mal de quelqu’un cela avait été lorsqu’il avait traité Théron de « trou du cul » au plus fort de la crise opposant Wayne et Theron pour le leadership du Colibri.
Celui qui avait harponné la baleine continuait à susciter la polémique, mais peut-être qu’il en est toujours ainsi des héros. La seule fois qu’il m’avait adressé la parole, il m’avait demandé si j’avais lu Never Trust a White Man d’Arlyn Conly, je lui avais répondu que, non, je ne l’avais pas lu. J’avais cru qu’il me disait à sa manière brutale qu’il n’avait pas confiance en moi, alors que Never Trust a White Man était un livre de souvenirs d’une institutrice à Neah Bay dans les années 50. Le temps que je m’en rende compte après l’avoir acheté à la librairie du Musée, nos relations étaient devenues si mauvaises que nous ne nous sommes plus jamais reparlé.
Donnie a changé de sujet, d’après lui, de toutes les manières, tout ça c’était parler pour ne rien dire, aucun d’entre eux, ni Wayne ni Theron ni John McCarthy ne pourrait chasser tant que la question du stockage n’aurait pas été résolue, elle était loin de l’être, et le nouveau canoë prenait l’eau. Bien qu’il ait été le seul d’entre tous à ne pas avoir de problèmes d’argent, il pensait déménager bientôt à Port Angeles pour travailler sur le chantier d’aménagement de la Elwah River sur laquelle l’ancien barrage empêchait les saumons de remonter. Les saumons mythiques de la Elwah River qui pesaient facilement cinquante kilos ! Il reviendrait à Neah Bay le week-end.
Et puis, je suis passé voir Wayne. Il allait mieux, il continuait à ne pas boire, il avait acheté un ordinateur, il travaillait à mi-temps pour la commission baleinière contre un salaire de misère et, pour améliorer ses finances, il projetait de se faire embaucher sur le même chantier que Donnie. Je lui ai dit combien je trouvais important que le saumon revienne dans leurs rivières.
— Et puis, ça paie bien, il a fait en me clignant de l’œil.
S’il n’était pas embauché, il pourrait toujours devenir routier, il avait passé le permis avant que la chasse ne commence.
Je lui ai proposé que l’on prenne le petit déjeuner ensemble le lendemain matin et je suis parti dîner au Makah Maiden.
Le lendemain, quand je me suis réveillé, il pleuvait, les vagues écumaient, des nuages noirs filaient dans le ciel comme la fumée d’un incendie. Wayne et Arnie étaient assis au restaurant en face l’un de l’autre, Wayne devant son éternel café, Arnie devant son thé, je les ai regardés derrière la vitre rire ensemble, éclairés par le néon du restaurant qui disait : OUVERT. Je me suis assis avec eux et nous avons déjeuné tous les trois en parlant de tout et de rien. Quand je me suis levé pour partir, Wayne m’a accompagné jusqu’à ma voiture, il m’a serré la main et m’a souri, la pluie dégoulinait sur son visage, son sweat-shirt était trempé, mais il semblait ne pas s’en rendre compte, à moins que ça ne lui ait été égal. Je lui ai souhaité bonne chance.
— Tu sais, il m’a dit en secouant la tête, ça fait pas très longtemps que je suis vivant.
Thomas Donovan
(Dépêche d’agence)
Les autorités internationales réglementant la chasse à la baleine ont décidé d’interdire « sine die » la chasse à la baleine grise dans le Pacifique Nord. Aucune dérogation ne sera accordée au titre des chasses « aborigènes », dans ces conditions, les Indiens makahs qui bénéficiaient d’un quota de cinq baleines devront définitivement y renoncer.
J’avais initialement prévu de publier ce texte à la suite de L’Hiver indien.
C’était, pour moi, le moyen de passer de la fiction au reportage,
de « montrer » les deux registres et leurs différents effets,
et, aussi, de rendre à César ce qui est à César, à savoir à Robert Sullivan
(auteur de « A Whale Hunt« , Simon & Schuster)
dont le livre m’a été plus qu’utile pour écrire L’Hiver indien, ce qui lui appartient :
la relation exacte des faits.
Mes éditeurs n’étaient pas tout à fait d’accord, plus proche de la « traduction » que de l’adaptation,
ce texte posait des problèmes de « droit », sans compter que la moindre singularité
leur semble pouvoir nuire à un possible succès commercial ;
je n’étais pas persuadé de la pertinence de l’affaire
(je rêvais aussi, sans doute, à mon premier best-seller).
Dans l’affolement, j’ai même oublié de remercier Robert Sullivan.
C’est dire la courtoisie qui, parfois, m’anime.
Langue de boîte
Limoges, je n’avais rien contre. J’avais rien pour non plus, mais quand j’ai reçu ma convocation pour les trois jours, j’avoue avoir eu comme une idée préconçue, l’impression que, finalement, ce n’était pas une ville pour moi. Les autorités militaires n’en avaient rien à secouer de mes préventions ; un centre de recrutement, ce n’est pas une station balnéaire, faut pas rêver ! Ce n’est pas non plus le genre d’institution qui prend en considération les désiderata d’un tel ou d’un quel, serait-il intellectuel. C’est donc dans l’état pitoyable que l’on imagine, mais muni cependant de toute la paperasse idoine, d’une liasse de certificats médicaux et d’un pyjama miraculeusement retrouvé que j’ai pris le train pour la Haute-Vienne.
Dans la famille, on avait déjà eu, en d’autres temps, notre compte de héros, d’amputatioons et de médailles et, personnellement, je n’avais pas très envie de perpétuer la tradition. Je me suis tassé dans un coin du compartiment de 2° classe décoré de vues d’Azay-le-Rideau, Verdelais et autres merveilles hexagonales en essayant d’imaginer tout ce qui, hormis un anti-militarisme de principe, pouvait persuader les autorités de mon incapacité à assumer ce qu’elles présentaient comme une « obligation républicaine ». La santé ? Pas de problème : un peu maigre à la rigueur, et encore, le rata y pourvoirait. Le pied pas plat, l’acuité visuelle du faucon, l’oreille fine, la rate impeccable, pas une hémorroïde, le disque élastique, la gencive fraîche, l’artériole souple. Pas dépressif non plus, juste paranoïaque à bon escient, ni homosexuel ; des tendances bien sûr durant ma petite enfance, mais rien que la première salope n’ait pu faire s’évanouir à la première occasion. J’en étais d’ailleurs là de mon check-up désastreux quand la créature de rêve s’est installée en face de moi. Elle devait faire pas loin de deux mètres avec des jambes interminables et la jupe au ras du bonbon. Ça m’a distrait du coup de la morosité dans laquelle j’étais plongé à l’idée de perdre un an de ma vie habillé par kaki et coiffé par calot. J’ai essayé de voir sa culotte. J’étais bien prêt de réussir quand le contrôleur m’a dérangé dans le lent affaissement que j’effectuais sur la banquette pour obtenir l’angle adéquat.
— Sursitaire, il m’a fait ?
— Plus pour très longtemps, je lui ai répondu.
Il s’est tourné vers la géante qui, à notre grande surprise, lui a tendu le même laisser-passer que moi.
— Vous aussi, a bégayé le contrôleur ?
— Et alors, lui a rétorqué la créature avec une voix de rogomme ?
Et elle a remis le laisser-passer dans son coquet réticule en haussant les épaules dont j’ai remarqué soudainement qu’elles étaient de la largeur réglementaire en usage chez les brasseuses est-allemandes. Quand le contrôleur eut refermé, rêveur, la porte du couloir, je lui ai demandé : « Vous êtes… »
— Rien du tout ! J’ai pas envie de sauter en parachute, c’est tout. J’ai le vertige.
— Alors, t’es pas…
— Travesti ? Que nenni !
Il s’appelait Vincent, il était dans la même situation que moi et dans les mêmes dispositions d’esprit, seulement lui, il avait préparé son sujet. Il m’a expliqué son plan pour se faire réformer, en long, en large et en travers. Il n’y avait rien à redire, il avait tout prévu, de longue date. C’était un as. Un Sioux. Quand l’on est monté dans le bus, via la caserne, il a eu beaucoup de succès et à la caserne itou. Après qu’on se fut alignés en rangs d’oignon dans la cour, qu’on nous eut montré où on allait dormir, les bidasses nous ont expliqué le programme des réjouissances. Pour commencer, on avait droit à une séance de cinéma. Le film était à chier. De la propagande pur jus : des pseudo-cover-boys s’ébattaient joyeusement dans la neige, dans l’azur ou sous les cocotiers, mais toujours en uniforme. Sans être un fameux cinéphile, je croyais savoir reconnaître un bon film d’un mauvais. Là, j’étais affligé pour le réalisateur, mais quand les lumières se sont rallumées, Vincent avait le rimmel qui avait coulé tout le long de ses joues et les faux-cils décollés.
— Ça va pas, je lui ai demandé ?
— Très bien. T’as pas un Kleenex ?
Quand je lui ai refilé mon mouchoir, il s’est essuyé les lèvres avec jusqu’à ce qu’il n’ait plus une seule trace de rouge à lèvres.
— On se fait quelquefois de ces idées, il m’a glissé en reniflant.
Le film l’avait littéralement retourné, converti absolument. Il hésitait seulement sur sa future affectation, il m’a demandé si, à mon avis, il serait plus utile dans l’infanterie de marine ou dans les chasseurs alpins ? J’ai bien vu qu’il était inutile d’insister, il n’y a pas plus intégriste que les convertis de fraîche date. Pour les tests, il s’est fait prêter un pantalon et pour la visite médicale, il a fait honte à tout le monde avec ses deltoïdes. Le soir au foyer, il a vidé un pack de Kro, tordu les barres du baby-foot et acheté un briquet grenade. J’ai fait comme si je ne le connaissais pas.
Comme j’avais, à tout hasard, fait état de tendances suicidaires, je suis passé devant le médecin-major qui n’a pas mis plus de trente secondes à s’apercevoir que j’étais un simulateur dénué du moindre talent. Encore heureux, un mois plus tard, ma femme, au péril de sa vie, a accouché de jumeaux et j’ai été dispensé du service militaire actif en tant que soutien de famille.
Un an plus tard, j’ai reçu une carte postale de Vincent représentant un char AMX, il s’était pété les deux malléoles lors de son premier saut en parachute. Alors que, juché sur douze centimètres de talon, il n’avait pas réussi, en trois jours, à se tordre les chevilles.
J’avais écrit ce texte pour Télé-Obs à propos d’une émission sur les films publicitaires,
histoire de pousser le bouchon un peu plus loin que d’ordinaire.
Les secrétaires de rédaction s’étaient bien marré ;
Richard Cannavo,le rédacteur en chef, me l’avait fait refaire.
J’aurais bien dû me douter, à ce moment-là, que ce type
ne s’opposerait pas à mon licenciement ultérieur.
Ce qui a été le cas.
M.M,
Les cyber-beaufs diplômés semblant pulluler dans l’espace qui leur est réservé, il ne me reste (hélas !) pas grand-chose à rajouter au « Grand détournement » ni à l’article extasié de Jacky Goldberg à son propos dans le dernier numéro de votre magazine, juste (pour information) ce que ce que j’en écrivais dans Télé-Obs du 15 janvier 1994.
Rions, c’est un ordre !
George Abitbol, l’homme « le plus classe » du monde (interprété par John Wayne), meurt en murmurant « Monde de merde ! » Pourquoi ? Peut-être qu’il a, tout simplement, eu connaissance de la suite. La suite c’est « Le grand détournement », « l’histoire la plus folle et l’interprétation la plus prestigieuse de l’histoire du cinéma ».
Si vous voulez y assister dans les meilleures conditions possibles, il faut que vous couchiez les enfants, il n’est jamais très bon qu’ils soient témoins de vos épisodes régressifs, que vous invitiez vos anciens copains du 3° RPIMA et prévoyiez trop de Kro. James Stewart est pédé (rires !), Dustin Hoffman fait de l’entérocolite (rires !), les ravioles c’est des bouts de nichon (rires !), les gonzesses… « salope ! » On est une bande de jeunes déguisés en gros cons, tellement bien que l’on ne voit pas la différence.
Le procédé du détournement a été théorisé pour la première fois par Guy Debord et Gil Wolman* en 1956 ; il découle d’ailleurs en droite ligne de la métaphore forcée, du romantisme noir, de Lautréamont, du surréalisme et du lettrisme, mais c’est évidemment dans le cadre cinématographique que le détournement peut atteindre sa plus grande efficacité. Lorsque les « situs » détournaient les films karaté, c’était à une époque où la dialectique pouvait casser des briques, lorsque Debord faisait charger les tuniques bleues de John Ford, c’était aux accents de sa prose pour une fois lyrique et qui n’en était que plus belle.
Mais les choses ultra-modernes sont singulièrement portées à s’user plus rapidement que les autres. En dehors du fait que l’irrévérence leur permet de gagner leur vie et qu’ils y sont un peu lourds, Michel Hazanavicius et Dominique Mézerette, en faisant du détournement un divertissement pour aliénés qui se croient critiques, démontrent bien mieux que leurs aînés que les vérités qui n’amusent plus deviennent des mensonges et que tout ceci appartient à une époque finie. On comprend mieux la mélancolie de John Wayne, après être mort en héros, il lui faut encore revenir en pétomane. C’est vrai qu’il y a de quoi se la bordre, Monsieur Abitmol.
Triste ? Non. C’est tellement ordinaire : beaucoup trop ordinaire pour en faire grand bruit.
Ce silence hilare jeté sur le fracas de l’Utopie, c’est l’ordre détestable des choses et du monde comme il va… lu, vu et approuvé par ceux qui ne le devraient pas.
* qui me confiait à propos des réalisations de ce genre : « Ils ont détourné le détournement ».
Ce texte a été envoyé au courrier des Inrockuptibles,
à ma connaissance, il n’a pas été publié.
Pages Roses
Qui dort pine
Qui ne dit trop consent
Qui sème la tante récolte la tapette
Qui viole un œuf viole un bœuf
Horreur n’est pas compte
Des mous et des douleurs il ne faut pas discuter
Il n’est pire eau que l’eau qui mord
Mains roides, cœur faux
Le mieux est l’ennemi du rien
Le milieu est l’ennemi du chien
Les durs ont de l’oseille
N’éveillez pas le fat qui a tort
Le macaque sent toujours le varan
Noël au plafond, Pâques au typhon
La nuit donne sommeil
Ail pour ail, cent pour cent
Pauvres, mais hier
Plus on a de sous, plus on a de riz
L’anus porte conseil
A chaque cour suffit sa reine
A l’impossible nul n’est venu
L’argent n’a pas d’honneur
A tout vainqueur tout bonheur
Autant en emporte le temps
Comme on fait son lit on se touche
L’occasion fait le marron
Pauvreté n’est pas vide
Qui a bu aboiera
Qui va à la plage perd sa glace
Le soleil nuit à tout le monde
Toute pine s’irrite à faire
Un de foutu, dix de réparés
Il faut que vieillesse trépasse
Il faut tourner sa langue sept fois dans sa bouche avant d’empaler
Il vaut mieux aller au bout d’Angers qu’à la baie de Sein
Il y a loin de la croupe aux lèvres
Les loups ne se mangent que lorsqu’ils sont moelleux
Malesherbes court toujours
Tout vient à temps à qui sait se pendre
Un homme averti n’est plus curieux
Après Yamaha, Bontempi
A bien sentir qui vient du coin
A bon sein point l’empeigne
A bon ça, bon drap
Un de connu, dix de recherchés
De deux mains, il faut choisir la sienne
Pierre qui roule se masse en douce
La claque sent toujours le parent
Il faut que jeunesse se lasse
Les fous ne se rangent pas entre eux
Bien faire et tirer la chasse
C’est le con qui fait la mimique
Les chiens y voient, le char à voile passe
Les cors aux pieds sont les plus mal soignés
Dans le doute, retiens toi
Comme on caresse ses seins, on les honore
L’agilité est mère de tous les cirques
Plus on est de fous, moins il y a de riz
Qui se sent morveux se douche
Tout à l’égoût sont dans la nature
Vivra bien qui vivra le dernier
Si jeunesse salait, si vieillesse poivrait
Tel a pris qui croyait suspendre
Un trou chasse l’autre
Un homme inverti en vaut deux
Le vin est tiré, il faut le croire
Abondance de rien ne nuit pas
La phtisie vient en mangeant
Qui saigne le faon récolte la sanquette
Qui saigne tout le temps révolte la moquette
Qui baigne le temps révolte la raquette
Beaucoup de fruits pourrit
Touche moi, mets ta robe
Si jeunesse bavait, si vieillesse sapait
Qui veut aller loin ménage sa voiture
Une fois n’est pas beaucoup
L’argent a des voleurs
Qui trop se rase a mal à la fin
Vieux motard que j’aimais
A l’impassible nul n’est tenu
Peureux au jeu, absent en amour
Le meuh est l’ennemi du foin
La nuit, tous les gars sont gris
Abondance de seins ne nuit pas
Aux grands mots les grands intermèdes
Le mien est l’ennemi du tien
Mieux vaut tard que très tôt
Les mules ont des oreilles
Fais à autrui tout ce que tu veux lui faire
L’argent ne fait pas le bonheur des pauvres
Pas de nouvelles de Jean Nouvel
Qui ne risque rien a la trouille
Qui paye ses dettes réfléchit
Plus du râble de lapin
Divise pour moins payer
Quand le vin est piqué, il est trop tard
Un bain vaut mieux que du Tulle gras
Qui a bu est bourré
La nuit, tous les chas sont pris
Rien ne sert de courir, il faut couper les foins
Ventre vide n’a pas mangé
A quelque chose malheur est con
Tel est épris qui croyait s’éprendre
Les doux ne se langent pas entre eux
Un soir, presqu’une nuit, un Petit Larousse, mon fils Donatien,
quelques bouteilles, et voilà le résultat
(inégal, mais qu’est-ce qu’on a ri) !
De Dieu

Si ce n’est un étant c’est donc un néant.
Heidegger
Personne ne saurait soutenir très longtemps la validité d’un idéalisme sans Dieu. L’existence de Dieu est, sinon la condition sine qua non de la crédibilité de l’idéalisme, au moins l’une des conditions les plus opérantes d’une position philosophique de ce genre.
Certains types d’idéalismes particulièrement dégénérés peuvent toujours, dans leurs super-productions, refuser à Dieu le rôle du jeune premier, ne lui attribuer qu’un second-rôle, mais, serait-il figurant, Dieu ne peut être absent du casting sans que la pellicule ne se voile… un peu à la manière dont Alfred Hitchcock se doit d’apparaître, ne serait-ce que furtivement, à l’intérieur d’un film d’Alfred Hitchcock pour qu’il s’agisse réellement d’un film d’Alfred Hitchcock.
Je dois tout de suite préciser que, bien qu’ayant été dans ma jeunesse victime, pour cause de résultats scolaires insuffisants, de l’enseignement confessionnel, je ne suis pas systématiquement opposé à l’idée de Dieu – devrais-je dire à son hypothèse ? – pas même à son existence, pas plus qu’à celle des pauvres ou des sauvages. Peut-être, dans le fond, parce que je suis, plus que tout, attaché à la notion de jugement et qu’un Dieu, catholique de surcroît, me semble particulièrement bien armé en ce domaine, tout au moins au niveau des intentions déclarées. Je suis en revanche assez opposé à l’idée du Dieu que promotionnent ceux qui en possèdent le contrat d’exclusivité ou peu s’en faut. Pour tout dire, il me semble que le Dieu qu’ils proposent ne présente pas toutes les qualités d’un vrai Dieu.
Sans aller jusqu’à analyser, ce que d’autres se proposent de faire ailleurs, en quoi certaines interdictions qu’ils s’imposent rendent la conception du Dieu des idéalistes contemporains peu crédible, je regretterai ici qu’ils suppriment un à un à Dieu les attributs de la divinité jusqu’à ne plus faire de lui qu’une entité un peu plus parfaite, mais guère plus, que celle de nos misérables personnes. Or, il faut bien se l’avouer, Dieu n’est pas démocrate. Il n’a pas ce genre de préoccupations ; d’ailleurs il n’a pas, à proprement parler, de préoccupations humaines. Même si c’est “humainement” difficile à avaler, il faut bien admettre que Dieu – c’est un mystère le connaissant – n’est pas humaniste.
Le manque de considération porté à Dieu, par ceux-là mêmes qui ne sont pas opposés à son existence, mais seulement à son look, peut être mis à jour de façon amusante en examinant les réactions effarouchées et les objections fallacieuses apportées à la nouvelle version du catéchisme éditée par l’église catholique, apostolique et romaine. Jusqu’à preuve du contraire le catéchisme se doit d’édicter un code de conduite qui, bien que de seconde main (le mode de transmission en est douteux), est soi-disant conforme aux desiderata divins. On ne voit donc pas en quoi le fait que la parole divine ne soit pas soumise à évolution sur les questions que l’opinion publique considère comme sensibles peut susciter l’étonnement ou l’indignation ?
Pour être vulgaire, si Dieu pense que l’avortement est un crime et la femme un être inférieur, je ne vois pas quels sondages pourraient le faire changer d’avis et quelle opinion extérieure à la sienne il prendrait en considération pour ce faire ? Dieu n’est pas partisan de la branlette, depuis Onan il n’a pas bougé sa position d’un pouce. Peut-on lui reprocher ? Ce n’est pas la question ! Ce dont on ne peut discuter, il faut le taire.
Si cette attitude peut encore être comprise de la part des commentateurs, elle est inadmissible de la part de ceux qui doivent en être l’écho. Ceux-là sont susceptibles de ne pouvoir faire subir aucune variation à la parole de Dieu ni aucune mise à jour dues à des conditions climatiques, sociologiques ou politiques particulières. Dieu est aussi invariable que le mètre étalon conservé au pavillon des poids et mesures de Sèvres. Les jugements de la Cour ici-bas peuvent vous rendre blanc ou noir, selon que vous êtes puissant ou misérable (bien que la Loi soit théoriquement la même pour tous, son application est toutefois susceptible d’aménagements), la Loi divine, elle, n’a que faire de nos terrestres atermoiements. Pour Dieu, plus encore que pour la gendarmerie, la Loi c’est la Loi. Les imperfections d’ici-bas n’ont pas cours dans la sphère du divin. Dieu est immobile et sa parole aussi. On ne peut en aucun cas lui opposer une quelconque objection (“Je ne l’ai pas fait exprès…”) ou pire, un quelconque jugement de goût, du genre : “La luxure, cette saison se porte au dessus du genou”, “La gourmandise démarre à 7.000 calories/jour”. Il ne faut jamais confondre Dieu avec Azzedine Alaïa ou le bon docteur Montaignac si l’on veut lui garder une parcelle de divin. Dieu est au-delà de la morale mondaine.
Le premier outrage fait à Dieu a d’ailleurs été de cet ordre, il repose tout entier dans cette déclaration apocryphe : “Dieu est bon”. Or Dieu n’est pas bon. Ni mauvais. Dieu est, cela suffit ! Un jugement moral ou de goût ne peut en aucun cas lui être appliqué sans qu’il s’agisse d’un blasphème. Dieu est au-delà du bien et du mal, de la mode, de la morale et de la passion.
L’une des atteintes les plus impardonnables qu’a fait subir le christianisme – qui est sous nos latitudes la forme la plus courante que revêt l’idée de Dieu – à l’idée de Dieu étant, bien entendu, de lui avoir prêté une descendance. Même en prenant toutes les précautions utiles en de tels cas la majesté divine s’est ainsi vue ravalée au niveau domestique. A partir de cette bourde initiale, Dieu s’est identifié dans l’inconscient populaire à n’importe quel chef de famille bourru dont le rejeton caractériel fait un peu n’importe quoi. Je n’en voudrai pour preuve que les exploits assez banals que le soi-disant rejeton s’est empressé de réaliser croyant bien faire. Le fils de Dieu, Dieu lui-même par scissiparité est-il crédible sous les apparences d’un quelconque Gérard Majax, à moins que ce ne soient celles d’un Gérard d’Abboville quelconque ? Certaines fonctions sont soumises au devoir de réserve… Dieu ne peut s’incarner. Dieu ne peut parler.
Je ne suis pas loin de penser que la première offense faite à Dieu par les hommes est de croire que Dieu peut se révéler. Si Dieu est parfait et Dieu ne peut que l’être, il a autre chose à faire que d’apparaître à 7 sur 7 et pratiquer le ski nautique. Dieu n’a pas à se justifier. Dieu n’a, à la rigueur même, pas besoin d’exister pour être.
Dieu n’a donc pas, comme certains veulent le faire croire, créé l’homme à son image, le contraire peut, en revanche, se vérifier continuellement et ce jusqu’au discours des idéalistes contemporains qui, avachissement oblige, font de lui ce qu’ils sont en réalité : des bourgeois libéraux, politiquement corrects, gros consommateurs de culture, adeptes de la “fausse conscience”, pratiquants acharnés de “l’aveuglement éclairé” et heureux propriétaires d’une sérigraphie de Cy Twombly du temps où il était encore abordable.
Tout cela pourrait sembler plaisant alors même que cela ne l’est pas. Lorsque les anti-idéalistes (qui ne sont pas tous matérialistes, loin s’en faut !) pour être autorisés à pratiquer leur discipline doivent sans cesse rappeler à leurs devoirs les idéalistes eux-mêmes, on est pour le coup en pleine panade… “confusion des valeurs” pour employer un vocabulaire plus au goût du jour. On a franchi ainsi, insensiblement, le pas qui fait systématiquement du croyant, un dévot. Pire, le saut qualitatif qui fait que le croyant ne peut plus être envisagé que sous la forme du dévot. Ce qui est faire injure à Maître Eckhardt.
La pensée négative à laquelle certains restent attachés pour des raisons nostalgiques qui ne regardent qu’eux et à qui l’on reprochait, jusqu’à présent, de ne rien pouvoir mettre à la place de ce qu’elle critiquait, ne peut plus rien critiquer puisque rien n’existe réellement, pas même un Dieu crédible. A la place de rien qu’est-il possible d’imaginer sinon un autre rien ? Et qui donc peut reprocher quoi que ce soit à qui que ce soit ?
Ceci ne va pas sans avoir quelque effet sur la vie quotidienne. Ainsi, par exemple, dans la sphère familiale, des maîtres anciens assignaient-ils au rôle du père, celui de surveiller et de punir. C’était transcendantal sinon transcendant, mais cela présentait l’avantage de ne pas être rien. A ce rôle est substitué de nos jours la fonction de dialoguer, soit à peu près moins que rien. Comment, dans ces conditions, les fils pourraient-ils tuer les pères, ne pas sombrer dans la petite délinquance et les filles jouir sans que Jeune et Jolie ne leur apprenne comment faire et s’abstenir de fumer du henné au chènevis dans la rue ?
On ne saurait – en ce désert – que recommander aux idéalistes de tous poils, s’ils veulent que puisse se perpétuer l’idée d’une Jérusalem céleste et d’une famille heureuse et bien portante, de promouvoir l’idée d’un Dieu qui ne soit ni démocrate ni humaniste ni branché ni bavard ni titulaire d’une carte d’assuré social et d’un abonnement à l’Opéra-Bastille. Un Dieu qui, pour tout dire, serait crédible. Merci pour lui.
Amen !
Que Dieu existe, donc, ne me dérange pas, surtout qu’il n’existe pas ; ce qui me dérange ce sont les croyants de tous bords et les idolâtres dont viennent toutes nos emmerdes passées, présentes et à venir.
C’est plus fort que lui, il faut à l’homme des idoles, rien ne lui plaît davantage que la servitude volontaire, la prosternation.
“La liberté ?”
“Pour quoi foutre ! On s’emmerdera suffisamment à la retraite…”
Et quoi de plus efficace pour nous maintenir dans les fers que la religion et les idoles ?
On a tôt fait, en tenant ce discours, de passer pour l’anti-clérical caricature, l’adepte du petit père Combes, étroit d’esprit et bas de plafond, matérialiste crasse… “Tout de même !” “Dieu…” “Les cieux…” ”Vous ne pouvez nier…” “L’homme n’est pas un animal, loin s’en faut…” ”Regardez avec quelle adresse il manie la fourchette à huîtres !” “Surfe sur Internet !” “C’est pas une preuve, peut-être, de l’existence d’un au delà…” ”D’un idéal où nous devrions tendre…”
Non !
Que tous les mouvements de libération aient toujours tenu à marquer le coup en violant quelques religieuses, en étripant quelques curés et en pillant quelques temples pourrait nous faire soupçonner que, sous ces différentes exactions, ces menus débordements, se joue quelque chose de symbolique, bien sûr, mais aussi d’essentiel.
Que l’on me foute la paix avec l’âme et l’esprit ! Préoccupons-nous des corps… le reste suivra qui tient attaché ! La barbarie tente bien le coup dans un sens, pourquoi ne pas tenter l’inverse ? Ne pas penser est le Mal… Et croire n’est pas penser.
Qu’est-ce qui figure le mieux la sujétion du sujet, son aliénation et, par là, sa disparition que la soumission à un catéchisme et l’admiration, sans condition, d’une idole, serait-elle aussi dérisoire et dégénérée qu’un sportif de haut-niveau ou qu’une chanteuse de variétés ? Pas grand chose ! C’est toujours à notre mutilation que nous sommes priés d’assister en chantant des cantiques, sur les gradins des stades (“Ho, hisse, enculé !”) ou coincés entre les baffles de 300 kilowatts et les pratiquants tardifs de pogo.
C’est la même gêne diffuse qu’un esprit libre peut ressentir dans un stade, une salle de concert, un meeting politique, celle qu’il ressent dans une église, un temple, une synagogue ou une mosquée. Encore plus aisément, perdu dans une foule dont il ne partage pas la passion, en ces lieux d’un culte abâtardi où le sacré a dégénéré en religieux et où le religieux est grotesque.
Les religions constituées sont ennemies farouches des sectes, mais aussi de tous les mouvements de masse, non seulement parce que ce sont, sur ce terrain, des instances concurrentes, mais aussi parce que le religieux soumis peut y percevoir plus clairement ce qui borne son renoncement et comment le sacré se sert de lui, comment le religieux l’utilise. Le magicien malin déteste son collègue qui explique, il démystifie, mais encore plus celui qui rate, qui rend trop visible ce sur quoi il assoit son art et sa domination : “Y’a un truc !”.
L’esprit humain semble avoir une fâcheuse propension à croire, il lui faut, à tout prix… C’est vital !, croire en autre chose qu’en lui même : en Staline, en Roger Hanin, en Cantona, en Dieu, en Ophélie Winter, en Hitler, en Debord, aux Guignols, aux valeurs éternelles de la gauche, au profit, au progrès, à l’idéologie, à la science, à la marchandise, à la justice, à la liberté, l’égalité, la fraternité. A quelque chose au dessus de lui. Au fond des provinces les plus reculées se bouturent les espèces les plus hétérogènes, des emboîtements tératologiques, bouddhisme Zen sur Trotskysme, Torah et faëna, Marxisme nuageux… tout, pourvu que l’on admire, que l’on soit convoqué au spectacle de sa mutilation au dojo, à l’ashram, aux arènes, à la synagogue. Dans les couloirs, les salons… idem ! Gourous… à genoux ! A plat-ventre ! Cilice… expiations… Frappons-nous la poitrine ! Expulsons ce démon ! Que meure l’égotisme ! Crève le sujet ! “Souffrons mes frères !” “Le sacrifice, camarade !” Cela vient du ventre… des ovaires ! Des testicules ! C’est glandulaire ! Les sécrétions… les hormones, sans doute ! Toujours elles…
Le quidam a beau, obscurément, avoir la vague conscience qu’à s’oublier en un intérêt supérieur, il s’ampute, que les pratiques auxquelles il s’oblige sont ignobles, rien n’y fait. C’est plus fort que lui… et s’il y a plus fort que lui, c’est, vous avez compris, qu’il y a ailleurs, quelque part on ne sait-où, mais au-dessus, forcément… une vapeur qui le domine, un vent qui le mène. L’esprit à gaz… L’éternelle absence qui le meut…
Etre libre, cela veut dire, souvent, être seul et il ne le supporte pas. On le comprend ! Ça fait pas grand monde à qui causer… Il n’est pas seul pourtant, il a tous ses proches, ceux qui sont pareils que lui… C’est pas suffisant, ils sont, justement, comme lui, il veut mieux que lui. Et mieux, il a le choix… ce sont tous ceux qui le charment de leurs egos disproportionnés, les élus, les messies qui lui fourguent de l’intérêt supérieur en veux-tu-en-voilà. Leurs employés, leurs servants. C’est légion ! Prêtres… Popes… Capelans… Rabbi… Agas… Muftis… Pandits… Mahatmas… Bardes… Mages… Pontifes… Papes… Eubages… Epulons… Et leurs cérémonies, leurs camelotes… leur pacotille… Des idées… Des idéaux… Des vapeurs… De l’encens… De l’éther… Cachez ces selles ! Cachez ce sang ! De l’âme ! De l’essence ! Au cul la balayette !
Ite missa est !
Alors que, dans ses rêves, le quidam s’imagine terrible führer, il semble ne rien tant aimer qu’obéir et ne rien craindre davantage que désobéir. Il lui suffit pour se satisfaire de cette existence si peu satisfaisante de répercuter à l’échelon immédiatement inférieur, la violence qu’il subit derrière son clavier. La hiérarchie et ses subtils distinguos peuvent ainsi s’épanouir à l’aise. Toutes les structures religieuses génèrent des hiérarchies minutieuses qui garantissent leur bon fonctionnement : diacres/sous-diacres ; commissaires/inspecteurs ; commissaires politiques/bourreaux ; fürher/gauleiters ; Division I/Nationale III ; premier cercle/ courtisans ; Visa Premier/Platinium ; Bata/Lobb ; militant de base/secrétaire général ; sous-fifre/Mandarom ; soliste/choriste ; favorite/”deuxième-bureau” ; rédac’chef/rédacteur en chef adjoint ; best-seller/grand écrivain… Et de toutes ces nuances naissent les liturgies et leurs cortèges de soumission à des chefs de plus en plus minuscules jusqu’à l’abandon de soi… l’extrême-onction que l’on ne peut plus refuser.
Les choses ne seraient pas si graves que cela si le religieux n’infestait pas jusqu’aux structures prétendument laïques, si tous ceux qui s’associent dans une entreprise de libération n’avaient rien de plus pressé que de réitérer, en pire, la structure oppressive contre laquelle, soi-disant, ils luttent. Que les églises soient religieuses et que les armées reposent sur l’obéissance aveugle à la hiérarchie, on ne peut pas, véritablement, leur reprocher. En revanche, qu’elles soient plus démocratiques que ceux qui y sont opposés et qui veulent les combattre, c’est, pour le moins, gênant ; que ceux-ci choisissent librement les mêmes structures et en décalquent le fonctionnement peut inquiéter davantage.
Le maoïsme dans sa forme chinoise et dans sa caricature indigène des années 70 peut, encore là, servir de parangon. Il serait peu charitable d’insister, les chrétiens, qui étaient nombreux dans ces groupuscules matérialistes, pourraient nous en vouloir. Ils veulent bien faire pénitence, mais aussi choisir les verges dont ils se flagelleront et ceux qui les leur donneront.
Peut-être ne faut-il pas se contenter de cette constatation morose (“Y’a pas plus con que celui dont on a oublié de vérifier qu’il était intelligent…”) et avancer deux hypothèses, l’une qui vient de la psychologie expérimentale (à destination des intellectuels égarés qui sont les vecteurs privilégiés des libérations qui n’en sont pas unanimement convoqués pour parler de ce qu’ils ignorent et qu’ils ne pratiquent point : la liberté) : “Les sujets manifestant une autoévaluation élevée se soumettent plus volontiers aux suggestions que les sujets ayant une autoévaluation faible” (British. J. Soc. Clin. Psychol., 10, 144-122, 1971.). Cela expliquerait le nombre démesurément élevé d’intellectuels dans toutes les entreprises de “libération” soixante-huitardes qui n’étaient, dans la réalité, que des machines à décerveler.
La deuxième est plus tragique, puisqu’elle renvoie aux calendes grecques le problème central de l’organisation, Freud était convaincu que […] “toute société repose sur un crime commis en commun”.
Et si c’était ce meurtre, celui du sujet ?
Je ne demande qu’une chose : que l’on me prouve le contraire.
Il vaudrait mieux sinon continuer à faire comme si c’était celui du Christ.