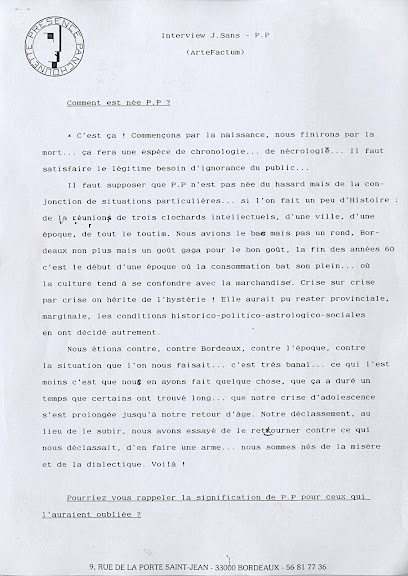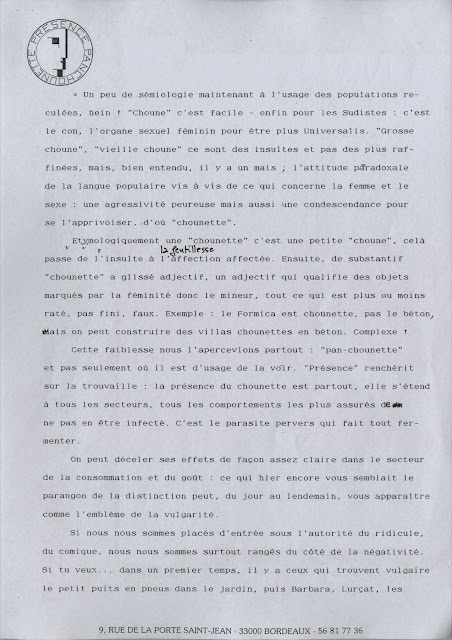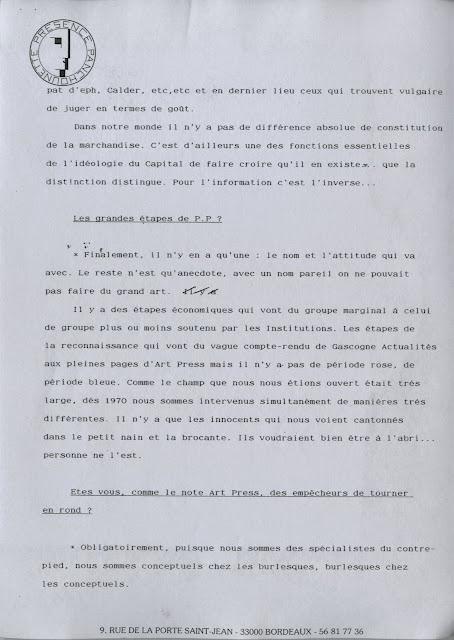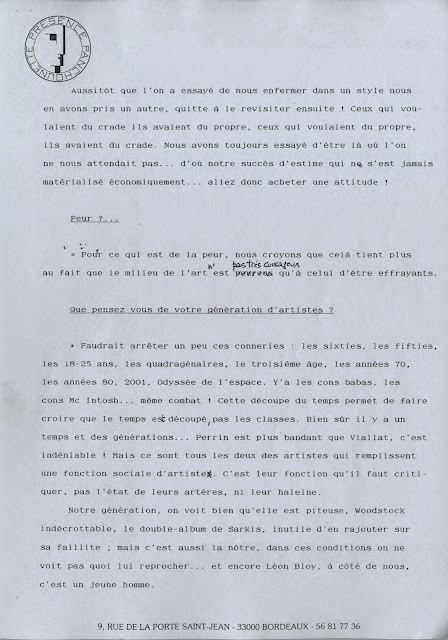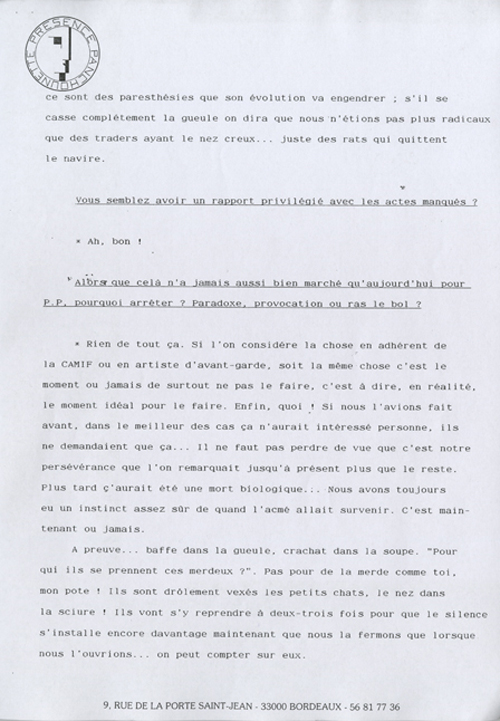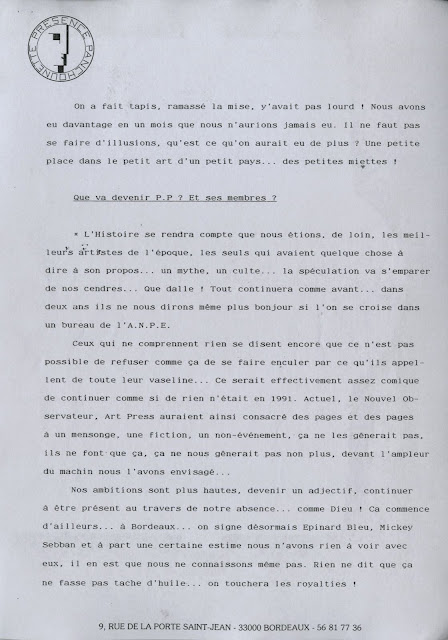Envoi
La question sur toutes les bouches : qui est Présence Panchounette ? Où est le corps de Présence Panchounette ? Présence Panchounette est-elle un mythe ? Réponse : Présence Panchounette est une créature protéiforme qui s’est vu attribuer les matérialisations les plus grotesques : artistes niçois, dangereux paranoïaques, jusqu’à Jacques Soulillou qui s’est vu proclamé Présence Panchounette à lui tout seul. Connaissant la sûreté de son goût (n’a-t-il pas éclairé d’une post-face un texte sybillin, dix mètres carrés de fausse pierre, cinquante mètres carrés de tapisserie), il ne peut en être question.
Tout le monde peut se dire Présence Panchounette, le cachet ne fait pas foi, il est garanti par autre chose que : x joueurs de rock-and-roll, Universitaires, pédicures, Rois du Maroc, homosexuels, brocanteurs, champions de boxe, charcutiers, et cela suffit pour que les choses soient claires, Marc Devade, Hervé Fischer, Luc Boltanski ne sont pas Présence Panchounette.
Chounette est un concept maîtrisé, parlé par des millions de personnes (dont si vous lisez ces lignes vous ne faites pas partie), une pratique gérée par des millions d’autres (dont vous êtes à coup sûr). En éclair – un ricanement.
Pour que les choses soient lumineuses, Présence Panchounette signale seulement que sa présence est partout. Le groupe ou la fiction du groupe Présence Panchounette disparus, détruits, dissous, le chounette dégradera encore ce que vous avez de plus cher, au choix : les manifestations théoriques ou pratiques que vous croyez hors d’atteinte… votre cher petit moi.
Deux ou trois choses que l’on sait d’elle, 1977
publié in Œuvres choisies, Tome I, 1987
ARCHIVES
Ci-dessous un texte écrit par mes soins,
comme tous les autres
(demandes de subvention comprises)
publié in Art Press n° 134

Exposition « Back is back »
Mamco, Genève, 2005
Collection particulière D & F Roux
Capri, c’est fini !
Et dire que c’était la ville de mon premier amour

« Ceci n’est pas une exposition de Présence Panchounette »
Garage Cosmos, Bruxelles, 2018
Collection particulière Eric Fabre
Questions adressées par Catherine Millet à Présence Panchounette
1- Le groupe Présence Panchounette a-t-il été lié directement, de façon militante, au mouvement situationniste ?
Quels étaient, à l’époque, les objectifs ?
Comment le groupe se situait-il par rapport au pop art, au nouveau réalisme, à l’art conceptuel ?
2- Dans un texte récent, vous parlez de la « faiblesse pratique » du situationnisme, constatant qu’aujourd’hui le principe de détournement n’a plus de valeur critique mais sert aussi bien le show-biz (par exemple l’émission des Nuls) que les avant-gardes les plus « gonflées » par le marché américain.
Plutôt que de le regretter avec nostalgie, ne faudrait-il pas inventer de nouvelles stratégies ?
Votre propre pratique a-t-elle évolué au cours de ces dernières années ?
N’y a-t-il pas plus de poésie, plus d’esthétisme dans certaines de vos œuvres récentes (par exemple la série utilisant les objets africains) que dans l’utilisation plus simple du papier peint façon op’art ?
3- Vous revendiquez certaines antériorités, par exemple par rapport à Tony Cragg. Vous vous manifestez parallèlement à l’exposition Steinbach du Capc. Pensez-vous que votre travail et celui de ces artistes soient vraiment de même nature ?
4- Il y a plus de radicalité critique dans vos textes et dans votre attitude que dans l’attitude des simulationnistes américains ou des artistes français comme Leccia ou BasileBustamante. Pensez-vous que cette radicalité apparaît aussi dans les objets que vous exposez ?
5- Toutes ces questions sont liées aux positions respectives que ces artistes et vous-mêmes occupez dans le marché de l’art.
Avez-vous, à un moment donné, revendiqué la marginalité ?
Si oui, qu’est-ce qui vous a fait changer d’avis ? Pour en revenir à la deuxième question, un détournement « réussi » n’est-il pas quasiment « invisible » ?
6- Finalement, votre propre récupération dans le courant actuel du détournement « soft » ne parachèverait-elle pas la logique nihiliste de votre démarche ?
Réponses adressées par Présence Panchounette à Catherine Millet
1-
A : Non
B : Divers
C : Ailleurs
2-
A : Peut-être
B : Non
C : Non
3- : Non
4- : Oui
5-
A : Non
B : –
C : Oui (pour les aveugles)
6- : ?
Chère Catherine Millet,
Nous savons bien que nous allons encore vous décevoir, nous sommes là pour ça et nous comptons le faire davantage encore mais nous vous aimons. Vos dents, vos cheveux, la couleur de vos yeux, votre taille. Vous ressemblez à des femmes que nous avons aimées, bonne volonté et délicieuse naïveté comprises, vous n’y pouvez rien. Même le reflux de votre sang à la lecture des mots « bonne volonté » et « naïveté », nous l’aimons.
Imaginez donc, une salle de musée vide, la boule à facettes suspendue, et imaginez que nous dansions ensemble. Comme nous sommes plusieurs et que ce n’est pas pratique, imaginez donc qu’à chaque réponse un autre d’entre nous vous prenne dans ses bras. Les numéros renvoient à vos questions, ils pourraient renvoyer aux touches d’un juke-box. Seuls les indiscrets et les curieux pourront entendre ce que nous vous chuchotons à l’oreille que vous avez masquée d’un rideau de cheveux noirs et brillants. Musique !
L’I.S. haïssait les militants

Exposition « Back is back »
Mamco, Genève, 2005
Collection particulière D & F Roux
1 A : Certains d’entre nous faisaient partie en 67-68 de ce qu’il est convenu d’appeler le milieu pro-situ, ceux-là avaient la provenance sociologique, la colère et tous les numéros de l’Internationale Situationniste, dont un en danois, les autres non. A vingt-cinq ans nous n’étions déjà plus que des situationnistes sans projet, moins rien que pour l’I.S., des monstres minuscules pour les autres. Ça continue.
Nous avons gardé de ces moments-là des habitudes et des comportements, l’usage de la lettre d’insultes par exemple. Cet exercice de style bien français a à ce point perdu son efficacité que l’on a pu voir des gens nous poursuivre dans des foires d’art en déclarant, alors que nous ne les connaissions pas : « Mais si, vous nous connaissez, vous nous avez même insultés ». Que la reconnaissance puisse passer par de si tortueuses déclarations est le symptôme que le rejet violent est soumis à des aléas inconnus jusqu’alors et que la stratégie, pour ne pas donner prise, doit revêtir des aspects plus baroques et plus anodins dont cette lettre, étreinte qui veut étouffer, serait un exemple si elle n’était pas sincère.
Il doit, sans doute, et pour les plus connaisseurs, rester de cette familiarité une coloration plus forte puisque nous avons été émus récemment de lire quelques lignes qui nous étaient adressées, signées Gilles Ivain que nous avons eu la faiblesse de croire de la main d’Ivan Chtcheglov (elles ne le sont peut-être pas).
Deux reproches en passant, si brefs qu’ils ne vous verront pas retourner vexée à votre table : vous auriez pu vous dispenser de cette question en consultant L’internationale situationniste de J.-J. Raspaud et J.-P. Voyer aux Editions Champ Libre ; juxtaposer militant et I.S. est assez hasardeux dans la mesure où si nous nous sentions proches à l’époque de l’I.S. c’est qu’elle haïssait les militants et n’en réclamait pas.
Quelques babioles peuvent encore faire penser à notre voisinage mais elles sont aussi preuves de notre éloignement. Nous avons détourné La société du spectacle en 1978 et un slogan situationniste la même année en en faisant : « A bas la Société Spéculaire Marchande » (T-shirt à venir).
1 B : En ce qui concerne ce que nous voulions, la plus grande confusion régnait, sans doute la Gloire, mais aussi que le monde cesse d’être la saloperie qu’il continue d’être et d’autres désirs plus bonniches encore. Nous ne nous faisions guère d’illusions là-dessus et très tôt, un graffiti de novembre 1968 disait : « Tout est comme avant », il était signé Présence Panchounette.
1 C : Pour ce qui est de « nous situer par rapport » il faudrait plutôt lire : « se sentir proche de… ».
Nous nous sentions donc proches du dadaïsme, du surréalisme, surtout belge (Märien, Nougé, Scutenaire, Les lèvres nues), du design radical (Archizoom, Superstudio), d’Artaud, de Bataille, de Céline, Gombrowicz, Lefèvre, Lautréamont et Starobinski pour ce qui est considéré comme majeur. Mais là où ça se complique c’est que nous nous sentions proches aussi de menues bricoles : les habitants paysagistes, les photo-romans à cent sous, le cinéma stupide, le rock and roll, Carnaby Street, les fêtes foraines, toute la ribambelle des objets échoués dans les Rastros. A la fois l’énumération célèbre de Rimbaud et ce qui a fait le stock rétro des années quatre-vingts ; pour être grossiers, le populaire, le vulgaire qui nous servent encore de coin pour miner. C’est son éloignement du milieu où nous l’utilisons qui nous fait paraître nihilistes alors que dans le fond nous sommes aussi positifs qu’un ouvrier à la retraite qui sculpte des sirènes en polystyrène et que l’on retrouve pendu dans sa remise à outils une semaine après la mort accidentelle de son fils. Nihilistes et vaguement démagos à se relire. Le pop-art, le nouveau réalisme, l’art conceptuel ne nous paraissaient que ce qu’ils sont, d’aimables variations marchandes.
2 A : Pour ce qui est du « texte récent », nous y parlons de « faiblesse pratique » et de « faiblesse théorique », vous avez déjà, de toute façon, deviné que, contrairement à l’attitude triomphante que vous sembleriez aimer nous voir adopter (du sang ! du sang !), nous sommes relativement humbles et trop modestes pour croire qu’il nous est dévolu d’inventer de nouvelles stratégies. Nous ne sommes pas là pour donner une secousse au vieux monde, ni un coup de pouce à la Florence à venir.
Tout cela a quelque chose à voir avec la nostalgie et donc la mort, « ce pli ancien que l’on a fait prendre à nôtre âme ». Le bonheur est imbécile car permanent, sa recherche aussi, la joie ne l’est pas, elle ne dure jamais, elle nous est encore permise.
Si nous voul(i)ons que le monde change, nous n’av(i)ons pas la prétention de pouvoir le faire, ni de penser que notre version serait plus intéressante. Très vite nous avons détesté le pouvoir mais nous poussons la cohérence jusqu’à détester en exercer un. C’est la seule explication des déceptions que nous pouvons causer aux jeunes filles. Suffisante.
2 B : Que notre pratique ait changé, nous ne le croyons pas. La production des objets « poétiques » a toujours été simultanée à d’autres productions. Il n’y a pas pour nous d’objets simples et d’objets complexes, d’objets qui pensent et d’autres qui ne pensent pas.
2 C : Si elle n’a pas évolué elle s’est bien sûr diversifiée mais nous n’avons jamais été du simple au complexe ni du radicalisme au poétique, nous avons laissé les objets libres de l’effet qu’ils produisaient. Notre hache a deux tranchants et nous utilisons l’un ou l’autre suivant le moment historique où il nous semble adéquat.
3 A : Pour ce qui est de l’antériorité, si revendiquer de nos jours une exactitude historique, ne serait-ce qu’anecdotique, n’était pas parfaitement inadmissible, ce ne serait pas nous qui le ferions mais les historiens. Et pas seulement par rapport à Cragg et à Steinbach mais pêle-mêle par rapport à Bijl, Armleder, Lavier, Lemieux, Prince, Lavier, Taffee et une douzaine d’autres encore. Nous revendiquons plutôt, pour notre part, une postériorité pour ce qui passe pour contemporain. La dernière exposition à la FIAC était caractéristique de cet état d’esprit ; nous avons recréé des œuvres qui dataient des environs des années 1880, des dizaines de spécialistes se sont fait avoir en y voyant des pastiches d’œuvres allant de 1954 à 1985, les autres ont trouvé que c’étaient les seules pièces qui ne faisaient pas antiquités. Cela pourrait être la démonstration, par l’absurde, que l’antériorité, il ne faut pas gonfler les couilles du peuple avec. Si nous avons trouvé deux, trois gadgets, deux ou trois week-ends avant d’autres, il n’en est que plus comique de constater qu’il n’y a rien de commun entre nous et ces zozos. Nous jouissons à leur égard du solide complexe de supériorité que nourrissent les cancres envers les premiers de la classe.
Steinbach est un cas particulier, les réactions que nous avons eues à son endroit (voilà un garçon qui a travaillé le papier peint, le linoléum et même mis en scène une exposition, on se demande où il va chercher tout ça…) sont plus essentiellement politiques, éthologiques aussi[1]. Ce n’est pas la même chose lorsque quelqu’un pisse dans votre jardin que lorsqu’il pisse dans vos godasses.
4 : Vous lassez-vous, Catherine ? Ou bien est-ce notre haleine qui se gâte ? Voilà que vous vous débattez, que vous essayez de retourner notre humilité contre nous alors que : si nos textes sont plus radicaux, notre attitude plus radicale, nos objets le sont forcément puisqu’ils en sont inséparables.
Bien évidemment que cela se voit, cela crève même les yeux. Vous voulez que nous vous disions pourquoi ?Et bien parce que les objets que nous exposons ne sont pas religieux, aussi sacralisés soient-ils par le processus d’exposition.
5 A : Quant à revendiquer une marginalité quelconque, vous savez bien que c’est le genre de choses que l’on ne peut revendiquer dans la mesure où ce sont les autres qui se chargent de le faire pour nous. La seule chose que nous revendiquerions, à la rigueur, serait une légère singularité.
5 B et 2 A : Soit le moment crucial, le jour se lève et le personnel donne des signes de fatigue, à preuve cette cacophonie, le juke-box aussi déconne.
La marque de la réussite d’un détournement serait, d’après vous, sa quasi « invisibilité », ce n’est pas l’invisibilité qui pose un problème, c’est le « quasiment ». Il faudrait donc que quelques-uns comprennent (le moins possible), cela nous rappelle qu’en exagérant Benjamin on pourrait dire que : proposer un modèle, le plus ténu soit-il, « c’est être complice des vainqueurs, c’est-à-dire des bourreaux ». Les femmes voudraient-elles désormais autre chose ? Il ne le semblerait pas si nous vous écoutons et c’est dommage. Un détournement réussi est peut-être simplement un détournement que l’on ne peut pas voir.
Tout cela nous ramène, après bien des précautions, à ce qui devrait être notre air fétiche, le dernier livre de Guy Ernest Debord. Nous vous avons dit que nous vous aimions, nous n’allons pas changer d’avis en quelques paragraphes et nous ne connaissons toujours pas Catherine Francblin, mais permettez-nous de ne pas être, sur ce sujet, du même avis que vous, voyez-y, peut-être, une tactique de séduction. Si votre amant s’intéressait à Marie Laurencin, vous vous y intéresseriez aussi et vous auriez raison, lui pas forcément.
Pour tout dire et d’un ton léger, nous avons eu quelque plaisir à lire les Commentaires sur la société du spectacle, le même que nous aurions eu à écouter le dernier disque de Chuck Berry, le plaisir de la nostalgie. Lorsque l’on n’entend plus que Madonna on peut se réjouir, Chuck Berry fait toujours du rock and roll, le problème c’est qu’il fait encore du rock and roll. Si votre emballement ne nous surprend qu’à moitié, il nous étonne néanmoins, vous auriez pu l’avoir il y a vingt ans et sinon pour plus juste, du moins pour plus justifié. S’enthousiasmer pour Debord alors qu’il ne comprend visiblement plus rien relève du désir de croire et il ne faut croire en rien.
Que nous ayons écrit que le détournement n’avait plus à ce jour aucune valeur critique, cela ne nous confère aucune lucidité particulière, il suffit de feuilleter le Figaro Magazine et de regarder Canal + pour se rendre compte que le détournement est devenu un des modes d’expression privilégié du spectacle ; cela ne serait pas encore si grave qu’il faille douter de tout le situationnisme.
Il faut suspendre un instant la musique pour constater que s’il y a bien détournement dans la publicité, par exemple, fût-il mineur et aux ordres de la marchandise, il n’y a pas plus de détournement que de beurre au cul dans les productions des nouvelles avant-gardes new-yorkaises. Il s’agit dans leur cas de l’apposition grotesque d’une théorie radicale et d’une marchandise ridicule.
Ce qui est inquiétant dans le dernier livre de G.E.D., c’est la stratification mentale dont il fait l’étalage. Plus que de vagues relents réactionnaires, parce que nostalgiques : « du temps où les experts savaient », « du temps où le vin n’était pas trafiqué », « du temps où les Grimaldi s’appelaient Stuart », qui pourraient être contresignés par Louis Pauwels et qui conforteraient le journaliste du Nouvel Observateur « du temps où Jean-Paul Dubois s’appelait Claude Roy » dans sa prétention à croire qu’il est des happy few qui peuvent pénétrer la pensée de G.E.D. pour peu qu’ils possèdent en sus un Filofax, c’est du raidissement de sa pensée dont il faut se tenir éloigné autant que faire se peut.
De libertaire, la pensée de G.E.D. est tournée blanquiste. Comme toutes les pensées dont le ressort est la grandeur, elle file sur la pente de l’aristocratisme, son ambition est sa perte. La disparition du mot « ouvrier » qui, il y a quelques années encore, faisait lever dans les yeux de ceux qui le lisaient une forêt de drapeaux rouges, en est le symptôme statistique le plus apparent. Où sont passés le rouge, les drapeaux et les ouvriers ? Est-ce cette absence qui fait luire vos yeux ?
« Et donc qui diable peut commander le monde démocratique ?», c’est le genre de questions faussement ironiques que se pose G.E.D., il se verrait bien, à la rigueur, le Fischer de ce Kasparov-là, mais personne ne veut plus jouer avec lui, l’échiquier est désert et la tour abolie.
Pour employer les métaphores militaires dont raffole G.E.D., l’armement conventionnel peut faire des dégâts considérables surtout lorsqu’il est convenablement utilisé mais une armée moderne qui ignorerait l’existence de l’armement nucléaire courrait à sa perte.
Dans ces conclusions il est inutile de savoir à quelle catégorie pathologique appartient cette intelligence, il suffit de se rendre compte qu’elle a perdu une partie de son efficacité qu’elle rêvait totale. On peut supposer que G.E.D. est un peu (faut-il rappeler que son éditeur, Gérard Lebovici, a été assassiné il y a quelques années et que ses tueurs courent toujours ?) dans l’état de Mick Jagger à Altamont (où l’un des spectateurs avait été assassiné par le service d’ordre), effrayé que la réalité puisse le rattraper à la course. Comment justifier autrement ces : « détachements spéciaux», « archives réservées», « bâtiments impénétrables», « analyses secrètes», « singuliers experts», « extravagantes autopsies», « étranges personnages», « survivants fictifs», qui sont des traces stylistiques d’une raison affolée.
Voilà… cela devrait suffire à ce que vous regagniez votre table troublée, n’est-ce pas l’essentiel ?
6 : En ce qui concerne votre conclusion, nous ne saurions trop nous avancer, certes il existe des signes de notre récupération (votre intérêt tardif même…) mais ils ne sont pas encore si alarmants que nous ne puissions cet été vous inviter à danser au bord d’une piscine dans le Luberon. De toutes les manières, nous sommes à la périphérie et non au centre, nous voulons affronter la banalité plutôt que le grandiose, Saint-Julien-le-Pauvre davantage que Rodez, notre récupération dans ces conditions n’est qu’anecdotique.
Nous sommes vieux et fatigués, nos pieds ont enflé, c’était une soirée charmante, appelez-nous un taxi…
Il faut faire frissonner mais point trop n’en faut, nous vous poursuivons jusque sur le parking et alors que vous tenez votre portière entrouverte, nous ajoutons en chuchotant, le plus play-boy que nous puissions : il serait un peu précipité pour toutes les raisons que nous vous avons données (et nous avons entendu le soupir de soulagement des lâches) et d’autres encore, de mauvaise foi, de jeter le bébé avec l’eau du bain. Sous prétexte que le situationnisme est daté et clos, de refuser d’examiner ce qui lui reste de pertinence. Blessé seulement, il bouge encore et l’enthousiasme que l’on met à tresser a posteriori ses louanges est aussi dangereux pour lui que la précipitation veule avec laquelle on l’envoie aux poubelles de l’Histoire. Tout cela ne fait que dissimuler le fait que, pour l’instant encore, il n’est rien de mieux à se caler sous l’hypothalamus.
Bibliographie
1 A : Sweet Little Sixteen’s, Chuck Berry
1 B : Y a une route, Gérard Manset
1 C : Working Class Hero, Marianne Faithfull
2 A : Les Elucubrations d’Antoine, Antoine
2 B : Imagine, John Lennon
2 C : Rock Around the Clock, Bill Haley et ses Comets
3 : Tous les garçons et les filles, Françoise Hardy
4 : Born to be Wild, Steppenwolf
5 A : Je t’aime, moi non plus, Serge Gainsbourg et Brigitte Bardot
5 B : A Wither Shade of Pale, Procol Harum
5 C : Street Fighting Man, Les Rolling Stones
6 : Il est cinq heures, Jacques Dutronc

Exposition « Back is back »
Mamco, Genève, 2005
Collection particulière D & F Roux
____________________________________________________
[1] Diffusion d’une invitation en forme de publicité des magasins Conforama ou But, offrant en solde les Consoles réalisées par P.P. (et antérieures à celles de Steinbach !). Distribution, le soir du vernissage de l’Américain au Capc, par des pères Noël, de tracts et de posters, et exposition, le même soir, des consoles P.P.. P.P. poursuivit Steinbach jusqu’à son exposition à Lyon, à la Villa Gillet. (note de la rédaction).

Retrouvées* dans les méandres du Net
* Ces deux toiles font, approximativement, 150 x 150.
Exposées pour la première fois à La Criée de Rennes pour l’exposition L’Ordre total,
elles ont été achetées par Eric Franck, un marchand suisse.
Je suppose qu’il avait été sensible à leur rapport chromatique avec le drapeau helvète.
Elles sont passées en vente publique, ce qui leur vaut, sans doute, cette célébrité électronique.
D’après le site où je les ai retrouvées, Présence Panchounette occupe la 10 374° (4741°) place d’un classement (?) des artistes mondiaux.
Ce n’est pas si mal !
Les Grands Transparents
Les hasards objectifs – les rencontres
1972 : 1, rue de la Vache : Présence Panchounette
1989 : 1, rue des Etables : Eric Fabre.
Bordeaux, mais cela pourrait être Zurich ou Vesoul, en revanche cela ne peut être qu’Eric Fabre et/ou Présence Panchounette.
D’ordinaire, les artistes sont aux pinceaux, les marchands au chéquier, les critiques à tous les râteliers et les vaches dans le pré. Anda toro ! La vache est aux étables.
Si un tableau, ce sont de couleurs en un certain ordre dispersées, cela fait vingt ans qu’Eric Fabre peint inlassablement un tableau qui a pour titre : « Paysage de l’art encore vivant ». Quel besoin donc de se risquer – pour de vrai – où jusqu’à présent, il avait laissé les autres se débattre ?
Par goût du risque justement, pour le geste et par pur caprice, mais en toute humilité.
En province, en face d’une école des Beaux-Arts, il montre ce que ses artistes n’ont jamais montré : des sculptures qu’ils auraient pu imaginer.
Comme les sous-fifres de la pensée prêt-à-porter (ready-made) ne l’envisageront jamais, ce n’est pas l’objet qui importe dans l’objet, mais l’attitude qui va avec.
Le chic, les couilles, le culot.
Dandy tranquille, produit par Présence Panchounette comme à l’aller, il les produit, Eric Fabre marche sur les eaux du lac de Tibériade et s’en contrefout (il a des palmes).
Entre nous c’est fifty les artistes qui montrent le marchand, fiffy le marchand qui était un artiste. L’un dans l’autre, si les autres s’y perdent, on s’y retrouve.
Ce texte (mars 1989) publié dans Kanal, n° 43 servait de communiqué de presse
à une « exposition » d’Eric Fabre devant avoir lieu Galerie du Triangle du 10 au 29 avril.
L’exposition n’a en réalité, pas vraiment eu lieu.
Eric Fabre bien qu’aidé par son épouse et son homme à tout faire s’étant plus ou moins dégonflé.
S’il avait joué le jeu (même fait semblant de le faire), ça aurait pu être une exposition « importante ».
Putain ! Y a pas à chier, quand j’étais jeune, j’étais drôlement balèze !
(La preuve!)
1968
Dans une manifestation (performance collective assez usitée cette année là) trois clochards intellectuels scandent : « Paix en Algérie ! ».
Le rang de devant et celui de derrière clament : « Nous sommes tous des Juifs allemands ! ». Le malentendu s’installe.
Novembre : un graffiti proclame : « Tout est comme avant ! ».
Il s’agirait, selon certains historiens, de la première manifestation plastique de Présence Panchounette.
1969
Sans doute soucieux de l’air du temps soumis au climat régnant se fonde, dans un quartier promis à la rénovation, une soi-disant Internationale Panchounette qui se dote d’un manifeste où l’on peut lire entre autre : « L’Internationale Panchounette n’a pas pour but la subversion. Dans le Monde où les gens qui le confortent de la main droite reconnaissent de la main gauche la nécessité de la changer, elle est la seule Internationale qui trouve que TOUT VA BIEN ».
Le reste du texte hésite entre la provocation estudiantine et ce que l’on a coutume de qualifier dans les milieux autorisés de : « pro situationnisme ».
1970
Naissance des années 70. Celles dont personne ne se souvient.
1971
Le terme « internationale » est désormais remplacé par : « Présence ».
Les membres de P.P inaugurent la série des re-visitations des gestes fondateurs de l’art ; en guise d’excursion à Saint-Julien le Pauvre ils se rendent à Verdelais en voyage organisé. Les personnes du troisième âge qui composent le reste du contenu de l’autobus les considèrent avec la même suspicion qu’ultérieurement les critiques d’art.
1972
Profitant du laxisme de la législation française P.P se déclare au Journal Officiel dans le but avéré : « d’encourager les Arts, la Culture et les Loisirs ».
Inauguration de la 4ème Biennale des Arts Panchounettes. On peut y voir : des slips en néon, un puits en pneus, de la toile cirée, un électrophone de marque Teppaz et quelques jerrycans à mazout installés en un confondant mélange de duplicité et d’innocence.
Personne, à l’époque, n’aurait voulu parier un rouble sur la réussite de leur carrière ultérieure, ni même sur leur succès à l’examen d’entrée à l’Ecole des Beaux-Arts.
1973
Pensant se constituer à peu de frais une collection fabuleuse ils ouvrent 1 rue de la Vache, le Studio F4 où ils déclarent exposer sans choix quiconque en fera la demande.
Se succéderont sur les murs tapissés de papier peint fausse pierre quelques épigones de Support-Surface et des artistes refusés à Montargis et Ussel. Le public croyant à l’ouverture d’un club de loisirs s’installe autour du poêle sans faire attention à quoi que ce soit, même aux croix gammées de teintes pastel et aux cocktails Molotov il est vrai ininflammable.
N’ayant pas la patience d’attendre le boom de l’art, ils jettent la plupart des œuvres qu’on leur confie.
Ils s’autoproclament Champions du Monde de Boxe des Artistes Plasticiens sans que personne n’y trouve à redire. Terrorisé par leur gabarit légèrement supérieur à la moyenne, Jean Clair concède : « Vous êtes les artistes des années 80 ».
1974
Avec quelques années de retard sur les détournements situationnistes et quelques années d’avance sur le groupe Jalons P.P édite un numéro pirate des Chroniques de l’Art Vivant dans lequel ils insultent copieusement Gérard Régnier et les artistes d’avant-garde (« petits cons sexistes », « petits bourgeois », « ambigus schizophrènes »).
1975
Ils mettent une sourdine à la production d’objets dérisoires et au goût immodéré qu’ils professent pour les porte-clés, tapis arabes, poupées de foire et autres colifichets pour mettre en avant une pratique qu’ils essaieront de faire passer durant quelques années pour leur logo : le papier peint (fausse pierre de préférence).
Ils vont jusqu’à proposer à Yvon Lambert de tapisser sa vitrine alors même qu’il expose Daniel Buren dont ils trouvent la pratique assortie au goût de la bourgeoisie pour le design. On ne pourra, en l’occurrence, leur reprocher qu’une attention plus soutenue que la moyenne à ce qui ne les regarde pas.
1976
Rien
1977
P.P fait son irruption sur la scène de l’art officiel, ils exposent Galerie Eric Fabre. Papier peint fausse pierre en devanture, sur les murs de la galerie, papier peint style Op-Art.
Dans le catalogue on pouvait lire : « L’Intelligence commençait à se préoccuper du problème du goût ». « Un discours qui aurait fait du savoir le signe ultime de la distinction aurait été le bienvenu », « La neutralité du ready-made semblait tout à coup suspecte », « Les marchandises ne voulaient pas (re ?) devenir des choses », « La théorie ne se parlait plus théoriquement », « On consultait le catalogue des 3 Suisses, un essai sur l’art conceptuel et une envie de vomir nous venait », « Ce qui est intolérable dans le vulgaire, c’est son innocence », « Le goût se déplace, le mauvais goût dérive. Tous (les deux ?) liés à l’économie de marché », « Le prolétariat attend les tapisseries d’inspiration conceptuelle qu’on lui prépare ».
Le prolétariat s’impatiente.
1978
Ils échangent le contenu de deux galeries, l’une rive droite spécialisée dans le néo-surréalisme, l’autre, rive gauche spécialisée dans l’avant-garde. Le jour du vernissage le public dépaysé s’interroge, les marchands craquent.
A propos de cette exposition paraîtra dans Le Monde un articulet qui leur servira de bibliographie jusqu’en 1993.
Ils semblent désormais aux portes de la reconnaissance par leurs pairs. Ils rencontrent Daniel Buren qui leur fait un cours, deux d’entre eux s’endorment, les autres hochent la tête avec commisération et trouvent sa critique limite.
1979
Ils exposent de nouveau Galerie Eric Fabre : deux néons qui proclament : « A bas le Capital » et un miroir gravé sur lequel est gravé : « A bas la Société Spéculaire Marchande ». Le post-modernisme n’a qu’à bien se tenir. L’exposition s’intitule : « Se voir, encore ». Se voir, pour une femme, c’est avoir ses règles.
Le soir du vernissage Pierre Restany sous l’emprise du gâtisme et de la boisson bombe sur les murs de la galerie : « Vive le travail ». Bertrand Lavier ricane. Ils n’auraient pas du.
1980
Ils montrent leurs travaux Galerie Jacques Donguy à Bordeaux. Cette exposition marque le retour à une certaine excentricité, les nains réapparaissent et la guirlande lumineuse et l’accrochage à la mords-moi-le-nœud. Le public regarde la femme à poil qui fait un strip-tease. L’invitation trace leur ligne de conduite : « Réussir, de toute façon, est notre échec ».
1981
Coup d’arrêt brusque aux avances sociales, le pouvoir en changeant de mains met désormais l’accent sur la Culture. Le boom de l’art est à venir.
1982
La sculpture de l’objet devient envahissante. Malgré une pratique qui peut se targuer d’une certaine expérience et un arrière-plan théorique relativement solide, Présence Panchounette n’est retenue dans aucune des manifestations officielles à son sujet.
1983
Premier achat institutionnel, le Musée d’art moderne se fend de 9 000 francs pour acquérir un objet de 1974.
Première exposition dans un espace institutionnel à la Maison de la Culture de Châlon sur Saône.
Au début des années 70, ils alignaient les débris plastique de leurs plages, au début des années 80, Tony Cragg devient un artiste international en faisant la même chose.
A Châlon, ils tapissent entièrement les murs de la salle d’exposition de ces mêmes débris, exposant le gadget du sculpteur anglais comme s’il n’était que l’un de leurs propres déchets. Succès populaire, les professionnels les traitent de : « parodistes ».
1984
Après The Best, l’année précédente, c’est : The Worst. En fait pratiquement la même exposition où les objets sont disposés de telle manière qu’ils ne sont pas lisibles individuellement mais qu’ils constituent un objet exposition.
De terroristes post-situ, ils passent au statut enviable d’animateurs pour Noces et Banquets.
« Ce n’est pas nous, hélas ! qui avons fait pencher la typographie des magazines ni émerger l’Intelligence vers le mineur, c’est « l’air du temps ». Regrets éternels. Ca s’appelait HISTOIRE avant qu’Althusser n’étrangle sa femme ».
1985
Ils exposent à Los Angeles où la commissaire américaine de « Manipulated Reality » avait souhaité leur présence ; le commissaire français s’appelle Jean-Louis Froment, il est directeur du C.A.P.C de Bordeaux.
1986
Ils mettent en scène la collection du FRAC Midi-Pyrénées en l’installant dans ses meubles, Knoll pour Viallat, Starck pour Di Rosa, lampe à pétrole pour Bernard Dufour. Le catalogue est un détournement de Décoration Internationale. Ils sont redevenus intelligents, les artistes protestent.
Pierre-Jean Galdin leur permet d’investir les 1000 m2 du C.A.C de Labège où ils recréent une Afrique de pacotille. Ils confirment là qu’ils peuvent être un redoutable groupe de scène en mêlant rock et makossa, Bateke et Sony.
1987
Parution du 2ème tome de leurs « Œuvres Choisies » à l’occasion de la reprise d’Expression d’Afrique au musée de Calais. Deux ouvrages complaisants où ils ne se lassent pas d’être satisfaits d’écrire et de penser mieux que les peintres alors même qu’ils peignent plus mal que des cochons.
1988
L’institution accélère dans la ligne droite et leur propose d’exposer au CNAP où ils se montrent plus maladroits que n’importe qui.
Leur attitude démagogique avec le personnel leur vaudra de représenter la France aux Jeux Olympiques de Séoul.
1989
Pour fêter leur vingtième anniversaire ils plaquent un Solex en or, organisent le défilé du 14 Juillet sur les Champs Elysées, se souviennent des années 80 avant Libération et la 7 et constatent que le carré de la base de la liberté est égal à la somme des carrés de l’esclavage.
N’ayant pas été invitée, P.P ne participe pas aux Magiciens de la Terre.
1990
Ils tentent le drop du milieu du terrain : devenir un mythe.
La femme est l’avenir de l’homme
(air connu)

Et Louise Brooks l’une des plus belles
La grammaire n’est jamais inutile lorsque l’on examine la nature des genres et il est d’usage de dire le design et la décoration. Cette observation grammaticale n’est pas sans conséquence si l’on considère attentivement l’anatomie des deux sexes et plus particulièrement l’anatomie génitale. L’organe sexuel masculin est d’un aspect relativement design, plus ou moins fonctionnel (chacun d’entre nous peut le vérifier quotidiennement), assez proche finalement du robinet mélangeur de chez Zucchetti.
L’organe sexuel féminin est d’un aspect plus complexe, il est décoré. Des efflorescences charnues viennent se surajouter à sa fonction première. Si l’on pousse plus loin l’observation, on peut noter que son aspect formel ressort plutôt de l’esthétique baroque.
Il est à noter d’autre part que dans un certain nombre de civilisations sous le prétexte assez logique de supprimer en lui ce qu’il a de masculin s’effectue un geste radical de design qui a pour nom : grande infibulation pharaonique.
Celle-ci consiste (hormis quelques travaux de couture que nous passerons sous silence) en une ablation du clitoris et en une suppression la plus complète possible des grandes et des petites lèvres qui a pour conséquence immédiate (les conséquences secondaires étant une mortalité infantile importante et des complications obstétricales non négligeables qui ne sont pas le sujet) de rendre le sexe féminin lisse, purement fonctionnel, on pourrait presque dire : aérodynamique. Ces considérations qui pourraient sembler aussi accessoires que le psychédélisme des petites et des grandes lèvres ne sont pas sans prolongements si l’on pousse un peu plus loin le bouchon.
Sans trop insister sur ce qui pourrait sembler d’un manichéisme assez simplet, Ying/Yang (expression du « devenir sémantique » du design, dixit Philippe Starck in Catalogue des 3 Suisses !), on pourrait pointer le fait que le design est fondamentalement une pratique de réconciliation, d’aplanissement des contradictions. Et ce, même dans ses derniers avatars post-modernes où fonctions et formes ne sont plus que des programmes, où se joue une illusoire réconciliation des styles, où l’interchangeabilité en se réifiant devient un éclectisme réactionnaire, où se met en scène une ironie obligatoire face à une situation que l’on ne fait même plus semblant de maîtriser. Or, qu’est-ce qui résout plus évidemment les contradictions de l’espèce que la grande infibulation pharaonique. Quel acte design plus parfait ?
Mendini parle du nouvel homme décoratif qui : « semble avoir renoncé aux émotions vives de la chair », il semblerait que la chair, pour sa part, n’ait pas renoncé aux émotions vives.
De ce qui précède on pourrait déjà déduire que ce qui est en jeu, ici et maintenant, est la dénonciation (pourquoi pas ?) de ce qui dans le design nous est toujours apparu comme suspect (est-ce vraiment un hasard si le logo de Zanotta est la chaise Folia conçues dans les années 32 pour la Casa de Fascio de Côme ?) et l’appel à une alternative qui pourrait s’identifier au travail au ridicule apparent des femmes : dentelle, broderie, enfilage de perles, décoration.
Car il est un fait qui n’est pas contestable c’est que l’on « designe » de moins en moins d’objets mais de plus en plus de comportements et de situations les dispensant par là de l’usure, de la blessure et de la mort (substantifs féminins), les rendant par là même proprement intolérables.
Que ces dernières réflexions ne fassent pas oublier que ce qu’il y a de plus regrettable aux jours d’aujourd’hui c’est la question : que penser, qui veut dire : que regarder, qu’écouter, plus encore, que voir, qu’entendre soit devenue : sur quoi s’asseoir ?
Présence Panchounette
Juillet 1987
Bordeaux-Calais-Stuttgart
Ce texte a été publié à l’automne 1987 dans un numéro hors-série de la revue L’Atelier.
Ce n’est pas pour dire (je crois être, désormais, incapable d’écrire un texte de ce genre),
mais, vingt ans après, ça tient plutôt bien le coup.
Le bémol étant que l’on ne peut pas dire que ça ait empêché grand chose d’advenir.
La satisfaction d’avoir eu raison (trop tôt), comme toutes les satisfactions,
est juste le symptôme de la fatuité qui a, souvent, aidé à être lucide.

mais Joséphine est mieux foutue !
Il y a-t-il un dialecticien dans le dispositif ?

Les ready-made appartiennent à tout le monde
Ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite ni égard, ni patience.
René Char
L‘artiste de type ancien portait des poils et du velours, aussi moderne qu’il essayait d’être, il avait rangé au fond de son atelier des Clark’s où séchait la boue de Woodstock.
Le soir, il invectivait Dieu dans d’effroyables crises d’éthylisme. Il ne se confrontait qu’aux grandes causes et s’y montrait plus âne que nature, c’était le signe de son intérêt pour le tellurique.
Il termine aujourd’hui sa carrière dans une école des beaux-arts de province où il enseigne la dyslexie à des psychotiques. S’il a réussi, il fait chaman dans les allées des foires d’art contemporain, sa future veuve marchant sur ses talons.
Son mode d’existence était celui, suranné, de la présence alors que l’artiste doit désormais pour exister faire la preuve de son inexistence, Baudrillard l’a dit et Lipovetski aussi.
Entendons-nous, rien ce n’est pas le néant, c’est moins que ça, il ne s’agit pas de : « l’absence, exploit divin » de Jabès, mais du rien de Roux et Séguela ; cela fait longtemps que l’on a abandonné la métaphysique pour sillonner vaillamment les autostrades du goût.
Malgré cette difficulté, qui n’en est une que pour ceux qui ne seraient pas frappés d’une idiotie congénitale, le nouvel artiste a une supériorité flagrante sur l’artiste de type ancien : il est toujours bon.
Il en existe, bien sûr, d’encore plus mauvais que d’autres, mais, in fine, ils n’en sont pas moins tous bons. Les conditions de reconnaissance actuelle le veulent ainsi, le discours critique devenu aphasique puisque tout discours dit oui à ce qui est sous prétexte que cela est, l’accueil public atone puisque entièrement soumis à l’économie de marché ne leur offrent ni résistance ni résidence, les obligent à être les meilleurs un quart d’heure à tour de rôle sans que cela puisse finir.
Le dernier en date à tenir ce rôle aura été Philippe Thomas, le jeudi 11 août 1988, dans le quotidien Libération. Constatant que « les ready-made appartenaient à tout le monde » (s’il avait analysé plus avant la nature des rapports sociaux, il aurait pu en déduire que la bêtise est la chose du monde la mieux partagée), il s’adressait, lui qui n’est presque rien, à vous tous qui n’êtes pas grand-chose pour que votre soutien l’autorise à être médiatiquement rien. Et il a réussi.
Dans leur domaine, Philippe Thomas, IFP et consorts sont ce que Valérie Subra est au crime ou l’informatique à l’intelligence, l’épiphanie de la soumission absolue.
Les Nostalgiques du sens
Il est plus facile de prévoir ce que sera l’art dans dix ans que s’il pleuvra demain

Ce seraient des signes, mais ils ne seraient signe de rien
Les « conceptuels » ont toujours essayé de réduire la forme à sa plus simple expression, ce qui nous a valu ces étonnantes variations autour de l’absence extrêmement prégnantes, omniprésentes même à une certaine époque. Pour ce qui est du fond, ils le souhaitaient simplement le plus inaccessible possible au vulgum pecus, ce qui est de bonne guerre.
Le lecteur sera sensible, nous l’espérons, au didactisme de bon ton de cette entrée en matière, il ne faut pas perdre de vue que l’art conceptuel s’adresse essentiellement à des gens de bonne volonté, mais un peu lents.
Le problème auquel se trouve confronté l’art conceptuel semble être celui de l’objet ou plutôt de son impossible disparition. Son but n’est pas tant de dire que de passer sous silence, dans son ensemble, il aspire, sans que cela soit péjoratif, au vide.
Seulement, aussi évanescentes soient-elles, les réalisations restent des réalisations, des incarnations même ténues et comme telles plutôt dégoûtantes nous rappelant à l’ordre de nos corps et de ses salissures, nous promettant le désespoir, la mort et son cortège de puanteurs.
Ainsi le choix de la maison Picard Surgelés pour essayer d’atteindre enfin à l’immatérialité (cette fois, promis, il n’y aura RIEN, pas même une inscription au Letraset sur le mur) nous semble parfaitement judicieux.
Est-il utile de rappeler qu’en raison même des risques de corruption inhérents à la chose, la surgélation opère une asepsie scrupuleuse, que la matière surgelée est suspendue dans son évolution, déjà, mais pas encore cadavre, dans l’état indéfinissable qui caractérise, par ailleurs, le sexe des anges.
Nous aurons, quant à nous, un seul regret au sujet de cette si radicale réalisation : que la ménagère venant y acheter sa barquette de colin aux brocolis en soit privée de par son ignorance, ce qui laisse supposer que, pour que la proposition devienne effective, il faut le SAVOIR et celui-ci, hélas ! n’est pas moins encombrant qu’une trace sur le mur.
Les Cons gelés
Ces deux textes ont été publiés, pour la première fois, en septembre 1988, dans Supplément culturel d’un journal qui n’existe pas, une feuille double sur mauvais papier qui était éditée (très irrégulièrement) par la Galerie de Paris.
Le premier fait allusion à l’insertion par Philippe Thomas (plus sûrement par sa galerie) d’une page à sa gloire (qui sera éphémère) dans Libération, le deuxième à une exposition qui avait lieu au 48, rue des Francs-Bourgeois, dans un magasin Picard Surgelés, dont le propriétaire, à l’époque, était amateur d’art contemporain et client de Ghislain Mollet-Viéville.
Vas-y Jean-Louis, nous sommes tous derrière toi !

A Venise, les maçons mettent la dernière main
au pavillon français
Il circule depuis quelques temps déjà dans le milieu autorisé, une lettre visant à protester contre les choix opérés par Jean-Louis Froment pour représenter la France à la Biennale de Venise. Quoique notre rétrospective au CapcMusée de Bordeaux ne soit pas prévue avant l’automne 1998, nous tenons à élever une protestation solennelle aussi bien contre le fond que la forme de cette pétition.
Ce texte vise principalement à protester contre le fait que ce sont des « architectes » qui représenteront notre pays lors de cette manifestation visant à confronter divers nationalismes culturels et non des « artistes ». Etant donné l’état de l’art et des artistes, nous ne voyons pas, pour notre part, d’objection à être représentés par des architectes, des cuisiniers ou des coiffeurs, pour la simple raison qu’on ne peut en trouver aucune.
La décision de Jean-Louis Froment de raser le pavillon français n’est pas dénuée de tout sens pratique dans la mesure où celui-ci avait été considérablement endommagé par l’intervention du décorateur d’intérieur ayant représenté notre pays à la Biennale sans que d’ailleurs ceux qui soutiennent aujourd’hui les artistes en carte aient vraiment réagi.
Ce texte se présente surtout comme fondé sur une aporie : totalement soumis à un ordre des plus désuets, il le conteste dans un même temps. les décisions de l’arbitre sont toujours souveraines si l’on accepte de jouer au sifflet, ce ne sont ni le Kop, ni Thierry Rolland qui décident que tel ou tel but a été marqué de la main.
Avoir nommé Jean-Louis Froment à ce poste était une décision fort pertinente de la part de la Fédération Française d’Art Contemporain lorsque l’on connaît ses qualités d’animateur culturel (n’a t-il pas découvert Viallat avant Katia Feijoo, Pifaretti avant Jean-Christophe Aguas et Julian Schnabel avant Ringo Starr ?) jointes à des qualités humaines exceptionnelles qui font du lieu qu’il gère un exemple qui nous est envié en dehors même des limites de la Communauté urbaine.
On ne peut, dans ces conditions, lui retirer la confiance et le respect que méritent l’audace de sa démarche, d’autant plus que le style de la pétition manifestant l’opposition à son propos est tout à fait adapté à ce qui fait le fond du débat. Il hésite entre l’analphabétisme et le poujadisme de circonstance avec un abus d’adjectifs qualificatifs du genre : « national », « fallacieux », « malsain », « grotesque » dont les auteurs ne semblent pas réellement mesurer la portée politique tout à fait de mise aujourd’hui. Il ne manque plus à cet étrange libelle qu’une fine allusion au nom pas très catholique de l’un des architectes pour figurer dans une anthologie de la littérature de propagande.
Dans ces conditions et bien que légèrement souffrants, il nous semble de notre devoir d’appeler les forces de progrès soudées coude à coude à s’opposer ensemble à cet intolérable atteinte au droit et à la démocratie et de manifester leur indéfectible soutien à celui qui apparaît comme l’innocente victime d’une manipulation savamment orchestrée.
Que vivent Jean-Louis, la France et l’Ordre des médecins !
Les derniers des Justes
P.-S. : N’ayant pas été invitée Présence Panchounette n’aura pas l’occasion de refuser de représenter la France à la Biennale de Venise.
Tract dont il ne sera pas inutile de se souvenir ultérieurement.
Le Te deum de Jean Sébastein Bach

Tous les Kennedy sont mortels
Marcel Mariën
La critique est aisée, mais l’art est très facile
Louis Scutenaire
Présence Panchounette est toujours heureuse de se voir citée en douce, cela nous fait particulièrement plaisir de l’être dans Art Press (dernier numéro en noir et blanc) tant il est vrai qu’au souvenir de sa directrice nous confiant que cela en fait quatre (ans) qu’elle veut faire quelque chose sur nous, notre cœur fond.
Nous voir cités, ne serait-ce qu’anecdotiquement, lors d’une « analyse rigoureuse et non dénuée d’humour » du travail des « simulationnistes » nous a ravi au delà même de tout ce que l’on peut imaginer. Nous aurions donc, soi-disant, quelque chose à voir sinon à régler avec cette nouvelle coqueluche des Curators & Dealers.
« We are goin’ to work ! » comme dit Tina Turner.
Nous faire voisiner, ne serait-ce qu’éditorialement, avec un artiste aussi considérable qu’Haim Steinbach, c’est oublier que, jusqu’à plus ample informé, Steinbach ça vaut 60 000 $ et Présence Panchounette des clopinettes.
Le problème se situe là et peut y trouver son terme : l’artiste qui vaut 60 000 $ est forcément meilleur que celui qui en vaut 50 000 et ainsi de suite jusqu’aux refusés du Salon de Montrouge. On peut y voir la différence entre un fils de notaire français et l’époux suisse de la correspondante de Vogue, rien que de très logique. Si nous ne sommes, pour notre part, pas loin de considérer que Présence Panchounette c’ets plus dialectique, sinon meilleur que Steinbach, force nous est de constater que c’est bien moins bon aux critères dominants.
Vouloir opposer le Simulationnisme au Pop au nom d’une soi-disant « conscience politique » du Pop est une erreur dans la mesure où les pop-artistes les plus radicaux ont toujours voulu en être totalement dépourvus. Souvenons-nous de la déclaration d’Andy Warhol : « Je veux être une machine »… l’indifférenciation Allan Mc Collum, par exemple, en est une réalisation plus ou moins achevée.
Le Pop ne s’est jamais voulu commentaire, mais constat, s’il a échoué, ce n’est pas à porter à son crédit, mais à celui de ceux qui y arrivent. Si Koons réussit là où Warhol a échoué on ne peut lui reprocher (chromer est plus radical que sérigraphier). Rapprocher, serait-il en l’opposant, le Simulationnisme du Pop procède, par ailleurs, d’un certain aveuglement de proximité. Il nous semble, pour notre part, plus proche de l’hyperréalisme, moins dans ses réalisations (quoique !) que dans ses intentions aussi « réactionnaire » et « impérialiste » (Ridgway Go Home !) à nos yeux.
Car, bien évidemment, plus qu’une critique de la consommation et de la marchandise, le Simulationnisme en est leur glorification. Ils sont par là assez proches des grands peintres religieux… l’effet seul compte.
Si Warhol ou Rauschenberg ont été surévalués par rapport à, par exemple, Peter Saül ou Edward Kienholz, c’est qu’ils servaient les intérêts américains et les médiatisaient au mieux, Koons et Steinbach ne font pas autre chose.
Pour enfoncer le clou plus avant dans le genre nostalgique, du temps où le Monde avait un sens obligatoire (« Paix au Vietnam ! »), on pourrait noter que, dans les objets exposés par Koons et Steinbach, il n’y a nulle trace de souffrance (ce qui réalise, entre parenthèses, l’un des désirs inavoués de l’art conceptuel), cela est particulièrement sensible dans le travail de Jeff Koons, paradoxe remarquable lorsque l’on connait l’espérance de vie d’un ouvrier travaillant dans l’électrolyse.
Si les Simulationnistes sont contemporains de l’hégémonie réalisée de la marchandise comme les dealers sont, comme le dit si bien Arielle Pelenc, « maîtres des significations », à qui la faute sinon aux artistes et aux critiques qui ont abandonné la critique négative pour Rank Xeroxiser le discours des attachées de presse et adopté une position avouée de collaboration de classe ?
Il faut, en définitive, se demander si les critiques adressées à Koons, Steinbach et C° peut se justifier dans la mesure où les procédures qui rendaient ces critiques recevables se sont désintégrées.
L’incompréhension radicale de Baudrillard dont ils se réclament, pour la plupart, est la réalisation complète de Baudrillard et du Baudrillardisme.
Prendre au sérieux leurs affirmations, c’est passer à côté de la fonction indépassable de leur travail : sa profonde stupidité, vouloir ensuite la critiquer au nom de l’intelligence est un contresens manifeste (ainsi d’ailleurs que traduire « hermaphrodite » par « sexuellement neutre »). Les Européens « font » les imbéciles, les Américains le sont, là réside leur supériorité essentielle.
Si la « non relation au monde et à l’autre » est devenue « le véritable sujet de l’art d’aujourd’hui » quoi de plus réussi que cette épiphanie de la marchandise. La consommation aurait-elle d’autres caractéristiques que l’autisme et l’inertie ?
Tout irait donc pour le mieux dans le meilleur des mondes si, perpendiculairement à la yuppisation du monde, ne survenait une généralisation du quart-monde. L’affrontement des goûts et des intérêts n’est pas moins violent qu’il y a une dizaine d’années même s’il se joue sur le mode de l’implosion. D’où l’intérêt pour l’idéologie dominante lorsque la catastrophe est le seul mode prévisible de changement, de faire croire à sa maîtrise absolue.
Ce texte a été publié dans le Supplément d’un journal qui n’existe pas, daté du 9 décembre 1988, il était la reproduction d’un texte intitulé donc « Le Te Deum de Jean-Sebastein Bach » (« L’Univers appartient à tout le monde et la terre à ceux qui la cultivent. » /
« Si tu m’Haim prends garde à toi »), verso d’une affiche/tract/invitation publiée à l’occasion d’une exposition du Capp
(Club des amis de Présence Panchounette) qui a eu lieu du 9 au 24 décembre 1988 à Bordeaux en même temps qu’une exposition d’Haim Steinbach au Capc.
Aujourd’hui où n’importe quel artiste se damnerait pour exposer chez Louis Vuitton ou pour être acheté par François Pinault, il réussit l’exploit d’être toujours d’actualité et quasiment incompréhensible (« position avouée de collaboration de classe » ? ? ?)
ÉTUDE POUR LA RÉALISATION D’UNE
COMMANDE PUBLIQUE
CAPBRETON

Petite introduction en guise de déclaration d’intention

« De la décoration du Palais Royal, nous vous dirons, dans un premier temps que l’honneur aurait été de ne pas la mériter et dans un second temps… qu’il fallait faire gaffe ! » Présence Panchounette. Mai 1986.
Il faut croire que nous n’avons été guère plus attentifs que Daniel Buren ou que l’Histoire nous a rattrapés. Notre situation lorsque nous est échue la commande publique de Capbreton s’apparentait fort à celle de l’arroseur arrosé. Nous étions désormais pris dans une alternative impossible : refuser, c’était pour sauvegarder un soi-disant radicalisme ne pas le confronter à l’épreuve de la réalité, accepter, y perdre son âme pour peu que nous accouchions comme nos collègues d’une quelconque « statue équestre ».
Pourquoi oui ?
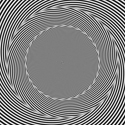
Nous avons finalement accepté de travailler sur ce projet,
* car il est, peut-être, moins significatif de le faire que d’avoir été choisi pour cela
* nous avons toujours pensé qu’il y avait une certaine faiblesse de l’art contemporain face au social.
Sachant, d’autre part, que nos préoccupations sont plus proches du « culturel » que de « l’artistique » nous avons choisi de relever ce que nous considérions au départ comme un défi.
L’intelligence avec laquelle nous répondrons à cette proposition sera l’une des réponses possibles à notre mode d’existence. Il s’agit désormais de montrer que s’il n’y a pas forcément de solution à chaque problème, il y a toujours la possibilité de poser clairement les questions.
État constaté de la commande publique
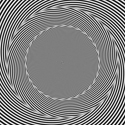
Malgré les dénégations plus ou moins appuyées dont elle fait l’objet et de par les contrainte qui la fondent la commande publique s’assimile peu ou prou à la statue équestre.
Les exigences municipales et patrimoniales jointes accouchent, en règle générale, d’un style d’œuvres pas si éloigné que le prestige des artistes choisis ne le laisserait supposer du 1 % de sinistre mémoire.
Tout cela véhicule une certaine idée de la sculpture vue comme pratique lourde, monumentale, de préférence verticale située, autant que faire se peut, au centre d’un endroit symbolique.
Les artistes se coulant d’ailleurs assez facilement dans ce moule, en rajoutant parfois dans le sens académico-machiste ; faisant assez souvent office de poseurs de réponses.
Résistances locales
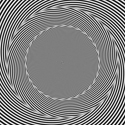
Les réactions d’hostilité de la population à la commande publique qui vont de la pétition au vandalisme peuvent être vues comme des attitudes iconoclastes, pour notre part nous y voyons une résistance pas si réactionnaire que cela à ce qui lui est imposé.
Peut être, qu’en fait, la symbolique qui lui est proposé ne lui convient pas/plus (n’est pas/plus convenable) pour la simple raison qu’elle la met dans une position qu’elle refuse, lui renvoie une image qu’elle n’accepte pas. Celle de sujet.
La commande publique de type phallique, marque du pouvoir dans la ville, est une atteinte à la condition de promeneur, elle ne veut ni le ravir ni le séduire mais l’impressionner et le soumettre.
Prendre le problème à l’envers
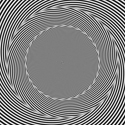
Répondre « professionnellement » à n’importe quelle sollicitation semble être la facilité à laquelle se laissent aller, à ces occasions, les auteurs.
La commande publique a un style pour x et x raisons, proposons une commande publique « style commande publique », sans trop déchoir on peut ainsi payer la première traite de sa maison de campagne.
Si l’on part du principe que la sculpture de rond-point est de type phallique, il ne reste plus suivant le vieux principe dialectique, qu’à l’inverser pour aboutir à un projet de type féminin. Qu’opposer au menhir, sinon le puits ?
Et si l’on prend acte que la sculpture de rond-point est de type patrimonial, comment ne pas répondre à sa durée inerte sinon par le jeu de la fiction ?
« Le premier mouvement, les enfants y excellent, est de tourner l’objet à l’envers ». Joseph Delteil.
L’œuvre se devait d’être féminine et proposer une image fictive.
Le paysage
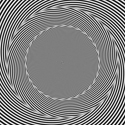
Aussitôt que nous a été confirmé par Jean-Louis Connan que la commande publique de Capbreton nous avait été confiée nous nous sommes rendus sur place pour étudier le site et les possibilités d’implantation.
C’est peut-être en découvrant celui-ci que notre motivation de répondre au défi s’est affirmée le plus énergiquement. Paradoxalement, certes, car le paysage en automne a de quoi désespérer. En guise de rond-point nous avions hérité d’un non-lieu. Un môle désolé, objet de promenades désœuvrées, flanqué d’une capitainerie d’un modernisme abscons et bordé sur l’autre rive de constructions de vacances du style Ribourel le plus inepte.
Ce qui, à la rigueur, pourrait sauver le lieu, plus que l’eau qui coule et les bateaux, ce sont les étals où les pêcheurs vendent leurs poissons.
Nous avons acheté une daurade.
L’alternative impossible
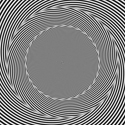
La solution la plus simple que nous avons adoptée à ce moment là de notre réflexion pour sauvegarder notre intégrité a été de placer l’Institution dans la même situation de « double bind » où elle nous avait, elle même, placés.
Nous avons élaboré deux projets : le premier, une sorte d’archétype de Présence Panchounette allant jusqu’à la caricature : un nain géant chevauchant un dauphin fontaine en matière plastique ; décalquant jusqu’à l’absurde les contraintes décriées plus haut. Le second, le seul pour nous envisageable, flirte, pour sa part, à l’impossible pour des raisons économiques, puisque ses contraintes budgétaires sont sans commune mesure avec le budget prévu.
Il s’agit de savoir si l’Institution saura faire preuve de suffisamment de souplesse et d’opportunisme pour l’accepter. Il faut être deux équipes, soi-disant, pour faire un beau match.
Description du projet
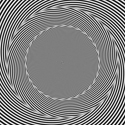
Imaginons le globe terrestre, imaginons qu’à Capbreton il se puisse percer un trou qui le traverse et que l’on se penche au bord de ce trou. Que voit-on ? Dans la « réalité », rien. Dans l’absolu, le ciel des antipodes.
Pour rendre cet absolu possible il suffit de projeter l’image du ciel filmé en Nouvelle Zélande relayée par satellite.
Étant donnés les différents décalages et les météorologies respectives des deux pays on pourra voir le jour, la nuit, la nuit, le jour, des nuages quasiment identiques et des constellations invisibles sous nos cieux.
Le dispositif nécessite une caméra en Nouvelle Zélande, un ou plusieurs écrans à fleur de sol à Capbreton et la location d’un canal satellite. Moyennant quoi l’impossible est à vos pieds.
Budget
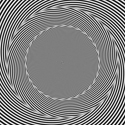
Si l’on tient pour négligeables les différents accessoires nécessaires à l’installation, il faut se préoccuper de la location du canal satellite.
À titre d’exemple France Télécom avance pour un circuit permanent (vidéo + audio) une redevance annuelle de 42 000 000 de francs à laquelle vient s’ajouter le prix de la retransmission. T.D.F. avance, pour sa part, le chiffre de 139 349 882, 50 francs par an pour une liaison de dix heures par jour.
Il est évident que de tels coûts sont sans commune mesure avec le budget d’une commande publique, serait-elle située ailleurs qu’à Capbreton (Landes). Reste, vue la mégalomanie du projet et son exploitation probable à y intéresser les sociétés et les États. Ne plus traiter en termes économiques, mais en terme de prestige pur.
Un troisième projet
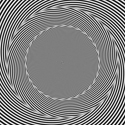
Lorsque nous avons fait part à Béatrice Salmon de l’alternative dans laquelle nous désirions placer l’Institution elle nous interrogea sur la possibilité d’une troisième solution, celle-ci devant, bien entendu, être médiane.
Au cours de la même conversation il fut question de la statue de la Vierge de Capbreton. Il se trouve que nous l’avions aperçue lors de nos repérages et qu’elle nous était apparue comme l’un des objets à partir desquels il était possible de travailler.
Le troisième projet consiste en : reconstruire sur le môle et à l’identique le socle en rochers de cette Vierge, quant à celle-ci elle serait reproduite par un hologramme.
Un hologramme ne fonctionnant, à notre connaissance, que suivant certaines conditions de lumière, l’image virtuelle de la Vierge ne serait « réellement » qu’une apparition.
Plus directement critique, ce projet, bien que cher est économiquement de l’ordre de l’envisageable.
Entretien municipal
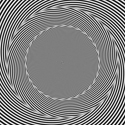
Nous avons eu un entretien avec le Maire de Capbreton le 22 novembre. Au cours de celui-ci, nous avons exposé clairement les deux projets que nous avions retenu, à savoir : le projet antipode et le projet hologramme.
En fait, il ne fut pratiquement question que du premier, le second ne lui convenant pas pour des raisons qu’il n’est pas de notre ressort d’éclaircir.
Le Maire a soulevé les objections que l’on pouvait attendre de sa part :
* le coût
* la permanence
* la forme
Ses objections pertinentes sur la forme donnée au projet nous ont amené à revoir celle-ci et à passer d’une conception avant-gardiste : le puits à une forme plus lisible par le public : le cadran, la constellation.
Au cours de cet entretien le Maire nous a appris l’un des hasards objectifs qui peuvent confirmer la pertinence de la localisation du projet : l’existence face à Capbreton de la fosse sous-marine la plus profonde d’Europe.
Sans marquer d’enthousiasme le Maire a fait preuve d’un intérêt marqué pour le projet.
La fosse, la faille, le trou
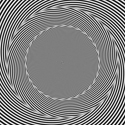
On peut donc imaginer que la fosse la plus profonde d’Europe se prolonge par une faille pour finalement aboutir à ce trou fictif qui traverse l’Océan, la croûte terrestre, la lave en fusion, les fonds marins et l’Océan de nouveau pour donner sur le ciel de l’autre côté.
Ce que la nature a esquissé la fiction le réalise. Aux pieds des uns, le ciel des autres.
Poésie, technologie et communication
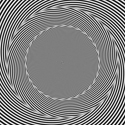
Le projet met en scène le véhicule le plus simple de la poésie : le ciel. Il rend visible ce qui l’est moins : le ciel de l’autre. Il s’agit à la fois de voir à travers et de regarder ailleurs.
Cette rêverie n’est accessible qu’au travers de la technologie la plus sophistiquée mise au service cette fois, non pas d’un grand événement médiatique mais de l’acte le plus banal et le plus commun, regarder le ciel pour y voir briller les étoiles et défiler les nuages.
Si rien n’empêche sa récupération par l’idéologie du moment qui nous est la plus suspecte, à savoir celle de la communication, le projet n’impose pas pour autant la communication, mais rend commun aux passants qui passent un geste inusité et modeste, baisser la tête et regarder le ciel à leurs pieds.
Les images décevantes
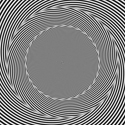
Si l’on fait abstraction de l’idée et que l’on examine le résultat avec quelque froideur on ne peut que constater qu’en l’occurrence cette débauche monétaire et technologique n’aboutira qu’à des images décevantes.
Qu’est ce qui restera visible ? Un écran bleu parfois traversé par des nuages, un écran noir marqué d’étoiles, pratiquement le même, mais pas à la même heure, que celui que l’on peut voir en grand, en vrai, au dessus de nos têtes.
Il nous plaît assez, pour notre part, de voir une telle montagne accoucher d’une telle souris.
Cette satisfaction kunique mise à part les images sont-elles aussi décevantes ? Existe-t-il même des images décevantes ? Une image seule n’existe pas et, à l’occasion, le Pouvoir peut nous faire passer une image décevante pour une image merveilleuse.
D’autre part sont-elles si décevantes ? Le support de la rêverie ne se satisfait-il pas de l’anodine crevasse au plafond, d’un coin de ciel, d’une chaise renversée qui fait un cheval ?
À la débauche médiatique spectaculaire ne faut-il pas substituer le support de la banalité infra-ordinaire ?
Réconcilier les contraires
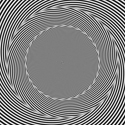
Il peut sembler que réaliser ce projet – pourquoi ne pas le baptiser Rainbow ? pourquoi ne pas le réaliser dans les deux sens ? – ne manque pas d’un certain piquant étant données les relations politiques qui ont été celles de la France et de la Nouvelle Zélande dans un passé proche.
Il n’est pas de notre fait de faire valoir la communication comme vecteur de réconciliation, mais les instances politiques sauront certainement le faire et parler de Bluepeace.
Il n’est pas inutile de rappeler que, hasard objectif supplémentaire, 1990 sera le 150° anniversaire de la Nouvelle Zélande.
Question de durée, question de coût
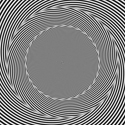
Le problème de la réalisation de ce projet ne semble pas tant sa faisabilité que son coût et sa durée. Il pose ainsi par l’absurde deux questions à la manière dont est conçue la commande publique et dont les réponses déterminent plus qu’il ne le semble, leur style.
* l’œuvre doit être permanente ou y tendre
* l’œuvre doit coûter un prix raisonnable
Il semble facile de nous objecter qu’étant donné le prix de la nôtre, nous n’interrogeons rien du tout. Nous répondrons à cela qu’imaginer le socle de Manzoni nous aurait suffi et que son coût aurait été de loin inférieur à la plus modeste commande publique réalisée à ce jour.
Pourquoi d’autre part envisager toujours les œuvres comme permanentes et stables alors qu’elles pourraient être mortelles et nomades ?
S’il y a une opposition à la réalisation de ce projet ce n’est pas réellement une opposition à son coût mais à sa monstruosité.
Jusqu’où la fiction peut-elle être simulée ?
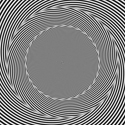
Si l’on considère le coût du projet et la réalité même des images il est tentant d’adopter la simulation pure, pour ne pas dire l’escroquerie artistique. Exemple : tourner en Nouvelle Zélande vingt-quatre heures de ciel et passer la bande en boucle sur l’écran français en respectant vaguement le décalage. On peut aussi, d’ailleurs, adopter quantité d’attitudes intermédiaires et meilleur marché, mais toutes ces solutions ont le défaut de :
* court-circuiter le système de transmission qui fait partie intégrante du processus
* supprimer la réalité qui, en l’occurrence, est le nœud de la fiction.
Cependant et comme il est toujours possible d’obtenir des accommodements avec le ciel, nous pourrions admettre, sans crier au scandale, que l’enregistrement de la première année soit diffusé l’année suivante et ce tant que faire se peut ; que la liaison ne soit pas permanente mais saisonnière ou intermittente, mais toujours respectueuse de l’écart majuscule, la réalité, du décalage minuscule, la transmission.

Ce qui est amusant de constater à propos de ce projet (qui, bien entendu n’a pas été réalisé),
c’est qu’il est, aujourd’hui, réalisable avec trois francs-six sous,
qu’il faudrait donc, pour mettre en échec la puissance publique, trouver autre chose.
L’avant-garde a bientôt cent ans

Trompette sous un crabe
(Musée de l’objet, Blois)
Il faut oublier les œuvres réussies, mais pas les manquées.
Bertold Brecht
Ecrire un roman sans matière, voilà qui est bien, mais à quoi bon en écrire dix ou vingt
E.M. Cioran
Du 7 octobre au 5 décembre 1988 avait lieu à Lyon une exposition intitulée : « La Couleur Seule, l’Expérience du Monochrome ». Le catalogue de cette exposition compte trois cent soixante-six pages grand format, il n’y est question qu’une seule fois des monochroïdes d’Alphonse Allais d’une façon assez peu précise, alors même que le reste des textes affecte une exactitude scientifique un peu compassée. L’exposition ne compte pas moins de deux cent soixante-trois œuvres allant du beige au tête de nègre en passant par toute la gamme des gris dont aucune d’Alphonse Allais (et pour cause).
Pour une opération qui se voulait être par son ampleur une sorte de somme sur le monochrome ce sont des imprécisions et des oublis fâcheux.
S’il n’avait été fait aucunement mention des monochroïdes dans ce si docte ouvrage on aurait pu conclure à l’ignorance absolue qui est toujours excusable, or il en est question, ce qui encourage le soupçon. A partir de cette constatation on peut avancer plusieurs arguments pour qu’il en soit seulement question dans les quelques lignes embarrassées de Monsieur Maurice Besset
* Les monochroïdes d’Alphonse Allais n’appartiennent pas à l’Histoire de l’Art.
Il reste à savoir pourquoi et quelles conclusions on peut tirer de cette exclusion ? Le moins que l’on puisse dire c’est qu’elles ne sont pas à l’avantage des censeurs.
* Les monochroïdes d’Alphonse Allais n’appartiennent pas à l’Histoire de l’Art car ils n’ont pas été « assumés » par Alphonse Allais lui-même comme en faisant partie.
C’est la raison que donnera Yves Klein lorsqu’on lui fera remarquer que ses fameux monochromes et les monochroïdes c’est bonnet blanc et blanc bonnet (si proches qu’ils peuvent se rabattre les uns sur les autres), que le catalogue de sa première exposition emprunte le même fomat que « L’Album Primo-Avrilesque » du même Alphonse Allais (on auarait pu, par la même occasion, lui faire remarquer que sa « Symphonie monoton » devait beaucoup à la « Marche funèbre » du toujours même Alphonse Allais…).
Là encore, il s’agit davantage d’une manière un peu spécieuse d’envisager l’Histoire de l’Art et même l’Histoire tout court. Les goujats seuls ayant droit au Mallet-Isaac.
* L’objection la plus fondée est celle consistant à remarquer qu’exposer un rectangle de bristol noir et l’intituler : « Combat de nègres dans une cave, pendant la nuit » ça n’est en aucun cas subvertir quoi que ce soit mais simplement rendre adéquat la représentation de la réalité à celle-ci.
Il n’est nullement de notre intention de vouloir mettre sur le même plan Malevitch, Rodchenko et Alphonse Allais. Il est assez évident qu’ils ne sont pas du même acabit pour que nous n’ayons pas, nous aussi, besoin de revenir là-dessus; pour ce qui est d’un certain nombre de peintres pratiquant le monochrome figurant dans « La Couleur Seule » on peut émetre quelques doutes. Et, comme d’autre part, leurs facéties ont lieu un siècle plus tard, on peut se permettre de trouver à la plaisanterie un goût de réchauffé.
Si beaucoup de monochromes s’intitulent prudemment : « sans titre » (tu ne nommeras pas le nom de Dieu, nom de Dieu !), d’autres n’hésitent pas à s’intituler : « Vitraux », « Le noir des noirs », « Mother of night », « La vague », « C’est le ciel, c’est un lac, c’est la mer… », « Red Cells With Conduits » ce qui les place rigoureusement sur le même registre tautologico-évocateur que : « Récolte de la tomate par des cardinaux apoplectiques au bord de la Mer Rouge », la fine rigolade exceptée.
Tout cela nous amène à adopter une attitude légèrement ironique envers ceux pour qui le monochrome et une rente ; nous exclurons de l’anathème ceux pour qui il est une religions en leur faisant juste noter que la rapidité avec laquelle les icônes de leur mystique sont devenues de purs archétypes décoratifs rendraient à plus d’un leur messies suspects.
Le rire et la dérision sont particulièrement mal vus par les adorateurs de la couleur pure (secte assez répandue dans la vallée du Rhône à la fin du XX° siècle), si l’on considère pourtant avec un tant soit peu d’objectivité mettons, Perrodin à l’ombre de Malevitch et d’Allais il y a de quoi se les battre ou se les mordre suivant son degré de souplesse ou de violence dialectiques. Rien, pour nous, n’empêchant le sublime et le rire d’interférer le lecteur comprendra que notre objectivité se teinte à l’occasion d’une certaine dose de mauvaise foi.
Nous épargnerons un chouïa ceux qui, quoique membres de la secte, réinjectent ou essaient de le faire, l’ironie et la légéreté dans ces contrées arides. Morellet, par exemple, et ses monochromes pornos ou bien Peter Halley dont les « Cell with conduits » nous font fortement penser aux bouts de papier que nous nous refilions en cours de catéchisme qui se présentaient comme des énigmes dont les réponses étaient du genre : « Mexicain faisant la sieste derrière un mur » ou bien « Bateau arrivant trop tard pour sauver une sorcière de la noyade ». Cela aussi nous faisait rire. Nous étions dès l’enfance, bon public.
Entendons-nous bien, il ne s’agit pas de déclarer: « Tout ça c’est des conneries, s’ils peignent des tableaux en vert, c’est qu’ils ne savent pas dessiner un cheval ! ». Pour qui sait dessiner une cheval Madame Figaro, Monsieur Jean Clair cela ne présente pas plus de difficulté que pour d’autres peindre une toile en vert… Nous disons juste : « Faut pas nous faire prendre des vessies pour des lanternes, nous appelons un chat, un chat et Perrodin un coquin ».
Car c’est la difficulté que nos braves contempteurs de la modernité esquivent, il ne s’agit pas de coller un carré beige et un carré violine côte à côte et de dire : « c’est du monochrome ! », un daltonien peut le faire mais de montrer que l’un est sublime et l’autre minable, de le prouver même.
Le propos peut s’étendre à d’autres secteurs et nous occupons une place assez privilégiée à cet égard pour l’ouvrir un tantinet.
Il nous a été couramment reproché :
* de pasticher sans retenue les œuvres d’autres artistes ;
* et paradoxalement de manifester de l’humeur lorsque certains nous auraient, soi-disant, emprunté un vague gadget.
Il existait, il y a quelques dizaines d’années, une émission radiophonique dominicale intitulée : « Marions-les ». Nous croyons nous souvenir qu’elle était du fait de Francis Blanche. Son but était de noter les emprunts musicaux du genre que l’affaire Lambada a porté récemment sur le devant de la scène.
Il est dommage qu’une telle initiative (si l’on excepte quelques tentatives de Ben dans son bulletin périodique) ne voie pas le jour dans les arts plastiques, elle ne manquerait ni de matière, ni de sel. Il faut avouer que la bonne foi est plus aisément plaidable pour les Beaux Arts dans la mesure où il existe une certaine infériorité arithmétique des « procédés modernistes » sur les combinaisons possibles des notes musicales.
Pour prendre un exemple assez flagrant, Bertrand Lavier est un de ces artistes-coucous (coucou l’ersatz !) qui avec un talent certain ont su emprunter à certains de leurs contemporains tel moment de leur démarche pour la rendre digestible et immédiatement monnayable. Par charité, nous éviterons de parler de son épouse.
Nous ne voyons pas, pour notre part, de différence flagrante entre certains assemblages de Sanejouand et ceux de notre phénix bourguignon, entre « Duco et Ripolin » d’une part et « Rosso Gilera et Rosso Guzzi » d’Alighero & Boetti, entre la peinture des Martin et tel poème d’André Breton recensant les Breton de l’annuaire téléphonique.
Pour ce qui est de Présence Panchounette soi-même, nous avons été particulièrement soignés :
* repeindre un drapeau américain à ses couleurs (pas fondamentalement différent de repeindre n’importe quel objet mais de façon visible), Mai 1980 – Fin 1980.
* Juxtaposer deux papiers peints de même pattern mais de couleur différente (l’artiste français le plus intelligent doutant de l’intelligence du regardeur, ajoutera un cadre pour que le geste ne puisse passer inaperçu), 1977 – 1983.
* Echanger le contenu de deux galeries de genre différent (le petit-fils de Duchamp échangera les chaises de deux appartements de genre différent mais prenant en compte l’étonnement de Jacques Soulillou à ce sujet rajoutera un bocal de poissons rouges pour que ça puisse se discuter), 1978 – 1984.
Etc., etc., etc.
Pour ne pas avoir l’air de nous acharner nous confierons au lecteur que rien que la semaine dernière en feuilletant un vieux catalogue nous nous sommes aperçus que le travail actuel de Joseph Kosuth (le papier peint conceptuel dont nous avions dans un texte de 1976 prévu l’apparition) présente d’étranges similitudes avec : « The Image and appearance of the Human Body By Schilder » de Ian Murray (1974). Comme nous nous excluons pas non plus du lot, en lisant « La Couleur Seule » nous nous sommes rendus compte que Manzoni avait saupoudré certaines de ses toiles de chlorure de cobalt à la fin des années 50, geste que nous avions innocemment reproduit pour obtenir vingt ans plus tard nos « Monochromes atmosphériques ».
Lorsque nous avons pastiché des œuvres d’artistes connus (particulièrement dans la série des « Remake-up ») il s’agissait de poser quelques interrogations modestes mais jusqu’ici sans réponse à la modernité, à la post-modernité et à la propriété et non pas de faire passer un sèche-bouteilles en plastique orange pour un ready-made de Duchamp.
Montrer par l’absurde le statut fragile ou susceptible de dégénérescence de l’œuvre d’art, ce geste là a toujours été effectué en pleine lumière ; s’il n’a pas fait s’interroger grand monde, il n’a trompé personne.
Car les quelques feuillets qui précédent sont bel et bien une critique explicite de ce que l’Histoire de l’Art devient aux mains des quelques gougnaffiers qui s’en occupent. Le travail de l’histoire c’est, bien sûr, d’affirmer que la bataille de Poitiers a bel et bien eu lieu avant la Révocation de l’Edit de Nantes mais aussi d’analyser ce que ces deux évènements ont eu comme significations.
Il ne s’agit donc pas simplement dans cette « affaire » des Incohérents où l’on voit une bande de joyeux rapins préfigurer quelques décennies à l’avance ce qui sera considéré comme les gestes fondateurs de l’art contemporain, de signaler aux ignorants que cela a bien eu lieu aux environs de 1880 mais que ça n’était pas obligatoirement la même chose, qu’il existe plusieurs histoires (celle que l’on nous raconte en étant une), qu’un évènement historique aussi étrange et important soit-il peut être passé sous silence pour peu qu’il dérange la conception couramment admise, qu’il peut, aussi, n’avoir aucune réelle importance (sinon anecdotique) si les conditions de sa diffusion ne sont pas réunies.
Encore faut-il, au moins, se poser la question, ne pas accuser de rancœur ceux qui sur l’air des lampions réclament un semblant d’exactitude… c’est le minimum de politesse que l’on se doit.
Une fois ce point acquis la difficulté pour la critique vient du sens que portent les œuvres, la multiplication des ready-made comme celle des monochromes est une difficulté supplémentaire puisqu’il faut hors leur chronologie déterminer ce qui fait leur différence et leur valeur.
Pour compliquer la chose et brouiller ce qui précède qui a l’inconvénient d’être bien trop manichéen, il faut dire que ce que nous montrions cet automne là à la FIAC étaient des œuvres de la fin du XIX° qui étaient prises en 1988 pour des œuvres allant de 1950 à nos jours et que nous les avons signées alors qu’elles ne sont pas plus de nous que de Klein ou d’Armleder, pas plus sans doute que de Dada, Zipette ou Troulala. Cela ne fait, bien sûr, qu’ajouter à ce qui pourrait sembler une fois admis, assez clair, une quantité non-négligeable de confusion.

La colère
(la moutarde me monte au nez)
Mamco, Genève
Ce texte daté décembre 1989 a été publié dans le catalogue « L’avant-garde a bientôt cent ans » publié par la Galerie de Paris.
L’exposition elle même a été « reconstituée » à moins qu’elle n’ait été « réactivée » au Mamco de Genève (www.mamco.ch) sous le titre
« L’avant-garde est la doyenne de l’humanité » à l’occasion de trois journées d’étude et de rencontres autour des Arts Incohérents
organisées par le Mamco, la HEAD et le Département d’histoire de l’art de l’Université de Genève.Elle dure du 25 février au 24 mai.
Parodie ou paradis

La pression des rêves
(Collection Musée d’art moderne, Centre Georges Pompidou)
Il faut s’y reprendre à plusieurs fois si l’on veut être mal compris. Mal compris ne voulant pas dire, pas compris du tout.
Premier doigt dans l’orbite jusqu’au nerf optique : « Tous ce ”stuff” n’existerait pas sans l’art contemporain ». Ah bon ! Et vous, sans papa et maman, dans quels limbes seriez-vous ?
Pour parler franc, nous trouvons même que notre merdier existe foutrement plus que ce qui lui sert, parfois, de prétexte. Que nous avons du style et cent fois plus encore que toute la clique des poulets en batterie. Qui plus est du genre i-ni-mi-ta-ble!
Sans compter, bien entendu, que ce que les ignorants prennent pour de la parodie ne l’est pas toujours. Exemple : le drapeau peint… Drapeau peint ? Lavier ! Mais oui mon chou ! Personne lorsque Bertrand Lavier a peint son premier objet n’a dit : objet peint ? Présence Panchounette ! Même pas nous, c’est dire !
Comment à ce compte là, si vous ne savez pas distinguer votre droite et votre gauche, voulez-vous vous y retrouver dans le labyrinthe des simulacres ? En voilà une question qu’elle est bonne !
Que l’on vienne en prime nous balancer entre les pattes la qualité (française), on défaille… après Dada et Picasso, elle est où la qualité : Alberola ? Garouste ? Soulages ? Les objections que l’on nous fait seraient drôlement de mise pour ceux auxquels on ne les fait jamais, qui n’ont pas l’air, de leur côté, de trop féroces techniciens. Fermez le ban !
Deuxième doigt (au pays des aveugles, les conceptuels sont rois) dans l’orbite. C’est la figure bien connue des dancings le samedi soir : la fourchette. Le réel poserait un problème insoluble à l’art (de l’objet). Ben oui ! Il pose aussi, d’ailleurs, un problème à la science, soluble, encore heureux, dans l’atome… il y aurait donc une justice.
Refoulement, vous avez dit refoulement fait la cocotte minute avant de péter le joint.
Nous comprenons bien que ce soit, ce merveilleux renoncement, ce Harrar-Frères Jacques, intolérable à tous ceux qui s’empiffrent le sorbet aux trois boules (citron, kiwi, fruits de la passion)… qu’ils barbouillent ça de ce qu’ils connaissent : la rillette bourgeoise, mais c’est comme ça… c’est, comme ça même, pas mal du tout !
Il y aura, bien sûr, des spéculations après coup, des repentirs et des renoncements, mais ça vous a, quand même, avec un peu de recul, le pouce levé pour juger des proportions, une sacrée gueule.
Ce qui est curieux tout de même, c’est qu’ils y en aient quelques uns pour comprendre… des happy-few ( marchands surtout, depuis Benjamin, on sait qu’ils ont « l’œil » plus professionnel que ceux qui se donnent comme professionnels) et aussi pas mal d’autres, des rôdeurs de Prisunic pour saisir ce qu’il y a chez nous quelque chose de plus familier et de plus intime que chez Carl André et Sol LeWitt, qui, comble, a davantage à voir avec l’ART.
Faut pas trop flatter le pauvre, ça ne rapporte rien, mais des fois il surprend, il étonne, il a, à se faire enculer perpétuellement, les dendrites exceptionnellement aiguisées, des réparties brutales, des éclairs de lucidité. Allez l’ivrogne, c’est le printemps ! C’est le Kiravi qui ravit !
S’il se fait une telle unanimité religieuse sur la lâcheté du suicide c’est que tous ceux qui le condamnent le sont (lâches) – sans discussion ni rémission – possibles plus que celui qui est parti sans laisser d’adresse.
Il y a une certaine jubilation à mettre en scène ses funérailles, à dévisager le cortège par le petit trou dans la bière. « Ce sont toujours les meilleurs qui s’en vont les premiers »… Dans les yeux de certains, on lit la sincère compassion et dans ceux des autres, le soulagement veule. « Nous sommes là et un peu là, et la glace aux trois boules, on en aura davantage. Ah, les cons ! S’ils savaient comme l’on va s’en pourlécher… s’en faire péter la sous-ventrière ! »
Peut-être pa tan qu’aco, c’est pas une fin, nous sommes vampires, nous sommes des menaces. La crème peut tourner, la salmonellose s’y coller. Va y avoir un malaise passager… faut pas prendre les canards du bon Dieu pour des enfants sauvages ! Quand ça s’arrête d’un côté les empêcheurs de tourner en rond, ça repart de l’autre. Il y en a encore pour neuf mois des adieux sempiternels et sans rien à perdre… comme un mort qui serait vivant… Préparez les aulx et le Saint Chrème… le cadavre a grincé dans le placard.
Vers juin/juillet, on va entendre des voix s’élever : « Remboursez ! Remboursez ! Qu’ils se cassent… Vite… Plus vite ! De suite ! » Après ? Surprise du chef ! De quel côté, ça va viendre ? Par ci ? Par là ? Par nulle part ? Jamais ? Demain ? Mystère et boule de gomme ! Comme la Röte Fahne à une époque, vous allez nous soupçonner de toutes les malversations… planqués partout… derrière le cache-pot, sous le paillasson, derrière de soi-disant transparents pseudonymes ou juste dans le renvoi aigre du petit matin.
C’est déjà terminé le soupir de soulagement, vous allez être de moins en moins tranquilles. Vous voul(i)ez vous le réserver votre petit coin de paradis… moquette, évier double-bac… que vous ne soyez pas, vous aussi, mûrs pour le tout-à-cent-balles. Que dalle ! Vous y êtes en plein et ça vous coûte les yeux de la tête. Par les temps qui courent, nous avons contaminé jusqu’à l’amour.
Nous sommes beaucoup plus que des artistes – en définitive des maçons qui feraient rire en haut de l’échafaudage – nous sommes un adjectif.
Présence Panchounette
Mars 1990
Absence Panchounette

Pour vivre heureux, vivons cachés
(Nevers)
Comme personne ne songe plus à nier que l’art moderne soit un art critique, personne ne songe plus, non plus, à l’affirmer. Cette ellipse ordinaire dans les pensées, les opinions ou les jugements sur l’art satisfait, à vrai dire, tout le monde car, attendu que tout ce qui est critique est bon, il faut que tous les arrtistes modernes soient bons, puisque, étant modernes, ils sont nécessairement critiques, et étant critiques, ils sont nécessairement bons. or les artistes ne sauraient se plaindre d’être bons, les marchands ne sauraient se plaindre de vendre de bons artistes et, in fine, l’on ne voit pas de quoi pourrait se plaindre le public. Mais, puisque tout est bon, on ne voit pas non plus ce que l’on pourrait critiquer. Il faut donc malheureusement distinguer, au moins, deux critiques : la critique qui se contente d’être critique en se gardant bien de critiquer quoi que ce soit et la critique qui critique malgré tout quelque chose. Ces martières sont malheureusement délicates car, pour être critique, la critique qui ne critique rien doit quand même faire semblant de critiquer quelque chose, de sorte qu’il faut beaucoup de jugement pour arriver à distinguer la bonne critique de la mauvaise. Feu Présence Panchounette, groupe d’artistes critiques, ne manquait pas de jugement et c’est sans doute pourquoi il vient de faire ses adieux à la scène artistique, espérant par ce geste en produire l’ultime et radicale critique. Or, si pendant vingt ans, les Panchounettes sont demeurés fidèles à eux-mêmes, c’est à dire mauvais comme la gale et coriaces comme des teignes, cela tient d’abord à leur objet qui n’était pas commun. Au moment où l’art devenait le seul enjeu de l’art dans l’avant-garde (qu’est-ce qui est de l’art ?), ils faisaient diversion en franc-tireurs sur le front du goût (qu’est-ce qui plaît à qui ?). En adoptant le point de vue du goût comme l’on adopterait la politique du pire, ils se trouvèrent tout de suite en position de force, car, dans la perspective du goût pur, un baromètre ou un canapé valent bien une œuvre d’art. Tandis que leurs collègues s’escrimaient à faire des installations, des performances, des concepts ou des « in situ » qui portassent dans l’art le fer rouge de la révolution (et inversement) les Panchounettes pouvaient offrir le même menu – mais en plus radical, c’est-à-dire en plus pitoyable, en plus mal fait, en plus ironique, en plus mauvais. Comme la question de l’œuvre les faisait bailler et qu’ils s’asseyaient sur l’autonomie de l’art, ils avaient les mains libres pour faire carrément n’importe quoi. Des performances ? Un strip-tease ordinaire dans une galerie bordelaise. De l’in-situ ? Un échange d’expositions entre une galerie branchée de la rive gauche et une galerie ringarde de la rive droite. Des installations ? La reconstitution d’un intérieur assortissant Buren et un canapé design. Du concept ? La réalisation des premiers monochromes d’Alphonse Allais : « Communion solennelle de jeunes filles chlorotiques par temps de neige » (pour le blanc). Ils l’ont fait. Si les Panchounettes s’étaient contentés d’occuper le créneau néo-dadaïste, aujourd’hui envahi par le manièrisme, ils n’auraient pas produit le malaise réel qui accompagna longtemps leurs interventions sarcastiques. Mais en poussant la logique de l’Entkunstung jusqu’au bout, leur humour grinçant devenait réellement critique de ce qui, du côté de la mort de l’art prenait encore la pose tragique ou se drapait dans le sérieux bourgeois. Face à l’image dégradée que le miroir parodique des Panchounettes leur renvoie, les œuvres contemporaines semblent être encore trop artistiques, la grandeur dépouillée paraît chic, le débraillé de bon ton, le réductionnisme tarabiscoté, la démystification pleine de foi, la critique bienveillante, le n’importe-quoi trop concerté. C’est que le sublime, après tout, est un style et le goût une fatalité. Mais qu’est-ce que l’essence du goût moderne sinon le goût petit-bourgeois qui veut du toc authentique, du décontracté habillé, du nouveau à l’ancienne, de l’unique en série limitée et du plaisir sans jouissance ? Or, en prétendant s’émanciper du goût, l’art n’était-il pas en train de reproduire les contradictions inhérentes au goût moderne, c’est-à-dire au goût kantien? C’est ce dont s’avisérent très tôt les Panchounettes et c’est pourquoi ils voulurent toujours mettre leur grain de sel sur cette plaie. C’est pourquoi aussi, quand il leur fallait choisir un style, ils allaient toujours au pire, à ce qu’ils appelaient le chounette, qui comprend primo : les nains de jardin, secondo : les puits en pneus mais qui, au fond, comprend tout (pan-chounette). Ainsi ils n’exhibérent pas l’horreur esthétique comme: le contre-pied du bon goût mais comme sa vérité – son essence. La force des Panchounettes vient de ce qu’ils avaient lu le premier Baudrillard et avaient brutalement démontré l’existence dans le champ artistique même d’un « système des œuvres » ; c’était Dada sociologue. Mais la sociologie peut bien analyser l’eau du bain, elle ne fournira jamais la raison de jeter le bébé avec, parce qu’elle ne sait pas juger. Et voilà comment les artistes peuvent être critiques à peu de frais : en pratiquant la critique sans jugement ! Ce n’était pas pourtant le genre des Panchounettes qui ont toujours suggéré au spectateur que son goût était misérable et mensonger dans l’absolu. Admirateurs de Guy Debord, ils concevaient leurs productions comme une stratégie de combat contre la société du spectacle. Chaque manifestation pouvait faire apparaître les institutions artistiques comme répressives si elles refusaient le projet ou stupides si elles l’acceptaient ; la ligne de Panchounettes a toujours été la fameuse limite au delà de laquelle on ne peut que censurer l’extrémisme avec mauvaise conscience et en deça de laquelle on doit admettre l’inadmissible avec le sentiment d’avoir été floué. Le plus drôle est qu’à force de tirer sur la corde raide, Présence Panchounette est devenue célèbre. Parce que les temps ont changé sans doute, parce que l’institution artistique s’est bientôt sentie assez forte pour organiser elle même des parties de saute-limite, parce que l’impertinence est devenue le seul critère de la pertinence, parce qu' »on a détourné le détournement ». Voilà pourquoi les Panchounettes ont quitté la partie, non sans proposer une grève de l’art et affirmer que la disparition pure et simple était désormais la seule attitude critique – ce qui a occasionné quelques vagues, un phénomène de société, un signe des temps, son lot de pleureuses et, pour finir (Rebonds), la sibonysation dont je me suis ici même chargé. Après quoi tout continuera comme à l’avenir. Mais PAIX A LEUR POUDRE D’ESCAMPETTE donc et GLOIRE ETERNELLE A LEUR ABSENCE.

Ce texte écrit par Joseph Mouton devait être publié dans Libération, rubrique Rebonds,
il ne le sera pas (c’est dommage).
Joseph Mouton avait trop tardé à l’écrire et nous à le proposer,
l’effet produit par l’annonce de la disparition de Présence Panchounette s’était déjà évaporé.

Le vrai classique du vide parfait
(Collection Fondation Cartier)
Let’s dance
Le ton plaisant sert à mainte chose. Une drôlerie est un instrument.
Paul Valéry
L’art contemporain est désormais partout. On peut apprendre la géographie en consultant le calendrier des expositions des magazines spécialisés : Guéret, Issoire, Rabastens, Tilly-sur-Seulles, Locminé, Pont-à-Mousson, Roquebrune-sur-Argens, Vézelay, Treigny-sur-Yonne, Val-de-Vesle, Carantec, Gravelines, Fraissé-des-Corbières, Issoudun, Langres, Anduze, Annemasse, Annonay, Avallon, Saint-Savin-sur-Grempe, Riom, Figeac, Vendôme, Alès… Alès… Alès… Qu’aucun terroir n’échappe au soc de la modernité !
Pas une abbaye qui ne puisse couper à son installation, pas un château dont la salle des hallebardiers n’hérite d’une tenture abstraite ; pour peu que le castel en question ait des douves et un parc plus vaste que le square municipal, on en vire les sportifs et les taquineurs de goujons pour installer un parc de sculptures, genre redoutable entre tous.
Il faut donc que rien n’échappe à l’infernale débauche qui a saisi le fonctionnaire de la République, submerger à tout prix le patrimoine du clergé et de la noblesse, voilà désormais le cri de ralliement du tiers-état… Que la vieille pierre et le dernier cri copulent à n’en plus pouvoir… Plein cintre ! Lors du vernissage, Marquis ! Marquise ! C’est exquis ! Vous êtes exquise ! Quelle folle audace ! Si bien tempérée… Embrassons-nous Folleville ! Baise-mains… Petits fours… Pyrotechnie… C’est le bouquet ! A demain… au manoir !
Curieusement l’art français n’en est pas beaucoup plus vigoureux de ces agapes, de ces perpétuelles congratulations estivales, prétextes à raouts et adultères… Il doit y avoir un hic… Hic et nunc.
L’état, c’est son rôle et sa tendance naturelle vit ça sur l’air du Patrimoine, de l’alliance réussie, de la symbiose, de la symphonie… Jacques Chancel quand tu nous tiens le peuple se cultive…
Il s’agirait, si c’est possible, de voir l’art vivant ou ce qu’il en reste autrement que les remparts de Carcassonne, la commande publique autrement que sous l’aspect plus ou moins camouflé de la statue équestre et de se rendre compte que les achats des F.R.A.C. n’arriveront jamais (deutsch-mark oblige) à la rotule de ceux des chocolatiers teutons. Il faudrait un peu se secouer les neurones… Trouver le joint… faire confiance à ceux auxquels on ne peut pas faire confiance, qu’ils dilapident la cassette. Essayons l’échec, cela changera de toutes ces réussites. Que du résultat on cesse de s’obnubiler et la bobinette cherra.
Ce n’est pas encore tant du côté du fonctionnaire (qui, après tout, fonctionne tant bien que mal) qu’il faut chercher la panne, mais de celui de tous ceux que la manne de l’état arrose, tout le charmant secteur associatif — l’innocent — qui se rêve Castelli au petit pied, qui ne voit son rôle que vaguement promotionnel pourvu que la subvention tombe et permette de dire bonsoir à la sous-préfette, de payer l’électricité et les traites de la photocopieuse.
Encore plus en amont, toujours plus vers l’amont, il faudrait que l’artiste français cesse de se rêver garde-champêtre : le baudrier, la plaque pectorale et le treizième mois. Faut dire, bien sûr, qu’on l’encourage dans ses vices, mais il a, au fond, la tendance municipale ; il a tiré un trait sur la folie pour la consommation régulière de la marinade aux quatre baies roses. C’est toujours ça de pris sur l’ennemi, même s’il s’empâte le bougre !
Faudait donc, encore, qu’il y en ait qui se sacrifient, qui donnent l’exemple, qui crèvent la dalle, qui ne célèbrent pas ; car c’est hors de la cérémonie que le petit oiseau va sortir, hors des congratulations… Passe-moi la rhubarbe et l’on ira fumer le joint sous la tonnelle ! Tu m’invites — je t’invite — tais-toi et je ne dirai rien… Que le public l’on s’en foute enfin — il va venir — qu’on le laisse tranquille. Shake it baby !
C’est O.K. pour les grottes et les bars tabacs en ruines pourvu que, de temps à autre, on aille se promener ailleurs que sous l’éther des cimaises.
Egon Nicht
Texte publié dans Supplément culturel d’un journal qui n’existe pas
entièrement rédigé par mes soins sous divers pseudonymes
pour une exposition de Présence Panchounette à Sète à la fin des années 80
repris dans L’Introduction de l’esthétique, L’Harmattan
Entretiens avec le collectionneur Lamb(a)da
— Ecoutez ! Vous ne pourriez pas… pour une fois, faire comme tout le monde. Je ne dis pas parler comme, mettons… un exemple local, Anne Marie Pêcheur : « tordre et détordre la couleur et s’en tordre »… C’est d’accord, je sais… elle est en psychanalyse… ça l’interpelle ! mais, je ne sais pas… articuler, parler moins vite, sans accent. Je vais vous dire, un jour d’égarement, je me suis fait refiler une de vos saloperies… pas une grosse, non ! une petite, toute petite… dix-mille balles… ça fait cinq ans et ce ne sont que des réflexions continuelles… « Qu’est-ce que c’est ? », « un Présence Panchounette… », « Quelle horreur ! » Ça fait cinq ans, l’air de rien, que j’attends que ça monte et ça vaut toujours des clopinettes… alors, merde ! pour une fois… essayez… je ne dis pas d’être aussi intelligent que Claude Rutault qui est un grand artiste, mais il y a un créneau à prendre au jour d’aujourd’hui… petits maîtres… petits maîtres… ça ne vous intéresse donc pas ?
— C’est vrai, il faudrait que l’on y songe aux petits, aux sans-grade, aux ignorés, aux laissés pour compte. Les fameux, ceux qui font rebondir la métaphysique à des années-lumière, nous ne leur arrivons pas à la cheville… nous sommes juste du niveau, mettons, de Cocoricoco Boy… et encore !
— C’est ça… exactement ! Au début… pour commencer, je ne dis pas… blanc sur blanc, on suivait ! Les paillettes de l’Apocalypse, etc, etc… mais maintenant, il serait temps de vous calmer. Vous allez vous faire du mal avec des discours pareils… les idéologies sont mortes à l’heure actuelle… Actuel l’a dit… surtout la vôtre !
— C’est vrai ! C’est vrai !
— Surtout, je vais vous dire, il ne faudrait pas que vous la rameniez trop. Votre machin là, à la foldingue, ça n’aura qu’un temps, c’est même déja foutu ! Par le Rhône, parfaitement le Rhône, vous savez ce qui vous dégringole sur le coin de la gueule ?
— L’intelligence, pardi !
— Parfaitement l’intelligence et avec un I majuscule encore ! Marie Bourget, Michel Verjux, ça n’est pas de la petite bière… Elle accroche des socles comme des tableaux, ça n’est pas bien trouvé ça ? Et Verjux, il n’éclaire pas, il irradie
— C’est vrai ! C’est vrai !
— Il faut pas croire que vous allez vous en tirer comme ça avec de temps en temps un petit coup de concept, histoire de prouver que vous aussi vous avez le BEPC ! C’est pas pour ça que vous allez exposer au Consortium. Vous avez du mauvais sang à vous faire ! Vous n’êtes plus tout jeunes. La Figuration libre, c’était torché leur coup, mais vous ? Des ringards ! Des clowns !
C’est le genre de conversation que nous avons, voyez, avec le collectionneur bas de gamme, celui qui n’a pas tout compris, qui n’a vu que le début de l’arnaque. Comme tous les pauvres nos ambitions sont, bien sûr, planétaires et si l’on veut refiler des rossignols à dix-mille balles on a souvent intérêt à se faire encore plus cons que nous le sommes. Ce qu’il n’a pas compris, c’est que Bourget, Combas, brin- dessus, brin-dessous, c’est dans notre nasse qu’ils s’engouffrent.
— C’est reparti les mégalos ! Bien sûr, et puis quoi encore ? De qui on parle dans les journaux ? Qui on exporte ? L’AFAA, ils viennent souvent vous proposer de montrer vos saloperies à Samarkande ou Ankara ? Jamais ! Voilà la vérité !
Ce qui est emmerdant, c’est vrai, quand on a raison trop tôt, c’est qu’au moment précis « de là où on parle », on a tort. Que la cacophonie en question, on y a droit, on y est même en plein, mais que la société sans classes, on n’y a pas droit… ce serait même le contraire ! C’est l’homogénéisation à la rigueur… ça donne Swatch ! Ça donne City ! Au mieux, l’impôt sur les grandes fortunes (à supprimer d’urgence) et les voyous de barrière qui portent des Weston, mais l’orgasme collectif, le rasage gratis… c’est effectivement pas demain la vieille !
— Et alors ? Vous voyez !
— Alors ! Alors ! Ça n’est pas encore non plus que le petit nain vous le mettez dans votre jardin, ça n’est pas encore que l’AFAA nous plébiscite… vous l’avez dit vous-même ! Faudrait pas confondre, la loi, ici, c’est nous qui la faisons. Vous savez pas tout, on a encore de la ressource, il suffit qu’on se taise pour qu’ils soient moins bons, ceux que vous trouvez excellents.
— Je comprends que vous faites les malins mais que vous ne l’êtes pas tellement. Que vous voulez vous faire coller une auréole, mais que vous êtes de jolis petits salopards… comme les copains ! Seulement, la critique veille et vous n’allez pas nier qu’ils ne disent rien sur vous les critiques… que vous n’êtes pas bien intéressants à leurs yeux !
— On ne nie pas, on ne nie rien… c’est peut-être nous les terroristes, les poseurs de bombes, les sponsors d’Action Directe, les assassins du petit Grégory, du père Popiulesko, la filière bulgare, le Rainbow Warrior, les pinèdes en flammes, le Sida, Rock Hudson, Beyrouth, les otages, Marcel Carton, Marcel Fontaine, Tchernobyl ! C’est nous ! Pour tout, c’est nous… si vous voulez, mais la critique, c’est pas nous ! Parce qu’il faut la voir la critique et faut voir aussi comment elle marche… plus s’étonner de rien… qu’elle n’ait rien à dire sur nous… c’est trop compliqué, trop complexe pour votre petit bulbe.
— Et comme elle est alors, la critique ? Quelle gueule elle a ?
— Affreuse ! Hideuse ! Dracula ! Frankenstein ! Miou-Miou en pire… ça n’est pas un mystère… pour personne… ça n’est pas mon vieux, ici et maintenant, du délire… vous pouvez aller vérifier de visu, in situ, à tous les vernissages. Ceux qui ont des tronches normales, ils sont rentrés là par hasard, ils passaient, ils ont vu de la lumière, ils sont rentrés. Mais les autres, tous les laids, c’est le milieu… alors, la critique, vous pensez… Allez-y ! Vérifiez… les déjetés, les airs sournois, les nains, les gras de la phalange, les transpirants du nombril, les becs-de-lièvre, les spasmophiles, les mal-voyants, les pas-bien-entendants, la motricité difficile, les ataraxiques, les hémiplégiques, les énurétiques… ils sont là, vous pouvez les compter, les interviewer… un par un, à la sortie. C’est tellement trop que nous-mêmes, on ne comprend pas pourquoi. Sans demander les pétasses du show-bizz’ ni les petits garçons genre club de vacances, un échantillon normal de population suffirait… Macache ! Ce sont des monstres !
— Et la critique ?
à suivre
Retrouvé ce texte dont une partie (une dizaine de feuillets) avait été publiée dans Kanal (n° 31-32 et 33-34)
(pas très bien… je leur avais indiqué les coupes possibles dans le texte,
ils n’avaient rien trouvé de mieux que d’imprimer « à suivre » à chacune de mes indications).
Si une maison d’édition est intéressée, je peux discuter de sa publication…
Une interview* (inédite)
de Présence Panchounette
par Jérôme Sans !