Frédéric Roux
L’hiver indien
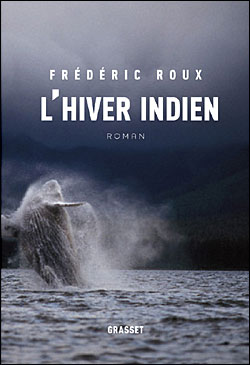
Father. I thought you had said that we are all going to live again.
Crow Woman
On ne se confie bien qu’à ceux que l’on ne connaît pas et Howard et
Dale ne se connaissaient pas. Qu’ils aient été père et fils n’y changeait
rien.
Un spécialiste n’aurait sûrement pas recommandé la thérapie
sauvage qu’ils ont entreprise dans un bar de Portland après qu’Howard
eut retrouvé son fils, il aurait eu trop peur des risques qu’elle comportait. S’ils
avaient eu affaire à ce genre de professionnel, hypothèse peu probable, le père et
le fils auraient pu lui objecter qu’il ne pouvait rien leur arriver de pire que d’être
vivants, qu’ils vivaient dans le pire depuis qu’ils étaient nés, alors même qu’ils
étaient nés au paradis terrestre : des pins, des séquoias, des cèdres à perte de
vue, le ciel par-dessus et les nuages, l’été indien, les vagues, la neige l’hiver sur les
montagnes comme du sucre glace et l’océan qui vient cogner sur les plages avec
le vent, les biches dans les clairières et le mouvement de leur cou, les bois perdus
des dix-cors, les aigles, leur vol, l’éclat des truites jetées sur la berge, l’éclair
d’argent du ventre des saumons coho, les bancs de flétans qu’il faut écarter avec
la proue du canoë, les mouettes, le chant des oiseaux. Et pourtant, ils avaient
été chassés de ce paradis envahi aujourd’hui par les touristes, les campeurs, les
randonneurs, par les retraités blancs en camping-cars qui ne les regardaient pas,
qui ne respectaient rien, qui ne voyaient que les clichés vantés par les prospectus
dont ils avaient fait collection au bureau du tourisme de Port Angeles.
« Neah Bay ? Sans les Indiens, ce serait parfait ! » ; « Tout ce à quoi ils sont
bons, c’est gâcher le paysage… » ; « Tu peux pas leur faire confiance, ils sont
pires que des nègres ! »
Encore heureux, ces envahisseurs – la dernière vague avant qu’on ne
les enterre dans la mer – ne s’aventuraient pas à l’intérieur des terres où les
entreprises forestières saccageaient en secret les bois dans le vacarme des tronçonneuses…
Des forêts qui avaient mis l’éternité à devenir ce qu’elles étaient
finissaient dans des scieries. Pour faire quoi ? Ils l’ignoraient ou, pour certains
d’entre eux plus au courant de la réalité, ils ne voulaient pas le savoir… des
meubles, des cloisons, de la pâte à papier, des parquets, des poutres, des solives,
des lambris, des « oeuvres d’art ». Il leur restait les miettes… la moquette et les
prospectus jetés par les fenêtres. Le seul rôle qu’on leur permettait de tenir
c’était celui de figurants et encore, à Hollywood, les figurants avaient droit à la
cantine gratuite et à quelques billets verts à la fin de la journée. Pour trois fois
moins, ils passaient des heures, qu’il pleuve ou qu’il vente, plantés au bord des
routes, fouettés par le vent des Peterbilt chargés de troncs gigantesques, un à
chaque bout du chantier, avec un panneau orange fluorescent sur lequel il y
avait marqué « Stop » d’un côté et « Slow » de l’autre.
Quand les voitures passaient à leur niveau, ils leur faisaient bonjour avec la
main pour se sentir moins seuls.
Abandonnés.
Tout le baratin sur la nation makah, ils le débitaient comme des automates,
sans y croire tandis que les grand-mères, un coussin sous les fesses pour
atteindre les pédales, continuaient à sourire gentiment aux étrangers qui leur
refusaient la priorité. Il n’y avait pas si longtemps, on leur tirait dessus lorsqu’ils
voulaient pêcher le saumon.
Leurs saumons !
Les barrages en amont avaient vidé leurs rivières.
La vérité c’était que les Blancs avaient réduit une nation souveraine,
un peuple entier, qui régnait sur des milliers de kilomètres carrés, à quelques
centaines d’individus consanguins lorsqu’ils ne s’étaient pas croisés avec les
plus pauvres d’entre les Blancs, ceux qui vivaient dans des caravanes dont on
ne savait même pas s’ils en avaient le titre de propriété, plantées sur des vérins
au milieu des décharges et devant lesquelles flottait en permanence le drapeau
américain, ou alors avec les gardes-côtes et les militaires de la base navale qui
s’ennuyaient tellement qu’ils baisaient les femmes indiennes lorsqu’ils étaient
bourrés.
À l’entrée de Neah Bay, sur la droite, après le panneau de bienvenue,
la station des gardes-côtes, entourée d’une clôture, faisait penser à un jeu de
construction, quand le soleil perçait, elle semblait phosphorescente. En face,
sur la gauche, on avait construit aux Makahs un Musée pour y enfermer les
milliers d’objets trouvés dans les fouilles d’Ozette (c’est-à-dire, pour certains,
les tuer une deuxième fois) et pour vanter ce qu’ils avaient été… autrefois,
lorsqu’ils savaient parler leur langue, honorer leurs dieux, pêcher, fabriquer
des hameçons, tresser des paniers si serrés que l’eau ne fuyait pas. Le Musée
était plongé dans la pénombre comme si la lumière électrique avait compris ce
que le Musée était censé célébrer : une veillée funèbre. Ceux qui étaient encore
vivants alors qu’ils étaient déjà morts, il suffisait de faire quelques centaines de
mètres pour les contempler, ils étaient là, vivants croyaient-ils, au milieu des
carcasses rouillées de voitures (le casseur de la Hoko River aurait fait fortune
s’il les avait toutes récupérées), des coques de bateau crevées, des panneaux de
basket couverts de graffitis et des chiens étendus au milieu de Lincoln Street
qui se grattaient les tétines.
On leur avait interdit de boire, ils allaient boire plus loin, la seule chose
qu’ils avaient héritée de leurs ancêtres, c’était un foie fragile, ils étaient saouls
au bout de trois bières, ça faisait rire les Blancs. Ils rentraient ivres à la réserve,
ils avaient beau connaître la route par coeur, ils oubliaient toujours un virage,
ils rentraient à pied, abandonnant l’épave de leur voiture achetée d’occasion
et à crédit.
Rien n’aurait pu décrire leur désespoir et leur solitude.
La première fois qu’il avait lu Les Possédés de Dostoïevski, une idée était
venue à Howard, si jamais, un jour, au lieu d’écrire des poèmes, il écrivait un
roman, il raconterait leur histoire et il l’appellerait Les Dépossédés, de si longue
date pour certains qu’ils ne se souvenaient pas même avoir possédé quelque
chose. Il avait écrit vingt pages avant de s’apercevoir qu’il n’avait rien à raconter.
S’il pouvait, parfois, tenir le vide captif dans un poème, il n’était pas de
force à le faire tenir tranquille plus longtemps. Il était trop intelligent pour ne
pas voir que son désespoir délayé n’était rien d’autre que de la complaisance,
sa noirceur tournait en rond, elle se noyait dans l’impudicité. Le vétéran s’était
rendu compte qu’il était incapable de prendre le risque de ne pas sortir intact
de ce qu’il écrivait, intact voulant dire identique à lui-même. Saoul, il arrivait
à écrire des poèmes, il avait même la nette impression (mais peut-être se
trompait-il) que plus il était saoul, meilleurs ils étaient, mais il se doutait bien
que pour écrire des romans, s’il ne voulait pas perdre le fil, il fallait être sobre.
Il était donc retourné à la poésie, plus facile malgré ce que tout le monde en
dit, ça l’arrangeait de croire que c’est quand il ne fait rien qu’un écrivain écrit
le mieux, que c’était la folie qui permettait de garder la raison. La facilité lui
convenait, il lui aurait, sinon, fallu travailler et cesser de boire ; il préférait que
l’inspiration le traverse comme une décharge électrique, une crise d’épilepsie
miniature, en un éclair, au comptoir où il y avait toujours deux ou trois types
incapables d’aligner une phrase pour admirer les aphorismes qui lui venaient
tout seuls. « C’est une forme d’esprit ! », avait-il l’habitude de répondre à ceux
qui lui demandaient d’où pouvait bien lui venir ce don. « Pour mettre l’esprit
en forme, c’est une autre paire de manches ! », marmonnait-il pour lui-même
et il s’insultait ensuite chaque fois qu’il reprenait ce refrain.
La vérité enfouie au fond de son âme, c’est qu’il se méprisait davantage qu’il
ne méprisait ses compagnons de beuverie. Il les méprisait de ne rien savoir et de
ne rien connaître et de s’en réjouir, il se méprisait de savoir et de connaître, mais
de ne rien pouvoir produire qui soit d’une quelconque utilité. Il aurait fallu pour
cela qu’il sache davantage, qu’il connaisse tout, mais c’était hors de sa portée,
il n’avait pas le courage, pas même celui d’envisager d’aller y voir de plus près.
En face de Dale, c’étaient les mêmes sentiments qui le submergeaient.
À peine avaient-ils commencé de parler qu’il s’était mis à se plaindre et il s’était
rendu compte, presque au même moment, que son fils non seulement n’avait
pas grand-chose à lui dire dont il ne se soit douté, mais qu’il le méprisait aussi.
Sur ce point, au moins, ils se ressemblaient. Les thérapeutes seraient sans
doute tombés d’accord : c’était une bonne base de discussion. À la place, ils
ont préféré s’engueuler avant de pleurer de concert, attablés en face l’un de
l’autre au Jiffy’s Ice Pop, sans prêter attention aux clients qui les regardaient
du coin de l’oeil.
Deux Indiens ivres et sentimentaux et déjà saouls.
Pas très propres non plus.
Dale avait gardé ses vêtements de travail, Howard ne s’était pas changé
depuis qu’il était parti de Neah Bay.
— Je t’ai attendu des nuits entières, je sursautais au moindre bruit, les voitures
qui passaient, je croyais toujours qu’elles allaient s’arrêter et que tu serais
au volant et je restais toute la nuit aux aguets, à écouter le bruit des voitures qui
approchaient et qui s’éloignaient, le bruit qui allait, le bruit qui venait, le bruit
qui s’éloignait et puis plus rien, je restais les yeux grands ouverts dans le noir
sur le dos à regarder les lumières des phares au plafond et puis la nuit revenait
et l’attente sans fin. Des fois, l’été, je sortais sur la véranda et j’attendais, je voulais
tellement fort que tu reviennes que j’en avais mal au crâne, je finissais par
m’endormir par terre sur la couverture du chien… avec le chien. Je t’ai attendu
avec le chien… il est crevé, je t’ai attendu encore et puis quand tu es revenu, ça
faisait au moins deux ans que j’avais renoncé à t’attendre… c’était fini, ça ne
m’intéressait plus… que tu sois vivant ou bien mort, ça m’intéressait pas, c’était
pareil pour moi. J’avais plus besoin de toi.
— Je suis là, non ?
— Mieux vaut tard que jamais, c’est ça ? Qu’est-ce que ça peut bien me foutre
que tu sois là ? Ça fait deux heures que tu me racontes que le Vietnam c’était
autre chose que le Koweït… et alors ? C’est quoi le problème ? Toutes les choses
ont leur place, tous les gens ont leur place et toi, tu n’es pas à ta place et moi non
plus à t’écouter dérailler.
— Les choses peuvent changer…
— Tu crois que t’as changé ? Tu racontes toujours les mêmes conneries et
quand tu racontes pas des conneries, tu t’apitoies sur ton sort au lieu de te préoccuper
du sort des autres. C’est le meilleur moyen…
— Je pensais à toi… pas tout le temps, mais je pensais à toi… j’ai pensé à toi,
je crois…
— Ouais… tu crois. T’as envoyé deux fois un chèque à grand-mère. Avec
le premier, on a rentré le bois pour l’hiver, avec le second, elle m’a acheté un
VTT.
— Tu vois !
— Je vois quoi ? J’ai pas eu froid tout un hiver et j’ai fait le tour de la Péninsule
en vélo et maintenant tu viens me raconter que je suis ton fils, que tu es mon
père… Va te faire foutre, Howard !
— Tu peux me dire ce que tu veux… t’as le droit ! Sans doute, t’as le droit,
mais il y a une chose que tu peux pas changer, c’est ce que tu viens de dire, je suis
ton père.
— T’as tiré ton coup !
— C’est comme ça que ça se passe.
— Pas seulement.
— Pas seulement…
— Alors ?
— Rien ! Je vais pas te raconter des conneries… on a jamais passé Noël
ensemble et tout le machin… la petite maison dans la prairie et Halloween,
oublie ! Mais on est deux êtres humains, on peut… peut-être, je dis peut-être,
faire autre chose que se jeter des reproches en travers de la gueule.
— J’sais pas.
— J’sais pas si on est des êtres civilisés, mais essayons de faire comme si…
ça changera !
— Je suis civilisé… autant que toi ! Je comprends pas ce que tu racontes…
je comprends pas ce que tu veux.
— Quand tu le sauras, ce sera pire !
— C’est gai !
Ils ont ri tous les deux et ils ont commandé deux autres bières. À ce momentlà,
c’était ce qu’il fallait qu’ils fassent, ils ont eu l’impression d’être, pour la
première fois, père et fils.

Cape Flattery

La forêt

Le Musée

La fin